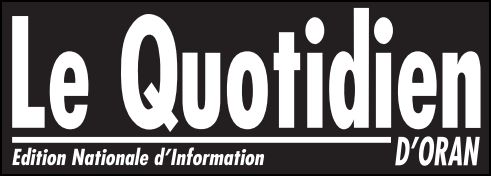Le journaliste Jean Sévillia vient de publier un essai historique Les vérités cachées de la guerre d’Algérie aux éditions Fayard. S’il s’agissait d’un énième ouvrage prétendant réactualiser les thèses de la mémoire des vaincus de l’Algérie française, il serait inutile d’en faire une critique. Mais, ce livre est publié par un des plus prestigieux éditeurs français de livres d’histoire, les éditions Fayard. De surcroit, Jean Sévillia fait partie des intellectuels conservateurs ayant une certaine audience dans l’opinion publique française. Auteur de biographies royales avec le dernier empereur Charles d’Autriche, 1887-1922 (Perrin, 2009), ce chroniqueur au Figaro Magazine a publié Historiquement correct (Perrin, 2003), grand succès de librairie qui fustige la «pensée unique moralisatrice» orientée à gauche dans le domaine des études historiques. La même critique pourrait d’ailleurs être adressée à Sévillia qui juge le passé par le prisme de ses opinions traditionalistes et nationalistes. Chantre du roman national français, il cherche à réhabiliter l’épopée coloniale en tentant de masquer habilement, grâce à ses qualités indéniables de plume, son entreprise par quelques concessions à certains acquis bien filtrés de la recherche historique récente.
Sur le plan de la méthode, le livre de Jean Sévillia ne fait référence à aucune archive et à très peu d’entretiens. Les nombreux témoignages algériens, pourtant publiés en Algérie chez Casbah Editions, Barzakh, Chihab, sont totalement absents du livre. Il se fonde essentiellement sur des sources secondaires en mettant en avant les travaux d’essayistes et de journalistes partageant ses orientations : Guillaume Zeller, petit-fils du général putschiste André Zeller, Jean Monneret, Pierre Montagnon, Roger Vétillard ou en sélectionnant dans les travaux d’historiens plus académiques d’orientation différente les analyses corroborant ses thèses (Charles-Robert Ageron, Guy Pervillé, Daniel Lefeuvre, Jean-Jacques Jordi, Maurice Vaïsse, Olivier Dard, Jacques Frémeaux, Raphaëlle Branche et Benjamin Stora). Très peu d’historiens algériens sont mentionnés à part une ou deux références à Mohammed Harbi. C’est bien une histoire franco-française du conflit qui est écrite par Sévillia. Il oublie qu’une guerre, cela se fait à deux, et qu’il faut prendre en compte le point de vue de tous les belligérants.
Sur le fond, Sévillia réactualise les thèses des défenseurs de l’Algérie française, plus à la manière d’un Pierre Boutang que de l’historien Raoul Girardet qui avait adhéré à l’OAS métropole. Pour l’essayiste, l’Algérie avant 1830 n’existe pas. Elle est une création coloniale. Notons au passage qu’il y a fort peu de constructions nationales abouties sur le continent européen en 1830. La thèse de Sévillia est contestable. La Régence d’Alger, qualifiée avec mépris par l’auteur d’«Etat corsaire», était un pouvoir politique autonome au sein de l’Empire ottoman dès le XVIIIe siècle avec la dynastie husseinite. Le sentiment national algérien en lien avec l’islam et la conscience territoriale sont en gestation dès le XVIIe siècle. A l’époque ottomane, les sources se réfèrent au watan al-jazâ’ir, «le pays des îles», comme le mentionne l’historien algérien Lemnouar Merouche (Recherches sur l’Algérie ottomane, 2 tomes, Bouchene, 2007).
La Régence d’Alger a participé à la construction d’une entité politique algérienne clairement distincte à l’est de la Régence de Tunis et à l’ouest de l’Empire chérifien alaouite, même s’il n’y avait pas des frontières linéaires, mais des zones d’influence mobilisées pour la collecte de l’impôt. Née de la résistance à l’expansion espagnole, s’appuyant sur les raïs et les janissaires, une caste militaire ayant longtemps inclut des Européens convertis à l’islam, la Régence d’Alger était un pouvoir politique ottoman auquel étaient associées les grandes familles algériennes, pour le contrôle des régions intérieures, notamment par le biais des kulughlî issus d’un métissage entre les Algériens et les Turcs. Sévillia ne parle pas de Hadj Ahmed Bey à la tête du beylik de Constantine. Il était justement l’un d’eux et l’un des plus importants dignitaires de la Régence d’Alger. Il a défendu Constantine jusqu’en 1837 et a résisté aux Français jusqu’en 1848, tout en demeurant fidèle à l’Empire ottoman. Sevillia aurait gagné à se référer à sa biographie écrite par l’historien tunisien Abdeljelil Temimi.
Si l’essayiste reconnait que la conquête a été cruelle tout en faisant référence à la violence des résistances algériennes au XIXe siècle fondées selon l’auteur sur le fanatisme religieux, ce qui témoigne d’une adhésion aux idées traditionalistes catholiques, il refuse de la condamner en disant qu’elle a été une «destruction créatrice». Pour Sévillia, la conquête arabe a été aussi violente sans susciter de telles condamnations. Toutefois, cette dernière a donné lieu à des métissages aussi bien culturels que par le sang, conférant au peuple algérien son caractère arabo-berbère. Les Berbères se sont convertis à l’islam. Mais, les Algériens après la conquête française ne se sont pas convertis au christianisme à de rares exceptions près comme le montre Oissila Saaidia dans son ouvrage l’Algérie catholique XIXe-XXe siècles (Editions du CNRS, 2018). La séparation entre colons et colonisés a été la règle juridique dans la société coloniale même si dans certaines sphères sociales, des espaces de contact ont pu exister faites de relations amicales, voire fraternelles, dans certains milieux, à l’instar des syndicats ou des organisations sportives ou à l’occasion de fêtes. Comme pour toute colonisation, un métissage culturel a pu se produire très variable selon les espaces et les sphères sociales.
Peut-on aller jusqu’à parler de créolisation de la société coloniale algérienne, notion forgée par l’historien jamaïcain E. K. Brathwaite, popularisée par Edouard Glissant et Robert A. Hall et employée en France par des historiens comme Pierre Singaravélou ? Sans trancher dans cet article, la question aurait mérité d’être posée. Elle ne taraude pas Jean Sévillia qui se contente d’écrire que l’apartheid n’existait pas dans l’Algérie coloniale. Toutefois, la séparation était bien intériorisée dans les esprits et n’avait pas besoin de pancartes pour préciser la place de chacun et la limite à ne pas franchir.
Comme l’a mentionné Jacques Frémeaux, reprenant une analyse de John S. Furnivall pour les sociétés impériales, la société coloniale algérienne a été une société plurale dans laquelle coexistaient des groupes obéissant à une même autorité, mais qui ne se mélangeaient pas, chacun gardant ses traditions, ses mœurs et sa religion. Il existait une frontière juridique comme l’a montré René Gallissot, historien majeur non cité par le journaliste, entre Européens jouissant de la plénitude des droits, et autochtones victimes de la spoliation foncière et devenus des sujets dans leur propre pays. Les inégalités juridiques, Sévillia ne les nie pas. Mais, il cherche à les nuancer en relatant les réalisations de la France coloniale en Algérie. Il oublie de mentionner que les constructions de routes, d’écoles et d’hôpitaux l’ont été essentiellement pour la minorité européenne privilégiée et pour l’exploitation du pays. En pratique, le but de la colonisation n’a jamais été d’améliorer les conditions de vie des autochtones algériens clochardisés.
S’il ne nie pas cet appauvrissement, reprenant les arguments de l’historien Daniel Lefeuvre, il l’impute surtout à l’explosion démographique faisant suite à la saignée de la conquête, sans pointer suffisamment les effets déstabilisateurs de la colonisation officielle et privée sur une société traditionnelle avec notamment les législations foncières d’exception à but punitif, spéculatif et confiscatoire au XIXe siècle qui sapent les mécanismes collectifs et traditionnels de la propriété algérienne, ce qui se traduit par de graves crises comme la famine de 1866-1868. Les historiens André Nouschi, Djilali Sari et plus récemment Didier Guignard l’ont très bien montré dans leurs travaux, y compris à l’époque du Second Empire avec le sénatus-consulte de 1863, le rêve du royaume arabe de Napoléon III et d’Ismayl Urbain étant resté une chimère.
Si les enfants algériens n’étaient pas scolarisés dans l’Algérie coloniale, Sévillia l’impute à la «barbarie religieuse» des Algériens. Aïssa Kadri non cité par Sévillia a bien mis en évidence les oppositions de tous bords à la scolarisation des Algériens et qu’une discrimination scolaire entre Européens et Algériens se pratiquait couramment dans l’Algérie coloniale. L’enseignement spécial pour les Algériens organisé à partir de 1883 dispensé dans les écoles auxiliaires, «écoles gourbis» au surnom évocateur avec ses diplômes et ses programmes spéciaux, la fusion avec l’enseignement européen n’étant intervenue véritablement qu’après la Seconde Guerre mondiale. L’argument de Sévillia est choquant, idéologique et atteste d’une méconnaissance profonde du fonctionnement de la société coloniale. Pour l’essayiste, les Européens faisaient davantage preuve de paternalisme que de racisme à l’égard des Algériens, ce qui est une falsification de l’histoire. Il refuse de les qualifier de colons, préférant réserver ce terme à la minorité de grands propriétaires terriens, ce qui est très contestable, les colons étant par définition les habitants européens d’une colonie et donc des étrangers pour les Algériens, lois de naturalisation ou pas adoptées par la France coloniale.
Sévillia cherche, à chaque fois, à nuancer la sur-répression menée par la France coloniale contre le mouvement nationaliste algérien. Il le fait de manière habile. Il ne nie pas la sur-répression du 8 mai 1945. Il en impute la responsabilité aux Algériens qui ont massacré une centaine d’Européens suite aux manifestations du 1er mai à Alger et à Oran, du 8 mai à Sétif-Kherrata, à Guelma, à Blida et à Bône (actuel Annaba) ayant fait dans leur première phase des victimes chez les Européens et chez les Algériens. Il oublie de préciser que ces troubles sont causées par le refus du colonisateur d’autoriser les Algériens à manifester alors qu’environ 130.000 d’entre eux ont participé aux campagnes de Tunisie, d’Italie, à la libération du territoire français, et à la campagne Rhin et Danube aux côtés d’ailleurs des Européens d’Algérie comme le montre le livre de Chantal Metzger, le Maghreb dans la guerre, 1939-1945 (Armand Collin, 2018). Le premier président algérien Ahmed Ben Bella a été décoré de la médaille militaire pour sa participation à la bataille de Monte Cassino. En guise de remerciement, les autorités françaises n’ont pas autorisé que les Algériens, à l’instigation des militants du PPA (Parti du peuple algérien), manifestent comme une entité séparée pour réclamer leurs justes droits en brandissant leurs symboles nationaux et demander la libération de Messali Hadj qui avait refusé toute collaboration avec les Allemands. On peut se référer aux travaux d’Annie Rey-Goldzeiguer, de Jean-Pierre Peyroulou et de Jean-Louis Planche, qui demeurent une référence en la matière.
Quant au 1er novembre 1954, Sévillia impute le déclenchement de la guerre d’Algérie au FLN qualifié d’organisation terroriste alors que la responsabilité du conflit incombe aux autorités françaises ayant refusé toute réforme pour faire de l’Algérie dite française un des systèmes coloniaux de peuplement les plus fermés et répressifs du monde. La crise interne au sein du parti messaliste et la radicalisation de militants souvent membres de l’OS (Organisation spéciale) expliquent également l’insurrection. Sévillia pointe les atrocités commises des deux côtés cherchant un équilibre qui méconnait les causes fondamentales de la lutte contre les dénis de droits, la dépossession et la répression continue. Mais, à chaque fois, il cherche à mettre en avant la responsabilité du FLN et à minorer celle de la France coloniale.
L’insurrection du Nord-Constantinois du FLN encadrant la paysannerie algérienne, le 20 août 55, a certes causé les tueries d’El Alia et d’El Abid qui hantent la mémoire des nostalgiques de l’Algérie française. Mais, elle est à l’origine de la sur-répression commise conjointement par l’armée et les milices européennes contre les Algériens (12.000 morts à Skikda, chiffre minorée par Sévillia), ce qui a dressé un fossé de sang entre les communautés.
Pour la grande répression de janvier à octobre 1957, l’essayiste note que la campagne d’attentats aveugles lancée par le FLN est antérieure à l’exécution d’Ahmed Zabana et d’Abdelkader Ferradj le 19 juin 1956 et à l’attentat de la rue de Thèbes le 10 août 1956 commis par les activistes, ce qui est faux. Les attentats à la bombe ont commencé fin juin 1956 après la décision de la France coloniale d’utiliser la guillotine comme arme de guerre. Auparavant, les attentats étaient individuels conformément à une directive d’Abane Ramdane datant de février 1956.
Le vote des pouvoirs spéciaux par l’Assemblée nationale le 12 mars 1956 au gou vernement socialiste Guy Mollet qui délègue le maintien de l’ordre à l’armée est invoqué à juste titre par Sévillia pour expliquer les crimes commis contre l’humain par des militaires non préparés pour une telle mission. Les gouvernements de la IVe République ont failli en menant une politique ambiguë entre répression, pacification et négociations secrètes par l’entreprise de la SFIO. Sur ce point, il faut se référer aux travaux de Claire Marynower sur Joseph Begarra, leader incontesté de la SFIO à Oran, chargé par Guy Mollet d’entrer en contact avec le FLN. Sévillia oublie de mentionner que la violence contre les civils a suscité des débats internes au sein du FLN et des condamnations de la part de certains nationalistes algériens à l’instar de Bachir Ibrahimi, président de l’association des ulamâ, qui a rappelé que la lutte armée devait respecter certaines règles et se dispenser de cibler les civils, les femmes, les enfants et les vieillards.
Pour analyser plus objectivement les processus de violence durant cette guerre coloniale, il manque à Sévillia comme à de nombreux auteurs français une lecture de Frantz Fanon. Contrairement au monde anglo-saxon, celui-ci subit dans les universités françaises un anathème à quelques exceptions près (Pap N’Diyae, Achille Mbembe). En France, il est assimilé à un prophète de la violence, ce qu’il n’est pas. Ce ne sont pas les colonisés qui créent la violence, mais le colonisateur. Psychiatre martiniquais, Fanon est un humaniste qui a dénoncé les modes de fonctionnement racistes de la psychiatrie coloniale avant de devenir le théoricien de la révolution algérienne. En rejoignant le FLN, il a élaboré une théorie de la libération totale des peuples du Sud comme l’ont expliqué Edward Saïd, Saïd Bouamama dans son livre Figures de la révolution africaine de Kenyatta à Sankara (La Découverte, 2014), David Macey et Alice Cherki, ces deux auteurs ayant écrit des biographies de référence sur Fanon. Cette libération est politique avec le rejet de tous les autoritarismes, économique avec la critique de la confiscation des richesses nationales par des oligarchies corrompues, culturelle avec la volonté de se réapproprier une histoire confisquée par le colonisateur et individuelle avec le primat accordé à l’autonomie du sujet. Fanon était avant tout un médecin qui dénonçait toutes les formes d’aliénation. En France, en lieu et place de Fanon, les étudiants sont renvoyés au philosophe de l’entre-deux, Albert Camus. Si ce dernier est un grand écrivain, sur le plan politique, ses analyses ont leurs limites. En effet, Camus n’a jamais soutenu l’indépendance de l’Algérie.
Les analyses de Sévillia s’en trouvent biaisées et influencées par son idéologie. Pourquoi ne qualifie-t-il pas les exactions de l’armée coloniale de terrorisme à grande échelle commises contre tout un peuple ? Elles sont responsables de la défaite française en ayant entrainé des ralliements massifs au FLN. Sa victoire est visible à Alger lors des manifestations de décembre 1960. En effet, l’armée coloniale pensait avoir éradiqué le FLN dans Alger après la grande répression de 1957. Quel aveuglement !
Il est inconcevable de qualifier de terrorisme comme le fait Sévillia une lutte de libération nationale dans un contexte de guerre irrégulière très bien étudié au XXe siècle par Gérard Chaliand et plus récemment par Elie Tenembaum (Perrin, 2018). Sévillia utiliserait-il le même qualificatif pour désigner la Haganah et l’Irgoun, les deux organisations sionistes en lutte contre le colonisateur britannique en Palestine et qui sont à l’origine de l’armée israélienne Tsahal ? Pourtant, c’est bien l’Irgoun qui a perpétré l’attentat contre l’hôtel King David à Jérusalem en 1946 tuant des militaires et des civils.
Sévillia ne parle pas du viol employé comme arme de guerre par l’armée française traité par Raphaëlle Branche et de toutes les autres violences sexuelles de la France coloniale étudiées dans le livre dirigé par Todd Shepard et Catherine Brun, la guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi (Editions du CNRS, 2017). S’il parle de la violence anthropologique des Algériens avec les parties génitales coupées et les corps mutilés des jeunes appelés, pourquoi ne parle-t-il pas de la gégène pratiquée sur les parties génitales des Algériens jusqu’à l’impuissance du prisonnier et de toutes les attaques à caractère sexuel perpétrées contre la culture algérienne fortement marquée par l’honneur familial et communautaire ? La torture, comme l’écrit Sévillia, n’est pas qu’un simple interrogatoire poussé. Est-il tout à fait honnête lorsqu’il cherche à réhabiliter l’honneur perdu de l’armée coloniale en traitant de la politique de pacification menée par les SAS (Sections administratives spécialisées), forme modernisée des Bureaux arabes du XIXe siècle, alors qu’elles avaient surtout un but de renseignement ?
Pour l’essayiste, les historiens de la guerre d’Algérie ont oublié des pans majeurs de cette histoire en ne traitant pas de certains aspects du conflit, ce qui est faux. Le livre collectif Histoire de l’Algérie coloniale, dirigé par Abderrahmane Bouchene, Jean-Pierre Peyroulou et Sylvie Thénault en est un démenti. La guerre civile entre le FLN et les messalistes est abondamment traitée chez Gilbert Meynier, Mohammed Harbi et Benjamin Stora. Quant à l’affaire Si Salah, l’ouvrage de Rabah Zamoum, le neveu d’Ali Zamoum, frère de Si Salah, a été publié en Algérie, Si Salah, mystères et vérités, chez Casbah Editions. Gilbert Meynier et Mohammed Harbi ont publié les documents relatifs à ce dossier (Le FLN : documents et histoires, 1954-1962, Fayard). Sur les purges d’Amirouche dans la wilâya 3 en Kabylie et sur celles du colonel M’Hamed Bougara dans la wilâya 4 dans l’Algérois dont Sévillia ne parle pas, ces questions sont abordées dans des mémoires comme Du militant politique au dirigeant militaire d’Ali Kafi (Casbah Editions, 2002) et des ouvrages historiques comme l’Histoire intérieure du FLN de Gilbert Meynier (Fayard, 2004). Les luttes internes au sein du FLN sont abondamment traitées dans les témoignages publiés et dans l’historiographie, y compris bien sûr l’assassinat d’Abane Ramdane abordé par Mohammed Lebjaoui, Khalfa Mameri et Mohammed Harbi.
Point le plus intéressant de l’ouvrage, les ambiguïtés de la politique de De Gaulle sont analysées par Jean Sévillia avec davantage d’objectivité. Il ne va certes pas jusqu’à écrire que De Gaulle a poursuivi une politique de guerre à outrance contre le peuple algérien pour parvenir en situation de force aux négociations comme avait pu le dire l’historien René Gallissot. Les Algériens ont souffert également sous De Gaulle des exactions policières à Paris lors du 17 octobre 1961 que Sévillia refuse de qualifier de massacres en se fondant sur le dépouillement des archives de la préfecture de police de Paris de l’historien Jean-Paul Brunet. Là encore, les références historiographiques de Jean Sévillia sont sélectives. Il n’y a aucune allusion aux travaux d’Emmanuel Blanchard (la police parisienne et les Algériens, 1944-1962, Editions Nouveau Monde, 2011), de Jim House et de Neil Mac Master sur cet événement et sa mémoire (Paris 1961, les Algériens, la Terreur d’Etat et la mémoire, Tallandier, 2008). En effet, le massacre du 17 octobre 1961 a été triplement occulté par les autorités françaises, mais aussi par la gauche française qui lui a préféré la manifestation antifasciste de Charonne le 8 février 1962 et en Algérie à cause de la marginalisation de la Fédération de France du FLN, organisatrice de la manifestation des immigrés algériens en plein Paris.
Sévillia montre bien le double langage du général De Gaulle, les contradictions entre sa parole publique et sa parole privée, ses ambiguïtés, son pragmatisme, ses mensonges à l’armée, aux Européens d’Algérie et aux Algériens musulmans qui avaient pris le parti de la France et sa décision d’un retrait brutal de l’Algérie hâtée par des événements comme la semaine des barricades du 24 janvier 1960 au 1er février 1960 et les manifestations de décembre 1960. Il montre les responsabilités de la politique gaullienne dans le déclenchement de la guerre civile française (1958-1962), pour reprendre le titre de l’ouvrage récent de Grey Anderson (La Fabrique, 2018), politique qui a produit également ses mensonges officiels en France, le retrait d’Algérie étant présenté comme une victoire et le complot du 13 mai 1958 comme un triomphe de la démocratie. Le livre de Sévillia exprime bien l’antigaullisme d’une droite française coincée entre l’extrême-droite et ceux qui se présentent comme les héritiers du général De Gaulle, ceux que jadis on appelait en France les indépendants.
Sur les ultras de l’Algérie française, Sévillia fait la différence entre les putschistes d’avril 1961 comme Denoix de Saint Marc et les terroristes de l’OAS qu’il condamne sans ambiguïté tout en expliquant que cette politique de la terre brûlée du dernier carré des ultras a été causée par la politique brusque d’abandon et les mensonges du général De Gaulle. Il précise à juste titre que les policiers envoyés par De Gaulle pour combattre l’OAS, surnommés les «barbouzes», ont aussi utilisé la torture contre eux.
L’essayiste n’explique toutefois pas assez que c’est justement la résistance populaire du FLN qui pousse De Gaulle à se renier par rapport à sa position initiale favorable à l’intégration en 1958 pour se rallier à l’autodétermination (le discours du 16 septembre 1959), puis à la recherche d’une solution négociée avec le FLN reconnu comme seul représentant du peuple algérien à partir du referendum du 8 janvier 1961.
Pour Sévillia, le général De Gaulle a mené une politique du chaos en Algérie dans le dernier quart d’heure après les accords d’Evian. Encore souveraines en théorie après le 19 mars 1962, les autorités françaises se sont retirées brutalement de l’Algérie avec le départ massif des cadres européens sans organiser convenablement la transition postcoloniale. Elles se sont défaussées sur un Exécutif provisoire franco-algérien aux pouvoirs très faibles sur le terrain. Sans pouvoir bénéficier du soutien des troupes françaises généralement encasernées, la Force locale de cette institution de transition s’est avérée incapable de faire respecter le cessez-le-feu violé autant par l’OAS que par l’ALN qui était, en partie, une armée de maquisards mal ravitaillée dont l’autorité centrale connaissait des divisions et qui pouvait être débordée par des initiatives locales.
Sacrifiant les harkis et les Européens d’Algérie, le général De Gaulle a privilégié la défense des intérêts économiques et stratégiques français dans la future Algérie indépendante, ce qui justifie l’accusation de néo-colonialisme de Boumediene et de Ben Bella. Pour Sévillia, De Gaulle est le vrai responsable des morts européens de la rue d’Isly le 26 mars 1962 et sa politique de brusque retrait a créé le contexte favorable aux enlèvements d’Européens et aux massacres à Oran le 5 juillet 1962 étudiés par Fouad Soufi, Jean-Jacques Jordi et Guy Pervillé (Oran, 5 juillet 62, Leçons d’histoire sur un massacre et histoire iconoclaste de la guerre d’Algérie et de sa mémoire parus chez Vendémiaire). Sur ce point, Sévillia pointe la responsabilité du général Katz à la tête du secteur d’Oran qui a tardé à intervenir. Le 5 juillet 1962, date officielle de l’indépendance pour le gouvernement algérien, il n’y a plus de représentant du gouvernement français en Algérie, la date pour ce dernier de la fin de la présence française étant le 3 juillet. Il n’y a pas de preuve concluante à ce jour incriminant la direction du FLN pour cette tuerie. En définitive, ce n’est pas le FLN, en proie à des luttes internes, qui est responsable du chaos final. C’est plutôt le désengagement brutal français voulu par le général De Gaulle, vaincu par le FLN. Sa principale préoccupation était de restaurer la puissance française en se débarrassant du bourbier algérien. Lors de la phase transitoire, une force d’interposition internationale ou gérée par des pays tiers a manqué pour empêcher un tel chaos et faire respecter le cessez-le-feu. De Gaulle, au nom de ses conceptions souverainistes, n’était pas prêt à l’accepter.
Concernant le massacre des harkis que Sévillia attribue à une politique délibérée du FLN, cette thèse n’est absolument pas prouvée par des sources. Sévillia n’est pas exhaustif dans ses analyses. Il oublie de citer les témoignages des Algériens qui ont souffert des exactions des supplétifs autochtones de l’armée française, ce qui l’aurait certainement conduit à remettre en cause sa vision du commando Georges ou du bachaga Boualam. Les harkis, mais aussi les engagés et appelés algériens, les moghaznis, les supplétifs des SAS, les groupes mobiles de sécurité et les groupes d’autodéfense étaient souvent utilisés par l’armée française pour effectuer les plus basses besognes contre leurs propres frères, ce qui explique le déchainement de violences locales contre eux à l’indépendance, sans pour autant qu’il soit possible de parler de plan coordonné par le FLN. Comme l’a écrit François-Xavier Hautreux, auteur de la guerre d’Algérie des harkis (1954-1962), «aucune faction algérienne n’a revendiqué le massacre des harkis. Afin d’asseoir son autorité, le pouvoir indépendant a davantage accompagné les massacres qu’il n’en fut l’initiateur.» Les violences spontanées des masses algériennes lors de la sortie de guerre s’expliquent par le comportement de ces unités durant le conflit. Le livre du journaliste Pierre Daum Le dernier tabou, les harkis restés en Algérie après l’indépendance a montré que la plupart des anciens auxiliaires algériens a continué de vivre dans l’Algérie indépendante en ne se mettant pas trop en avant, il est vrai. Sur le bilan chiffré de la guerre d’Algérie, les analyses de Sévillia alimentent la guerre des mémoires en minimisant les pertes algériennes. Il ne se réfère pas aux travaux du démographe Kamel Kateb qui concluent à l’impossibilité de donner des chiffres définitifs. Selon lui, en l’état d’une documentation statistique incomplète, seules des hypothèses, fonction des orientations de l’historien, peuvent être formulées. Celles de Sévillia sont très basses concernant les morts algériens.
L’essayiste regrette en définitive les occasions manquées qui n’ont pas permis de déboucher sur une Algérie algérienne associée à la France. En voulant sauver l’honneur de l’armée française, il se trompe en disant que l’armée française l’a emporté militairement après les opérations Challe en 1959. N’étant pas parvenu à éradiquer totalement le FLN dans les montagnes et dans les villes, dans le contexte d’une guerre irrégulière, le FLN et son bras armé l’ALN, qui ont livré plusieurs affrontements d’envergure contre l’armée française lors des premières années de la guerre d’Algérie à l’instar de la bataille d’El Djorf en septembre 1955, et pas seulement de simples embuscades, ont remporté la victoire. Dans une guerre irrégulière, lutte politique, lutte syndicale, lutte diplomatique et lutte armée sont les aspects complémentaires d’une lutte de libération nationale. Sinon, pourquoi le machiavélien général De Gaulle aurait-il renoncé au Sahara algérien et à ses ressources qui ont suscité chez lui plus d’intérêt que les Européens d’Algérie et les supplétifs algériens ?
Concernant les Européens d’Algérie, ils n’ont pas été victimes d’une épuration ethnique de la part du pouvoir algérien indépendant comme l’écrit Sévillia. S’ils ont quitté massivement l’Algérie, c’est parce qu’ils n’y avaient plus leur place en ayant soutenu l’Algérie française et parfois l’OAS. Ben Bella, lors du CNRA de Tripoli du 25 mai au 7 juillet 1962, ne fait qu’exprimer ce point de vue relaté par l’historien Jeffrey James Byrne qui a pu consulter les archives algériennes. Sous la colonisation, les Européens d’Algérie ne considéraient pas les Algériens musulmans comme leurs égaux. Ils refusaient de partager avec eux. D’une certaine manière, perdant avec l’indépendance leur statut privilégié de «petit blanc», ces descendants de migrants pauvres d’Europe du Sud pour la plupart, ont accepté d’être déplacés en France même si les départs se sont faits de manière plus échelonnée qu’initialement décrits. La valise ou le cercueil est un mythe, même s’il n’y a pas eu en Algérie de Nelson Mandela luttant contre toute tentative suprématiste. C’est la peur du déclassement dans une Algérie indépendante qui explique cette migration. Ce n’est qu’en migrant en France, en étant victimes eux-mêmes de racisme, que certains Européens d’Algérie ont compris qu’ils avaient été des agents du colonialisme et des boucs-émissaires de la politique de la République coloniale. Les nostalgiques de l’Algérie française parmi eux continuent de persister dans leur aveuglement. Les Algériens, quant à eux, sont reconnaissants à l’égard de la minorité des Européens d’Algérie, souvent communistes ou chrétiens, qui les ont soutenus dans leur lutte. Ceux qui ont lutté pour le peuple algérien ont pu vivre sans problème en Algérie. Pour Sévillia, l’anticolonialisme a été le monopole d’intellectuels de gauche, de porteurs de valise et de «pieds rouges» engagés pour l’émancipation de pays du Sud, ce qui est caricatural. Comme le mentionne Fouad Soufi, le maire du Telagh, Henri Quièvreux de Quiévrain, monarchiste et catholique, a été assassiné par l’OAS le 22 février 1962 pour son soutien au FLN. Des rues portent son nom en Algérie.
Au final, Sévillia se trompe en disant que le FLN a mené une guerre religieuse même si par moment il a pu faire appel au djihâd pour mobiliser la paysannerie. En Tunisie, le laïc, ou du moins très libéral sur le plan de la religion, Habib Bourguiba, a aussi fait appel au djihâd en 1952 pour mobiliser les Tunisiens contre le colonisateur. Le FLN a certes voulu refaire de l’Algérie une terre musulmane comme annoncé dans la déclaration du 1er novembre 1954. Mais, le pouvoir algérien indépendant n’a jamais voulu mettre en place la charia en Algérie et ne l’a pas fait après 1962. De 1954 à 1962, le FLN a mené une lutte de libération nationale. Plus grave, Sévillia écrit dans sa conclusion que l’Algérie n’est jamais sortie de la violence depuis 1962 à cause des violences du FLN, ce qui est faux. La mémoire revancharde des nostalgiques de la colonisation pousse Sévillia certainement à faire le lien entre guerre d’Algérie et guerre civile algérienne dans les années 1990. Mais, c’est historiquement incorrect. Si le lien peut être fait, c’est par le biais du trauma colonial qui a déstructuré la société algérienne comme le montre le livre de Karima Lazali paru récemment aux éditions La Découverte.
Emmanuel Alcaraz, Docteur en histoire, auteur des lieux de mémoire de la guerre d’indépendance algérienne (Karthala).
Lire aussi : La page de recherche d’Emmanuel Alcaraz