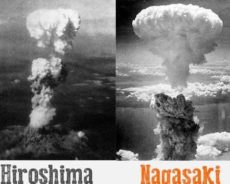La cinquième génération de réseaux mobiles, censée répondre à la croissance du trafic, devrait l’augmenter et conduire à des innovations ainsi qu’au renouvellement des équipements. Pas vraiment synonyme de sobriété.
Après la Convention citoyenne pour le climat, demandant un moratoire sur le déploiement de la 5G, la vague verte de juin aux élections municipales a porté de nouveaux maires ayant fait la même promesse à leurs électeurs, comme à Bordeaux ou à Nantes. L’opposition à la 5G a aussi pris un tour plus musclé, avec des incendies d’antennes-relais par des activistes, comme celle de Foncine-le-Haut, dans le Jura, attaquée au cocktail Molotov mi-avril. Rarement la mise en place d’une nouvelle technologie aura suscité autant de tensions.

Ses partisans y voient un outil stratégique, tandis que ses opposants critiquent une course effrénée à l’innovation entraînant un accroissement de l’empreinte écologique des nouvelles technologies. Malgré ces multiples contestations, son déploiement est désormais bel et bien acté en France : les enchères pour l’attribution des fréquences d’ondes empruntées par la 5G auront lieu à la fin du mois de septembre et les opérateurs télécoms devraient proposer les premiers forfaits d’ici la fin de l’année.
Dangereuse pour la santé ?
Concrètement, qu’est-ce que la 5G ? Comme son acronyme l’indique, il s’agit de la cinquième génération de la technologie des réseaux mobiles, qui va venir compléter la 3G et la 4G. Cette technologie est cependant davantage qu’une simple amélioration des versions précédentes.
Les performances en matière de débit devraient être multipliées au minimum par dix et le temps de latence divisé d’autant. Avec pour résultat qu’un plus gros volume de données – le carburant qui anime nos écrans d’images, de textes ou de sons – pourra circuler plus rapidement. De quoi ouvrir de larges horizons pour de futurs services, comme la voiture connectée, la téléchirurgie ou encore les systèmes de ville dite « intelligente », promettant d’optimiser la gestion de différents réseaux urbains (eau, électricité, trafic routier, etc.).
Une des caractéristiques de la 5G est de se déployer sur des bandes d’ondes plus haute fréquence, en l’occurrence la bande de 3,5 GHz dans un premier temps. Si la haute fréquence permet de faire transiter un volume de données plus important, elle a cependant pour inconvénient d’offrir un signal moins résistant. Celui-ci se propage en effet sur un rayon plus réduit et se heurte à davantage d’obstacles, comme les murs ou les fenêtres. Ainsi, pour couvrir le territoire, la 5G demande davantage d’antennes que les versions antérieures.
Fréquence d’ondes plus élevée et multiplication du nombre d’antennes, un cocktail idéal pour attiser un peu plus l’inquiétude de ceux qui mettent en cause l’effet de ces ondes électromagnétiques sur notre santé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tout comme les autorités sanitaires françaises répètent toutefois qu’un tel effet n’a jamais été prouvé scientifiquement. Cette réponse ne convainc pas les opposants qui revendiquent le principe de précaution.
Energivore ?
Autre reproche adressé à la 5G : son caractère énergivore. Un enjeu majeur à l’heure où les pouvoirs publics commencent à se rendre compte que le numérique n’a rien d’immatériel et repose sur une infrastructure physique boulimique en énergie. Au niveau mondial, celui-ci représente 10 % de la facture d’électricité et près de 4 % des émissions de gaz à effet de serre. Des émissions qui pourraient doubler d’ici à 2025 pour atteindre 8 %, si une stratégie de sobriété énergétique n’est pas appliquée.
La 5G, c’est la promesse de gains d’efficacité énergétique, affirment les opérateurs télécoms. « Pour un même volume de données, la 5G consomme beaucoup moins d’énergie que la 4G », résume Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms (FFT). Les promoteurs de cette technologie vantent également les fonctionnalités plus économes des antennes-relais, et notamment leur faculté à se mettre en veille en cas de non-activité et ainsi de moins consommer d’énergie.
Mais si les gains d’efficacité énergétique de cette technologie sont réels et importants, ils risquent de ne pas compenser la hausse du trafic de données, qui double déjà tous les deux ou trois ans. « On estime que d’ici à 2030, les gains d’efficacité énergétique permis par la 5G vont être multipliés par dix, mais dans le même temps, le trafic de données augmentera de 100, voire davantage », explique Gauthier Roussilhe, designer et auteur d’un rapport sur cette technologie 1.
« Les conséquences environnementales de la 5G dépendront de ce qu’on fera de ce réseau ; si nous ne faisons rien et laissons le trafic augmenter, oui, il est possible qu’il y ait une hausse de la consommation énergétique, mais ce n’est pas cette technologie qui la produit et ce n’est pas certain », tempère Sébastien Soriano, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).
Pourquoi de telles prévisions alarmantes ? Car pour évaluer au mieux l’impact énergétique de la 5G, il faut également prendre en compte l’effet rebond, qui devrait amplifier l’augmentation observée actuellement. Ce phénomène s’observe dès qu’une amélioration permet à un produit ou un service de mobiliser moins d’énergie : au lieu de stabiliser leur usage et donc de diminuer la facture énergétique, on constate au contraire une intensification entraînant in fine une plus grande consommation d’énergie.
« C’est un phénomène qui s’auto-alimente, la 5G provoquera une accélération de l’augmentation du trafic », résume Hugues Ferreboeuf, du Shift Project. Selon ce think tank, qui milite pour une économie bas carbone, la 5G devrait multiplier la consommation énergétique des opérateurs par 2,5 ou 3.
Autre point noir, le déploiement de la 5G va déclencher un tsunami de renouvellement des équipements, et d’abord des smartphones. En effet, nos outils numériques ne sont pas équipés pour la capter, puisque ce standard technologique n’était pas défini au moment de leur conception. « La 5G risque donc d’accélérer l’obsolescence des smartphones 4G, avec le renouvellement de plusieurs millions de ces outils rien qu’en France », prévoit Frédéric Bordage, fondateur de la communauté Green IT.
De quoi faire bondir un peu plus la production de leurs composants, les métaux rares, dont l’extraction nécessite quantité de substances chimiques et d’énergies fossiles. Au total, leur fabrication est responsable des deux tiers de l’empreinte carbone du numérique des Français, qui représente elle-même 2 % des émissions du pays 2.
Nocive pour la planète ?
Mais au fond, a-t-on vraiment besoin de la 5G ? Elle devrait d’abord servir à absorber la croissance du trafic mobile, aujourd’hui tirée par celle de la vidéo en ligne. Cette dernière représente les deux tiers du trafic total, et les grandes plates-formes américaines pèsent une part substantielle du trafic français : 23 % pour Netflix et 15 % pour Google et sa filiale YouTube.
Submergés par la quantité croissante de données qu’injectent sur le réseau ces grandes plates-formes qui proposent des résolutions d’images toujours plus élevées, les opérateurs télécoms, comme Orange ou SFR, devraient retrouver un peu de marges de manœuvre grâce à la 5G sur le réseau mobile dans les centres urbains où se concentre la consommation. En forçant un peu le trait : la 5G permettra surtout de regarder dans de meilleures conditions une série Netflix au format 4K (ultra haute définition) en attendant son bus.
Dans un second temps, la 5G accompagnera l’explosion d’objets connectés de toutes sortes, des millions qui rejoindront le réseau, appelés à devenir des milliards. « Cette focale sur la 5G, qui est seulement une évolution des réseaux, ne devrait pas nous faire oublier les véritables enjeux environnementaux du numérique que sont la multiplication des terminaux et l’avènement de l’Internet des objets », alerte Sébastien Soriano, à la tête du gendarme des télécoms.
De la montre connectée aux capteurs sur un lampadaire pour assurer un éclairage uniquement quand il y a un passant, une multitude d’objets reliés au réseau devraient envahir nos logements et nos infrastructures d’ici quelques années. Or, la production de ces équipements pose les mêmes problèmes que celle de nos smartphones, mais sur une échelle bien plus importante. Si certains peuvent permettre une économie d’énergie à l’usage, en mesurant une demande réelle pour s’y adapter, quantité d’autres relèvent du gadget ou de l’ajout d’une surcouche numérique à des objets sans valeur ajoutée réelle, du réfrigérateur jusqu’aux lunettes. Le tout risque d’être créateur de nouveaux usages, accroissant encore la demande d’énergie et de matières premières.
Nouveaux usages, explosion du trafic : la 5G apparaît difficilement synonyme de sobriété. Elle illustre parfaitement l’impensé environnemental du numérique : à l’heure de son déploiement, aucune étude analysant son empreinte écologique n’a encore été réalisée. Mener le débat sur l’encadrement des nouvelles technologies apparaît pourtant urgent, avec ou sans la 5G.
- 1. Voir « La controverse de la 5G. Comprendre, réfléchir, décider ensemble », avril 2020
- 2. Selon une étude réalisée par le cabinet Citizing, commandée par le Sénat.
Le réseau 5G couvrira 430 millions de Chinois d’ici 2025