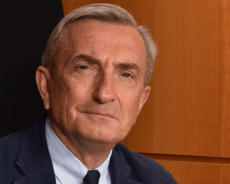Ahmed Rouadjia est professeur des universités et directeur du Laboratoire d’études historiques, sociologiques et des changements sociaux et économiques, à l’université de M’sila. Dans cette interview, le professeur souligne que le rapport de Stora se révèle être un plaidoyer retors en faveur d’une «réconciliation» de la France avec elle-même et en même temps une négation quasi complète de ses forfaits en Algérie. Et d’ajouter: Stora a mis sur le même plan les actes des combattants du FLN/ALN et ceux de l’armée coloniale.
L’Expression: Que pensez-vous du rapport Stora concernant la réconciliation des mémoires entre la France et l’Algérie?
Ahmed Rouadjia: Ce rapport de 146 pages est une compilation fade et insipide, un remplissage, de ce qui a été dit et redit depuis 60 ans sur les relations algéro-françaises, et franco-algériennes. Il comporte, en outre, une vision à la fois unilatérale et partiale. Car il met sur le même plan victimes et bourreaux, colonisateurs et colonisés, spoliateurs et spoliés, tortionnaires et suppliciés.
Des officiers tortionnaires comme Aussaresses et consorts auraient été «traumatisés» par la guerre d’Algérie de la même façon que les torturés et les pendus nationalistes, tels Larbi Ben M’hidi et Me Ali Boumendjel. Stora verse dans le réductionnisme et l’amalgame lorsqu’il écrit: «La représentation du passé n’est pas un acte anodin quand il s’agit de la guerre d’Algérie, touchant à plusieurs groupes de personnes traumatisées (soldats, officiers, immigrés, harkis, pieds-noirs, Algériens nationalistes); et quand ces représentations entrent en contradiction avec des discours dominants, officiels.» (p.5) En mettant tout ce monde bariolé, aux trajectoires heurtées, dans le même «panier», M.Stora évacue d’un trait de plume les actes génocidaires commis par la soldatesque coloniale (le général Bugeaud[1], le capitaine Pélissier..), et plus tard, par Massu, Aussaresses, Maurice Papon, et quantités d’autres criminels de guerre.
Cet auteur qui s’est revêtu de couleurs politiques diverses (trotskiste, socialiste, libéral…) avant de s’imposer à la fois comme le conseiller favori du «Prince» et comme la coqueluche des médias franco- algériens, est un personnage d’autant plus ambigu que ses écrits sur l’Algérie, dont il a fait sa chasse gardée, ménagent la chèvre et le chou. Dans ce rapport, comme dans tous ses écrits prolifiques, il s’efforce de gagner les bonnes grâces des deux gouvernements, français et algérien. Tout en critiquant l’oblitération de la mémoire française, l’oubli[2], il se garde bien de qualifier de crimes l’entreprise génocidaire conduite par la France coloniale tout au long de 130 ans de domination.
Malgré ce double jeu dont il fait preuve, l’auteur de ce rapport lesté de voeux pieux auxquels il ne croit pas lui-même, inspire pourtant à notre président une confiance quasi absolue lorsqu’il déclare que Benjamin Stora «est sincère et connaît l’Algérie et son histoire, de la période d’occupation jusqu’à aujourd’hui[3]».
Pourquoi le rapport fait-il abstraction des enfumades des Sbéhas et Dahra, de la torture, notamment lors de la bataille d’Alger, la terre brûlée pratiquée en Kabylie? La torture a été dénoncée la première fois par un historien français (Henri Alleg). Pourquoi l’occulter? Lui-même (Stora en parle, dans ses travaux mais pas dans le rapport).
C’est parce que en sa qualité d’historien de la France officielle, mais qui trouve aussi une bonne réception de ses écrits auprès de certains officiels algériens, mais aussi auprès des «intellectuels démocrates» algériens, Stora se trouve donc dans l’obligation d’éviter les sujets qui fâchent. Parler des femmes, d’enfants et de vieillards enfumés naguère dans les grottes du Dahra, et des Sbéhas, de la torture pratiquée par les paras de Massu, d’Aussaresses, de Trinquier, de Godard et des SAS de Challe, c’est ouvrir la boîte de Pandore du passé douloureux de l’Algérie coloniale. Une telle évocation ne peut que contrarier le projet de «réconciliation» souhaité en juillet 2020 par Emmanuel Macron.
Que signifie la construction d’une statue à l’effigie de l’émir Abdelkader dont chacun connaît l’ambiguïté de ses relations avec la France coloniale après sa reddition? Sur quelle base fait-il sa proposition en choisissant l’émir Abdelkader plutôt qu’un autre?
Cette construction a, pour la France, un sens hautement symbolique. Elle est la marque d’une reconnaissance, d’une dette envers l’Emir, dont elle doit s’acquitter rétrospectivement en érigeant à sa mémoire une statue qui perpétue ses gestes et ses souvenirs. En demandant, après quelques années de captivité, à lui et sa suite, de s’exiler en Orient, et d’y mourir en bon musulman, l’émir Abdelkader avait permis à la France d’avoir les coudées franches et de parachever la conquête de l’Algérie. Fort d’une bourse consistante que la France lui a généreusement accordée à vie, il déposera les armes sans se délester pour autant de son titre de commandeur des Croyants, et dans son exil doré, il laissera derrière lui une Algérie sans cesse insurgée contre l’ordre colonial…
Pourquoi le rapport occulte Fadma N’Soumer, cheikh Aheddad et El Mokrani et les milliers d’Algériens déportés, notamment en Calédonie dont la progéniture revendique encore son appartenance historique à l’Algérie…?
C’est parce que ni le commanditaire de ce rapport- en l’occurrence Macron- ni son rédacteur- Stora- n’ont intérêt à remuer des plaies qui risqueraient de faire capoter leur projet de «réconciliation» qui consiste à caviarder tous les aspects choquants de la colonisation. Parler des chefs des insurgés que vous citez, et des affres de la torture infligée à des milliers d’Algériens pendant la guerre d’indépendance, c’est faire preuve d’ amende honorable, chose que la France n’est pas prête à faire. L’auteur de ce rapport, qui s’entiche par ailleurs d’impartialité, passe complètement sous silence les exécutions sommaires, la torture des militants avérés et des suspects, des camps de regroupement dignes des méthodes nazies dont les juifs ont souffert tant et plus…Pas un mot sur «la gégène» pratiquée sur une grande échelle lors de la bataille d’Alger de janvier 1957; pas un mot sur le sort qui a été réservé à Larbi Ben M’hidi et à Me Ali Boumendjel par les paras de Massu, et de son exécutant, Paul Aussaresses…
Que signifie la proposition d’absoudre les harkis de leur trahison alors que c’est la France qui les a abandonnés?
Pour l’auteur de ce rapport, les victimes de la guerre d’Algérie ne sont pas seulement les Algériens musulmans; des officiers et des soldats français, des harkis par milliers, des juifs, des pieds-noirs, l’ont été également. Tout ce monde est réductible au même dénominateur. Il met, par ailleurs, sur le même plan les actes des combattants du FLN/ALN et ceux de l’armée coloniale.
Il s’abrite derrière l’autorité de Harbi pour évoquer «les tabous, liés aux conflits internes du nationalisme algérien, à l’histoire des juifs d’Algérie, aux harkis et aux pieds-noirs. Le fait de ne pas avoir traité ces problèmes a «fait le lit de l’islamisme». Il évalue ainsi le nombre de harkis et goumiers à environ 100 000 hommes et il estime à quelque 50 000 les victimes algériennes des actes du FLN/ALN, dont nombre de militants nationalistes authentiques» (p.8 du rapport).
La réconciliation franco-algérienne, pour Stora, ne doit pas consister en une reconnaissance des crimes commis par les armées coloniales françaises durant l’occupation du pays, mais seulement une dénonciation de certaines «bavures» faites par celles-ci lors de «la pacification». Cette réconciliation passe aussi par la célébration des souvenirs et par des hommages aux soldats morts pour la France en Algérie. C’est pourquoi il cite une allocution de Jacques Chirac en date du 5 décembre 2002 où il dit «Je veux rendre l’hommage de la nation aux soldats morts pour la France en Afrique du Nord, il y a presque un demi-siècle. Ils furent plus de 22 000. Je veux saluer, avec ferveur et gratitude, leur dévouement, leur courage, leur jeunesse sacrifiée. Je veux dire à leurs familles meurtries que nous ne les oublierons jamais.» C’est le message que porte ce mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Jacques Chirac n’a pas oublié, à cette occasion, les harkis.
«Les harkis, disait-il, les membres des forces supplétives, qui ont tant donné à notre pays, ont également payé un très lourd tribut. À eux, à leur honneur de soldats, à leurs enfants qui doivent trouver toute leur place dans notre pays, la France adresse aujourd’hui un message tout particulier d’estime, de gratitude et d’amitié.» (106). Au final, ce rapport se révèle être un plaidoyer retors en faveur d’une «réconciliation» de la France avec elle-même, et en même temps une négation quasi complète de ses forfaits en Algérie, et que la plume de Stora s’évertue vainement à édulcorer…
Kamel LAKHDAR-CHAOUCHE
Une montagne qui accouche d’une souris
Le rapport Stora n’est que le reflet d’un équilibre politique exprimé au niveau d’une France officielle qui n’est pas encore prête à sortir de la tanière des ultras et de leur approche négationniste à outrance.

La mémoire revient avec son lot de passions et de tragédies enfouies dans le subconscient de l’histoire coloniale. La victime et le bourreau s’investissent pour trouver une «forme» plus judicieuse pour réexaminer le long de cette période noire, appelée communément nuit coloniale.
Le rapport Stora qui a été tant attendu, n’a pas répondu à ce qui constitue la pierred’achoppement de la question coloniale et son rapport avec les crimes coloniaux commis en Algérie pendant 132 ans de domination, d’expropriations et de dépossessions multiformes.
Ce rapport volumineux n’a pas pu inclure une phrase toute simple et substantielle en matière de sens et de symbolique, à savoir la dénonciation et la reconnaissance des crimes coloniaux de la France coloniale en Algérie.
Heureusement que beaucoup de Français ne sont pas dupes et ne suivent pas le chant des sirènes au rythme abracadabrant et pétri d’inepties et d’anachronismes. Le cas de l’ancien journaliste de Canal+, Jean- Michel Apathie est plus qu’édifiant sur ce plan, il est allé jusqu’à dénuder les fourberies et les balivernes des ultras qui pèsent de leur poids sur les enjeux stratégiques de la France coloniale. À ce propos, Jean-Michel Apathie n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour qualifier le débat sur les crimes coloniaux en Algérie commis par la France coloniale pour signifier que «la colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Nous ne savons pas pourquoi la France a conquis l’Algérie en 1830. On a volé les terres aux Algériens, on a empêché la scolarisation de cinq générations d’Algériens et on les a condamnés à l’ignorance et à l’analphabétisme», a-t-il souligné.
Entre une opinion publique voulant se débarrasser du fardeau de l’histoire coloniale faite d’ignominie et d’abjection, et les officines dont le rôle est de maintenir la France officielle dans l’approche néocoloniale comme c’est le cas aujourd’hui à travers les forces de pression incarnées par les ultras, il y a un fossé très profond, qui ne peut être rétréci qu’une fois la volonté d’assumer ses crimes coloniaux soit adoptée et dénoncée vertement. L’Algérie officielle et l’opinion publique sont unanimes et homogènes sur cette question qui rappelle un passé récent et tragique de son histoire. De ce fait, le rapport Stora est, lui, de répondre à une seule et unique question des plus basiques, à savoir la dénonciation des crimes et reconnaître la responsabilité politique de la France coloniale, de ses actes et de son «oeuvre» abominable en Algérie contre un peuple qui ne demandait que de vivre dans sa terre avec dignité et fraternité.
La repentance et autres considérations dont le fondement politique n’est pas clair et saillant en matière de prise de position, cela ne règle en rien la question même si on verse dans la sémantique et la phraséologie pompeuse.
Le rapport Stora n’est que le reflet d’un équilibre politique exprimé au niveau d’une France officielle qui n’est pas encore prête à sortir de la tanière des ultras et de leur approche négationniste à outrance quant à l’histoire et au passé sombre de la France coloniale. Il faut sortir de cette logique équilibriste dangereuse qui veut monnayer une injustice et un crime sur fond d’un compromis, voire une compromissions rien que pour sauver l’histoire d’une France jonchée de sang et de crimes contre l’humanité.
On ne peut pas mettre de l’avant des mécanismes pour dissiper les clivages et les conflits que constitue une histoire commune si la question de la volonté politique n’y est pas pour mettre un terme à l’imbroglio et les tergiversations qui entourent ladite histoire commune. L’histoire ne se répète pas, mais elle bégaie.
Hocine Neffah

Le rapport sur Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie que l’historien Benjamin Stora vient de remettre au Président de la République se veut œuvre de mémoire, comme son titre l’indique. Mais il comporte au moins une lacune, étonnante de la part d’un spécialiste reconnu de l’histoire algérienne. Il s’agit du décret Crémieux, qui a eu sur la société algérienne une influence reconnue comme déterminante.
Certes, Benjamin Stora ne manque pas de rappeler au détour d’une parenthèse que le décret en question « avait attribué la citoyenneté à la seule communauté juive en 1870 ». C’est un peu court, comme dirait Cyrano de Bergerac
Rappelons donc que le 24 octobre 1870 a été publié un décret qui dit exactement ceci : « Les israélites des départements d’Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglé par la loi française. » Et c’est signé Ad. Crémieux, L. Gambetta, A Glais-Bizoin, L. Fourrichon.
Le décret a été promulgué à Tours ! Pourquoi pas à Paris ? Parce que c’est dans la tranquille métropole du Val de Loire que s’est réfugié le gouvernement dit de la Défense nationale. Le Second Empire s’est effondré après la défaite humiliante de Sedan, Napoléon III est en fuite. La IIIe République est encore dans les limbes.
La paternité du décret revient à Adolphe Crémieux, ministre de la Justice dans ce gouvernement provisoire, mais aussi président de l’Alliance israélite universelle (AIU) depuis 1863. De plus, Crémieux est depuis 1869 « souverain grand commandeur » du Suprême Conseil de France de la Maçonnerie française.
Nul doute que Crémieux voir dans ce décret un aboutissement de l’œuvre de sa vie : venir au secours de ses coreligionnaires en terre d’islam. C’est aussi l’objectif de l’AIU.
On peut supposer, toutefois, que Crémieux a profité d’une « fenêtre d’opportunité » qui lui était offerte par l’humiliation de l’armée française terrassée à Sedan par la Prusse. Jusqu’à cette débâcle, les officiers français étaient les maîtres absolus d’un territoire algérien qu’ils avaient conquis. S’ils avaient eu encore voix au chapitre en ce fatal automne 1870, ils n’auraient jamais permis l’adoption d’un tel décret qu’ensuite, ils qualifieront d’infâme.
Le décret sera abrogé par Vichy en 1940, puis rétabli après le débarquement des troupes américaines en Afrique du Nord. Quant aux musulmans, ils avaient gardé et garderont leur statut inférieur d’« indigènes ». Il faudra l’atroce guerre d’Algérie pour qu’ils en sortent enfin.
L’enfer est pavé de bonnes intentions, comme on le sait. Certes l’objectif de Crémieux était louable : aider les juifs d’Algérie à sortir d’une misère qui choquait leurs coreligionnaires français. Mais le décret Crémieux a fait haïr les juifs algériens, non seulement par les colons français qui ont sombré à partir de 1870 dans un antisémitisme de plus en plus délirant, mais aussi par les musulmans algériens qui virent d’un seul coup leurs voisins de village ou d’immeubles accéder au statut de citoyen français.
De retour d’un voyage en Algérie, le grand leader socialiste Jean Jaurès écrira dans La Dépêche de Toulouse, du 1er mai 1895 ces lignes odieuses : « Les juifs d’Algérie qui ont été naturalisés [français] en masse […] sont en somme étrangers aux traditions, aux idées, aux luttes de la France [… ] Ils votent en bloc comme des juifs, et ils votent pour les candidats opportunistes parce que l’opportunisme a développé la puissance de la finance et qu’il est ainsi, si l’on peut dire, la forme politique de l’esprit juif [… ] L’influence morale de la France a été tenue en échec, on ne peut le nier, par le développement de la puissance juive ; les indigènes ont la haine des juifs, et ils n’ont pu voir sans scandale que c’est à eux que passait, pour une large part, le gouvernement de l’Algérie et de la France même [ … ]. La conquête française a livré les indigènes aux juifs [ … ] Ainsi le vieux monde arabe est miné par les juifs en même temps que les colons et immigrants sont évincés par eux. Il semblerait qu’une sorte d’accord devrait se produire entre les indigènes et les colons. Il n’en est rien, et c’est là ce qui complique singulièrement le problème. Le Français d’Algérie, s’il a la haine du juif, a le mépris de l’Arabe et il semble bien que l’indigène confonde dans un même mépris le juif et l’Européen ».
Ce tableau que dresse l’un des hérauts du socialisme français à la fin du XIXe siècle explique bien les drames qui vont ensanglanter l’Algérie au siècle suivant. Pour ne rien dire de l’état catastrophique dans lequel se trouve l’Algérie aujourd’hui.
Dans son rapport au Président de la République, Benjamin Stora tend à euphémiser les effets du décret Crémieux « Partagés entre leurs deux patries, la France qui leur a donné l’exercice de la citoyenneté par le décret Crémieux de 1870, et l’Algérie, terre natale où ils étaient enracinés, les Juifs d’Algérie n’ont pas basculé dans le camp de l’indépendance algérienne », remarque-t-il.
Le même Benjamin Stora nous semble plus proche de la réalité historique quand il écrivait en 2006 dans son livre remarquable, Les Trois Exils Juifs d’Algérie, à la page 54 « Du jour au lendemain, ils [les juifs] changent de camp et se solidarisent avec l’envahisseur. »
Quand on veut faire œuvre « mémorielle », quand on déclare : « il faut trouver la juste mémoire », ne doit-on pas se souvenir de ses propres écrits ?
Auteur(s): Philippe Simonnot pour FranceSoir