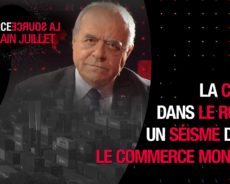![]()


Abdellaziz Ben-Jebria EAN : 9782754769549 112 pages EDITIONS DU PANTHÉON
Quand la fiction, l’autobiographie et l’histoire se mettent au service de la réalité !
Par Arezki Ighemat, Ph.D in economics
Master of Francophone Literature (Purdue University, USA)
–
INTRODUCTION
“Tunisie d’amour, que reste-t-il de tes beaux jours » ? édité chez Panthéon en 2024, est le second ouvrage de Abdelaziz Ben Jebria, auteur Tunisien. Son premier ouvrage, « Les périples de l’enfant de Ksiba » (Edilivre, 2021), était consacré à son enfance dans son village natal de Ksibet-Sousse en Tunisie et de son exil professionnel d’une quarantaine d’années qui l’a conduit successivement en France et aux Etats-Unis. Ce deuxième livre est à la fois autobiographique et descriptif de la réalité socio-économico-politico-culturelle dans sa Tunisie natale depuis la « pseudo-révolution » (comme il l’appelle) de 2010/2011, l’étincelle qui a déclenché une série de révoltes dans les pays de la région et qu’on appellera les « printemps arabes ». Usant de la fiction—le livre est en effet considéré comme un roman—de l’autobiographie (l’auteur n’est autre que Sawwah, le personnage principal du livre) et de l’Histoire (l’auteur décrit d’une manière chronologique les faits qui se sont produits depuis 2010, année de sa retraite de Penn State University, où il a été, pendant une vingtaine d’années, chercheur de haut niveau dans le domaine biomédical)—l’auteur décrit, de façon approfondie, la situation de la Tunisie depuis 2010. Bien qu’il ne soit pas spécialiste en sciences sociales—sa spécialité est la biochimie des voies respiratoires—il ne reste pas moins que l’analyse qu’il fait de l’évolution de son pays natal depuis cette date n’a rien à envier à celle que ferait un spécialiste des sciences sociales. Il faut tout de même rappeler que la littérature et la poésie (française et arabe) étaient en quelque sorte son premier amour avant qu’il s’embarque dans les sciences biomédicales où il atteint une renommée internationale. La littérature, la poésie, et par suite l’écriture, sont, pour lui, une sorte de catharsis—même si il sait que c’est pour un moment seulement—contre la déprime qui le ronge après le spectacle désolant qu’il a observé à son retour au pays natal au moment de sa retraite. Cependant, en dépit de cela, l’auteur demeure optimiste sur un éventuel retour de sa Tunisie adorée à l’ère euphorique du président Habib Bourguiba, même s’il reproche à ce dernier (comme on le verra plus loin) de n’avoir mis en place un processus graduel devant mener la Tunisie sur la voie de la démocratie. Le livre de Ben Jebria est un mix judicieux de fiction, d’autobiographie et d’Histoire et s’articule en quatre chapitres : (1) Le retour traumatisant de Sawwah ; (2) Le désarroi de la politique du présent ; (3) Le constat navrant d’un vagabondage cuisant ; et (4) Le refuge du passé lénifiant. Dans la suite de cet article, nous reprendrons les idées avancées par l’auteur dans chacun de ces chapitres, mais nous nous sommes permis de le faire sous d’autres titres.
LA TUNISIE APRES LA « PSEUDO » REVOLUTION DE 2010/2011
Dans le premier chapitre, intitulé « Le retour traumatisant de Sawwah », l’auteur raconte les impressions et les observations de Sawwah (son protagoniste), depuis son retour au pays natal, sa Tunisie adorée, en 2010, après sa retraite. Le constat que fait Sawwah de la situation dans le pays, comme l’indique l’intitulé du chapitre, est « traumatisant ». Jusqu’à ce jour, il pensait que, avec la « Révolution du Jasmin » de 2010/2011, la Tunisie se remettrait sur la voie du développement et de la démocratisation. En effet, Sawwah « pensait que c’était là, peut-être, une opportunité et une raison d’espérer que les beaux jours reviendraient sur sa terre natale adorée » et « croyait même que le pays était en voie de se diriger vers une douce, paisible et fraternelle démocratie qui serait pratiquée au sein d’une société historiquement laique, coutumièrement ouverte, et traditionnellement tolérante » (pp.12-13). Cependant, au lieu de cela, le pays s’était engouffré dans une série de crises multiformes et multisectorielles et « n’accouchait que du dogme islamique, de la violence terrifiante envers les dirigeants charismatiques, de l’incompétence, du dirigisme systémique, de la corruption de la fonction publique et de la misère économique » (pp.16-17). Un des effets négatifs de la Révolution du Jasmin—que l’auteur qualifie de ‘pseudo’ révolution—est l’émergence d’un « obscurantisme ‘politico-religieux’ dans lequel « les nouveaux conquérants musulmans qui ont pris le pouvoir dans le pays après 2011, ont ainsi voulu changer la configuration de l’Islam tolérant qui y régnait pour le remplacer par une ‘religion rudimentaire’ et ultraconservatrice qui promettait un mode vestimentaire dépourvu d’esthétique, une vogue inélégante et une pratique de la foi pompeusement ostentatoire et bruyante » (p. 21). L’autre effet négatif dont a accouché la Révolution de 2010 est la vague de répression qui s’est accentuée au cours des récentes années et qui se manifeste par « des chasses aux sorcières virtuelles et…des attaques réelles de la part des réseaux sociaux intimidants qui stigmatisent les non-pratiquants, les non-croyants et les amateurs du bon vin alléchant et plaisant que Sawwah appréciait depuis longtemps » (p.22). L’auteur cite, entre autres, la vague de violence qui s’est abattue sur le pays depuis la prise du pouvoir par les Islamistes, notamment le massacre du 7 mars 2016 dans la ville de Ben Gerdane où 13 membres des forces de l’ordre et des civils ainsi que 49 terroristes ont été tués. Il dira que cette violence s’est étendue à certaines écoles coraniques qui s’adonnaient à des activités extra curriculaires et où « on inculquait les principes de l’Islam radical et [où] on embrigadait les enfants pour les faire travailler aux champs agricoles tout en leur faisant subir divers abus d’agressions sexueles et de viols en toute impunité sous l’œil fermé de l’autorité publique… » (p. 33). L’auteur parle aussi des séquelles de la Révolution de 2010 sur l’économie et la société tunisiennes qu’il résume en la qualifiant « d’ébauche de la misère au quotidien ». Il souligne particulièrement le « gap » (le fossé) entre le gonflement de la fonction publique et la faible productivité dans les secteurs vitaux de l’économie et la tendance à la construction d’édifices religieux au lieu de pôles de production de biens et services utiles à la population. Il compare les dépenses faramineuses dans le secteur religieux aux taux de chômage de 40% et au niveau de pauvreté de 30% atteint par le pays. Il parle aussi de la « harga » (du mot arabe « brûlure »), ce flux de migrants Tunisiens vers les pays de l’Europe du Sud, « un phénomène d’exode migratoire clandestin qui s’est généralisé depuis la ‘pseudo révolution’ où près de 15 000 Tunisiens tentaient annuellement de joindre, illégalement et dangereusement, les côtes européennes dans l’espoir d’accomplir un rêve qui résoudrait leurs misères du présent » (p. 37).
L’ECHEC DES REFORMES POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES
Dans le second chapitre, « Le désarroi de la politique du présent », l’auteur parle des élections présidentielles de 2019 qui ont eu pour résultat l’accession et l’ascension de Kais Saied à la Magistrature Suprême du pays et à l’élimination du candidat concurrent, Nabil Karoui. L’auteur aborde ensuite la question de la Constitution du 25 juillet 2022 qui été, selon lui, fabriquée en laboratoire clos, ignorant totalement le projet de Constitution élaboré par deux éminents constitutionalistes Tunisiens à la demande du Kais Saied lui-même. Il parle aussi des élections législatives du 17 décembre 2022 qui excluait la participation des partis politiques d’opposition ainsi que la décision du nouveau président de « remplacer les conseils communaux élus par des fonctionnaires placés immédiatement sous la tutelle du gouverneur de chaque région » (p. 53). L’auteur cite aussi la décision du président de réviser la loi sur les élections des conseils communaux, disant que « ce faisant, il [le président] s’attaque ainsi au maillon local, et par la-même, à la structuration régionale, comme il l’entend, sans négociation » (p.55). En outre, le président provoque une véritable crise diplomatique lors de son discours du 21 février 2023 dans lequel il fustigeait les immigrants africains « en criant hors et fort que ces ‘hordes’ clandestines subsahariennes étaient une ‘fontaine’ de violence, de crimes et de pratiques inacceptables relevant d’une ‘entreprise criminelle’ qui vise à « modifier la composante démographique de la Tunisie pour lui supprimer intentionnellement son ‘identité arabo-islamique » (p. 56). Et, comme une cerise sur le gâteau, le président a engagé, selon l’auteur, une véritable guerre contre les journalistes des médias écrits et audiovisuels et contre la liberté d’expression en général. C’est ce qu’il a fait, notamment, lors de l’ouverture de la session plénière de la nouvelle Assemblée Nationale le 13 mars 2023 « où on s’est permis d’interdire aux médias privés et étrangers l’accès à son enceinte ; mais que seuls les journalistes des médias publics, travaillant sous la tutelle de l’Etat et obéissant à ses directives, furent autorisés à pénétrer » (p.57). L’auteur passe ensuite à la situation économique et sociale de la Tunisie qui est, selon lui, celle d’un marasme généralisé touchant toutes les activités et les secteurs. Pour souligner la gravité de la situation dans ce domaine, il compare la Tunisie à la Corée du Sud. Il dira que, après près de 70 années d’indépendance, la Tunisie est toujours classée comme économie « sous-développée » tandis que la Corée du Sud s’est hissée au rang de « pays émergent » et est citée comme modèle d’un « take off » économique réussi. Il indique ensuite les facteurs qui peuvent expliquer ce « gap ». L’un d’eux est la corruption qu’il qualifie de « cancer typique de la société tunisienne et…un des principaux inhibiteurs de sa prospérité économique et…un facteur déterminant de ses vénaux hommes politiques » (p.32). La seconde explication du retard de la Tunisie est, selon l’auteur, d’ordre culturel. Il dira, à ce propos, que « Les Coréens et Coréennes sont des patriotes exemplaires qui aiment potsser et qui travaillent efficacement presque vingt-quatre heures sur vingt-quatre en se relayant, alors que les Tunisiens, surtout les hommes, passent la plupart de leur temps sur les terrasses des cafés en fumant du tabac et en aspirant des chichas à longueur de journée » (p.63). A la lumière de cette comparaison, Ben Jebria pose la question de savoir « Si un jour les Tunisiens apprendront à suivre l’exemple des Sud-Coréens et comprendront que la nonchalance et la paresse sont les voies de la décadence alors qu’aimer travailler est un acte vital d’épanouissement social, une voie culturelle de prospérité sociétale, et un désir de participation citoyenne au développement du pays natal » (p. 64).
UN DESEQUILIBRE REGIONAL FRAPPANT
Dans le troisième chapitre, sous le titre de « Le constat navrant d’un vagabondage cuisant », l’auteur raconte ses randonnées dans deux régions de la Tunisie : Sousse (la « citadine ») et Chografia (la « localité agricole »), cette dernière se situant dans le gouvernorat de Sbikha, à une centaine de kilomètres de Sousse et à une quarantaine de kilomètres de Kairouan. La première, dit-il, est dans un état de délabrement déplorable et la seconde est en plein épanouissement. Dans la première région, se trouve le lycée où il a fait ses études secondaires et dont il a gardé des souvenirs inoubliables. Quand il a vu l’état où se trouvait son lycée, il écrira « Hélas, aujourd’hui, cette chère annexe…est la résidence des rats, des souris et lézards et le lieu de métamorphose des insectes et de tissage de toiles d’araignées » (p.66). Il ajoute « Elle [l’annexe] est, en effet, envahie par ces petits mammifères-rongeurs et reptiles et abandonnée en ruine » (p.66). En se baladant du côté de la plage, l’auteur constatera que la situation n’est pas meilleure : « On ne peut voir actuellement que des hôtels agonisants, des débris et des détritus qui témoignent de la névralgie faciale de cette corniche qui était la fierté de la Perle du Sahel » (p.68). Sa deuxième randonnée le mène dans la région de Chografia, une région agricole, surtout d’oliveraies. Là, il a vu un paysage complètement opposé à celui qu’il a observé à Sousse et qui, dit-il, donne à espérer. Il raconte que « Sawwah a pu contempler ces jeunes oliviers chargés de leurs fruits noirs et violets et respirer l’air frais de la campagne ensoleillée en cette belle et douce saison d’olivaison » (p.70). Comparant les deux régions visitées, il dira : « Mais le contraste est frappant : Sousse, la citadine, s’endort sous ses décombres et ses ruines, et Kairouan, la rurale, se redresse par sa jeune oléiculture qui procure une petite richesse » (p.70). L’auteur aborde ensuite deux autres sujets inquiétants pour l’avenir de la Tunisie : l’exode rural et l’exode vers le sud européen. Parlant du premier, il dira « qu’il vide les campagnes et disloque les familles restantes » (p.76). Cet exode est à la fois une cause et un effet du processus d’urbanisation à outrance dans lequel la Tunisie s’est embarquée ces dernières décennies. L’autre exode, plus grave celui-là en termes humains, est celui des Tunisiens qui quittent le pays à la recherche d’un éden rêvé, phénomène appelé communément « harga » (acte consistant à « brûler » les frontières). Ce rêve, dira l’auteur, ne se réalise malheureusement pas pour tous les « haragas » (ces migrants illégaux). En effet, selon lui, « c’est une traversée internale qui se termine, pour certains des voyageurs, par une descente aux enfers dans les profondeurs de la mer, ou pour d’autres, par une série de rejets, d’humiliations, de maltraitance et d’expulsion » (p.76). L’auteur explique cette mésaventure en disant « C’est bien le reflet de l’absence de perspectives au sein d’une Tunisie en mal de politiques éclairées » (p.76).
BOURGUIBA, LE BATISSEUR QUI A MISE SUR UN SEUL « D » : DEVELOPPEMENT, ET OUBLIE LE SECOND « D », ESSENTIEL : DEMOCRATIE
Le quatrième et dernier chapitre, « Le refuge du passé lénifiant » est celui où Abdelaziz Ben Jebria rend hommage à Habib Bourguiba, celui qu’il considère comme le président le plus « éclairé » de tous ceux que la Tunisie a eus jusqu’à présent. Il parle de ses réalisations grandioses dans tous les secteurs de la vie sociale, notamment : le planning familial, l’éducation nationale, l’émancipation de la femme, en particulier l’adoption du Code du Statut Personnel, qui reconnaît à la femme des droits jusque-là refusés, le rôle qu’il (Bourguiba) a joué sur la scène internationale, notamment concernant la question Palestinienne, et tant d’autres accomplissements. Il considère que Bourguiba est le président qui a posé les bases matérielles et institutionnelles et les principes moraux devant conduire la Tunisie vers un développement durable et vers la stabilité. Il va même jusqu’à dire que s’il avait pu continuer son travail de direction du développement du pays, la Tunisie ne serait pas arrivée au niveau de détérioration qu’elle a atteint. Cependant, en dépit de toutes ces réalisations positives, l’auteur reprochera une chose—une seule, dit-il—Bourguiba a raté le train de la démocratisation de la vie politique et sociale du pays. S’adressant à lui, il dira : « Pourtant, toi le pédagogue, le pragmatique, et le convainquant, tu aurais pu instiller progressivement, chaque année, rien que cinq pour cent de cette DEMOCRATIE pour atteindre, au bout de vingt ans, la pleine croisière de cent pour cent » (p.93). L’auteur considère, en effet, que les deux « D »–Développement et Démocratie—sont les conditions indispensables pour que la Tunisie—mais pas seulement—atteigne un niveau de croissance économique durable et un bien-être social satisfaisant. En d’autres termes, il reproche au Président Bourguiba d’avoir marché sur un seul pied—le développement—et de n’avoir pas utilisé le deuxième pied : la démocratisation du pays.
Dans le même chapitre, l’auteur raconte aussi ses souvenirs du temps où il était dans son école de Ksibet-Sousse, l’admiration qu’il portait à ses instituteurs, notamment son enseignant de littérature et de poésie, qui a semé en lui cet amour pour la lecture et l’écriture dans les deux langues, française et arabe. Il considère que la connaissance de ces deux langues est un bon moyen pour une bonne formation intellectuelle, et c’est ainsi qu’il a introduit dans son livre—qui est primordialement écrit en langue française—des phrases et des poèmes en arabe. Il termine son roman autobiographico-historique par la visite de son village de Ksibet-Sousse qu’il nous décrit quartier après quartier, un village qu’il qualifie de « paisible » et de « communautaire ».
CONCLUSION
Si Abdelaziz Ben Jebria est aussi « critique » de la situation où son pays natal est arrivé et aussi « dur » avec ceux qu’il accuse d’en être responsables, il ne reste pas moins qu’il garde l’espoir qu’à un moment donné dans le futur—qu’il espère proche—un sursaut miraculeux se produira qui remettra le pays sur les rails d’un vrai développement et de la démocratisation qu’il envisage non pas comme un point à atteindre mais plutôt comme un processus graduel. Ce sursaut, selon lui, ne pourrait venir que de la jeunesse Tunisienne qu’il considère comme la seule force à même de faire changer les choses dans la bonne direction. Il dira, en parlant de ce changement et du rôle de la jeunesse, que la Tunisie « ne sera épargnée, ménagée et sauvée que par sa jeunesse qui s’éveillera et résistera à cette époque calamiteuse et la protègera contre les radicalisés du présent qui désirent sa déchéance, son déclin, et son retour au Moyen-Age » (pp.86-87). Il posera cependant une condition sine qua non pour que ce changement puisse avoir lieu : « La jeunesse, oui, mais une jeunesse éduquée, assoiffée de savoir, et tournée ambitieusement vers l’avenir » (p.90), un peu à l’instar de la jeunesse Sud-Coréenne./
 Commentaire :
Commentaire :
Le critique Arezki Ighemat offre une analyse approfondie et élogieuse de l’ouvrage « Tunisie d’amour, que reste-t-il de tes beaux jours ? » de Abdelaziz Ben Jebria. Il souligne la manière dont l’auteur mélange habilement fiction, autobiographie et histoire pour dépeindre la réalité socio-économico-politico-culturelle de la Tunisie post-révolution. L’utilisation de ces différents genres permet à Ben Jebria de présenter une analyse complète et nuancée de la situation actuelle de son pays natal, malgré le fait qu’il ne soit pas spécialiste en sciences sociales.
Ighemat met en lumière la capacité de Ben Jebria à décrire les effets négatifs de la révolution de 2010/2011, tels que l’émergence de l’obscurantisme politico-religieux, la vague de répression et la violence qui ont secoué le pays. L’auteur n’hésite pas à critiquer les dirigeants politiques et les décisions prises depuis la révolution, tout en exprimant son optimisme quant à un éventuel retour de la Tunisie à l’ère euphorique du président Habib Bourguiba.
L’analyse d’Ighemat révèle également la nostalgie de Ben Jebria pour le passé, en particulier pour l’époque de Bourguiba, qu’il considère comme le président le plus éclairé de tous ceux que la Tunisie a eus jusqu’à présent. Cependant, Ben Jebria reproche à Bourguiba de ne pas avoir mis en place un processus graduel de démocratisation, ce qui aurait pu éviter certains des problèmes actuels du pays.
En conclusion, Arezki Ighemat loue le travail de Abdelaziz Ben Jebria pour son approche unique et son analyse perspicace de la situation en Tunisie. Il souligne également l’importance de l’éducation et de la jeunesse pour surmonter les défis auxquels le pays est confronté. Cette critique met en évidence la valeur de l’ouvrage de Ben Jebria en tant qu’outil pour comprendre les enjeux complexes auxquels la Tunisie est confrontée aujourd’hui.
Farid DAOUDI