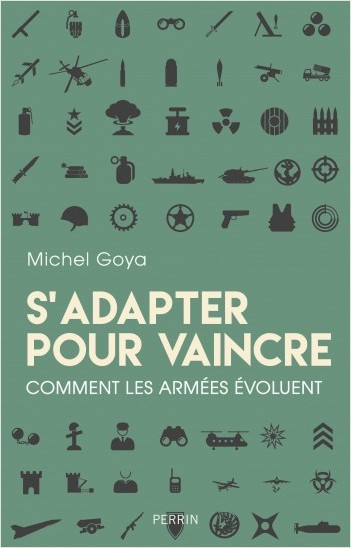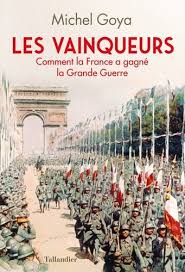[RussEurope-en-Exil] Comment les armées s’adaptent pour vaincre (ou pas) ; analyse du dernier livre de Michel GOYA, par Jacques Sapir
Michel GOYA vient de publier un ouvrage important sur les processus d’adaptation des armées[1]. Cet ouvrage fait suite à d’autres, touts aussi important, comme celui qu’il consacra à la mort en opérations militaires[2]. L’ouvrage prolonge le cours qu’il donna à Sciences-Po.
L’auteur, ancien militaire, ancien officier des troupes de Marine, devenu universitaire, était particulièrement bien placé pour ce faire. Il inscrit sa démarche dans une réflexion large sur les processus d’évolution des institutions. La volonté de l’auteur de se décentrer, de sortir de sa zone de confort pour entrer sur des terres moins connues, celles de la sociologie de l’innovation par exemple, doit être salué. Les armées sont des institutions, et elles doivent être appréhendées avec les outils de l’analyse institutionnelle. Ce sont aussi des institutions particulières ; leur domaine d’action implique donc de joindre aux disciplines traditionnelles une connaissance des doctrines, des moyens, et de leur interaction avec les autres disciplines. La couverture de différents champs est l’une des caractéristiques de cet ouvrage. Elle permet des comparaisons de méthodes. Le livre, qui intéressera un très large public, peut se lire à divers niveaux : de celui du citoyen intéressé à celui de l’historien en passant par celui du spécialiste de la chose militaire. C’est pourquoi il doit être salué comme une des lectures qui s’impose aujourd’hui.
La naissance de l’armée moderne ?
Les deux premiers chapitres portent sur deux cas d’évolution qui sont ainsi mis en perspective réciproque. Le premier concerne l’armée prussienne, qui est obligée de se renouveler et de se réinventer après les défaites en 1806 de Iéna et d’Auerstaedt face à Napoléon. Michel Goya montre le caractère global et total du changement à effectuer. L’armée prussienne était restée impassible devant la révolution sociale et militaire engendrée par la Révolution de 1789 dont Napoléon est l’héritier. Car, il s’agit bien des débuts d’une « révolution dans les affaires militaires » auxquels on assiste avec la Révolution de 1789, comme Karl Marx et Friederich Engels l’ont noté[3]. La nature des armées change fondamentalement avec la conscription. Mais, la possibilité d’employer des armées « massives » implique aussi un changement dans le mode de commandement, et ce point n’est peut-être pas assez souligné. Ce seront les « corps d’armée » qui donneront à l’armée napoléonienne une part de sa souplesse. Le point est développé par un autre auteur que, malheureusement, Goya ne cite pas, et qui a produit une étude lumineuse sur l’interaction entre les modes de commandement et la nature des informations à gérer[4].
Qu’importe cependant ; l’auteur montre bien en quoi la transformation de l’armée prussienne est radicale. Il s’agit d’une transformation sociale, d’une transformation dans les modes de commandement, d’une transformation cognitive aussi avec la création de l’Etat-Major prussien, qui dominera par la suite le fait militaire pour près d’un siècle. Cette transformation ira de paire avec celle de la société prussienne. Ne dira-t-on pas, après la bataille de Sadowa lors de la guerre Prusso-Autrichienne, que le véritable vainqueur était l’instituteur prussien ?
De cela émergera une machine à gagner des batailles, une machine incontestablement supérieure aux autres dans le domaine tactique ; mais aussi une machine à perdre des guerres. Car, fors la guerre Prusso-Autrichienne de 1866 et celle Franco-Prussienne de 1870-1871, l’armée prussienne et sa descendante, l’armée allemande « nazifiée », montrera une incapacité à saisir les contextes stratégiques dans lesquels elle doit pourtant se mouvoir. Cela aboutira à deux défaites majeures, l’une en 1918 et l’autre en 1945. Une partie, de plus, de sa redoutable efficacité provient d’une base industrielle puissante sur laquelle elle peut s’appuyer à partir de la seconde moitié du XIXème siècle.
La démonstration que produit Goya est donc implacable. Il montre comment la délégation d’autorité aux échelons inférieurs, délégation qui n’est pas contradictoire avec une discipline de fer, permet l’ajustement rapide des moyens aux objectifs tactiques. Il note la potentialité de cette armée à monter les échelles de la violence de manière rapide. Il néglige cependant le contenu potentiellement génocidaire de cette montée dans la violence, comme l’a montré le livre d’Isabel Hull[5].
LA MUTATION DE L’ARMEE FRANCAISE
A cette évolution répond celle de l’armée française durant la guerre de 1914-1918 qui n’est pas moins remarquable. Ce chapitre est fascinant car il fait exploser nombre de mythes qui sont entretenus dans l’enseignement en France. L’armée française arrive mal préparée à la première guerre mondiale ; son expérience est, majoritairement, celle de guerres coloniales où l’adversaire ne déploie pas l’intensité et la densité de feu qu’il faudra affronter en 1914. En fait, de 1860 à 1914, les moyens techniques (fusils à tir rapide et précis, mitrailleuses), ont fait mentir l’adage attribué au général Souvorov et qui avait dominé les guerres napoléoniennes : « la balle est folle ; seule la baïonnette sait ce qu’elle fait »[6]. Mais, très rapidement, un processus d’adaptation s’enclenche. Michel Goya montre que l’armée de la contre-offensive de la Marne n’est déjà plus celle de la bataille des Frontières du mois d’août. Cette adaptation n’est pas seulement l’expérience du feu. C’est aussi le produit, et le terme est ici important, de dizaines « d’entrepreneurs militaires » qui vont innover à leur niveau pour améliorer grandement l’efficacité de l’armée. C’est aussi le produit d’une structure militaire moins rigide qu’on ne le croit, qui tolérera puis diffusera les innovations locales.
Michel Goya, ici, recourt volontairement au vocabulaire de la sociologie de l’innovation et de l’économie. Il a bien raison, car cela permet une intelligence toute particulière des processus qu’il décrit. Pour autant, la comparaison de ces processus avec ceux envisagés par von Hayek est elle complètement possible ? On est en droit de le douter du fait de la nécessité d’une structure de centralisation et de coopération entre ces diverses innovations[7]. Mais, l’image qu’il donne alors de la transformation accomplie par l’armée française est incontestablement juste. Cette transformation peut aussi s’appuyer sur une remarquable mobilisation des ressources économiques et industrielles, mobilisation qui s’avère dans les faits plus efficace que la mobilisation allemande, et qui est bien décrite dans un livre dont on a rendu compte[8]. Cela expliquera pourquoi l’armée française est en 1918 l’armée la plus moderne du monde, une armée qui se paie le luxe d’équiper en bonne partie l’armée américaine qui est venue se battre à ses côtés. Plusieurs innovations majeures, de la réserve générale d’artillerie à la division aérienne en passant par les chars de combat sont une innovation française ou du moins une innovation où les français ont largement pris de l’avance. Le point tranche avec l’image de l’armée française dans l’opinion publique. Celle-ci ne retient que la volonté du commandement à attaquer alors qu’il ne maîtrise nullement les pertes que ces attaques vont engendrer (Nivelle) et présente encore souvent l’armée comme un corps non-réactif aux changements techniques ou de contexte. Or, cette vision ne résiste pas à l’analyse.
Assurément, il y a dans le processus de transformation de l’Armée française une dimension de spécialisation dans l’organisation et la production d’armes et d’équipements. La marine, sans être abandonnée, est réduite à une portion plus que congrue. L’industrie militaire se spécialise dans les armements terrestres. Les constructions navales sont relativement peu nombreuses de 1914 à 1918, et la France achète même 12 destroyers au Japon (la classe Arabe). Cette spécialisation ne concerne pas seulement les moyens et les dépenses ; elle affecte aussi les hommes. Un certain nombre de techniciens et d’ingénieurs qui auraient dû normalement être affectés aux constructions navales ont pu être réaffectés aux constructions terrestres.
AUX RACINES DU PROCESSUS DE TRANSFORMATION
Il convient donc de s’interroger sur les causes de ce mécanisme de transformation. Michel Goya cite, naturellement le feu, mais aussi les progrès technique qui se succèdent à un rythme de plus en plus rapide à partir de la seconde moitié du XIXème siècle. Mais, il montre aussi que les racines de cette transformation se trouvent dans les hommes qui composent les armées et dans le cadre institutionnel qui leur laisse plus ou moins de liberté d’innover.
Ici encore, on peut se demander quelle a été la part de l’armée de conscription, qui a irrigué le corps des officiers de très nombreux spécialistes, dans ce processus de transformation. On peut regretter que Michel Goya ne fasse qu’évoquer rapidement cet aspect, le réduisant en partie au conflit entre Polytechniciens et Saint-cyriens, alors que l’infusion dans l’armée d’hommes possédant une bonne éducation technique et scientifique va bien au-delà. De même, il semble qu’il considère comme acquis les progrès de l’éducation en France. Or, la loi Jules Ferry et le développement de nombreuses écoles spécialisées, comme les Arts et Métiers, a permis à l’armée de disposer d’un matériau humain d’une grande qualité. Au-delà, l’expérience industrielle d’une partie de la population, même si certains ouvriers seront renvoyés dans les usines à partir de 1915, a aussi impliquée une expérience de la technicité qui eut été inconcevable avec une armée entièrement composée de paysans.
C’est là où l’on aurait attendu une comparaison entre les processus de transformation des autres armées de conscription, l’armée des Etats-Unis mais aussi l’armée soviétique lors du deuxième conflit mondial. Cette dernière témoigne d’un processus d’innovation exceptionnel entre 1941-42 et 1944-45. Or, ce processus se déroule dans un cadre bien plus centralisé que celui de l’Armée allemande, voire de l’Armée française. Cela indiquerait-il qu’il peut y avoir aussi des innovateurs, des « entrepreneurs militaires » dans un cadre bien plus centralisé et que donc certaines des hypothèses « hayeckienne » ne s’appliqueraient pas ? A l’inverse, le cas du Royaume-Uni, qui n’acceptera la conscription que de manière tardive, aurait pu figurer là à titre de contre-exemple tant il montre de rigidités et de résistance à l’innovation, point aussi noté par Martin van Creveld[9]. Le livre de Michel Goya invite en effet à s’interroger sur la flexibilité particulière des armées de conscription et sur l’impact de l’irruption dans une sphère militaire qui est souvent relativement fermée aux grandes transformations de la société du produit de ces transformations. Pourrait-on dire que l’instituteur prussien fut battu par l’instituteur français ? De même, la capacité de l’armée américaine à utiliser les compétences particulières acquises dans le civil pour former les fameux « Construction Bataillons » ou Seabees, dont l’importance lors de la campagne du Pacifique de la seconde guerre mondiale fut déterminante pour la construction des infrastructures[10], pose la question de la liaison entre l’armée et la société civile. Ainsi, les Seabees furent initialement constitués de volontaires qui s’engageaient moyennant un niveau de solde supérieur. Ces volontaires, dont l’âge était plus élevé que les recrues ou que les engagés normaux (l’âge moyen dans les bataillon constitués en 1942 était de 37 ans), possédaient une très grande expérience des travaux publics d’infrastructure.

Michel GOYA
LE DECLIN DE LA ROYAL NAVY
Ce n’est pourtant pas à cette comparaison que Michel Goya nous invite dans les deux chapitres suivants. Il va se pencher alors sur l’histoire du déclin de la Royal Navy de 1880 à 1945 et sur l’illusion du bombardement stratégique en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Disons le tout de suite, le troisième chapitre du livre nous apparaît comme le plus faible. Non que les grandes tendances montrées dans ce chapitre ne soient justes. Le processus de décroissance de la Royal Navy dans les années 1920 et 1930 est bien décrit, même si une lecture attentive décèle de nombreuses petites erreurs factuelles. Mais, l’analyse est souvent superficielle car elle ne se fait pas dans la grammaire particulière à la stratégie navale.
Comme toute marine la RN avait le choix entre deux stratégie, celle de « sea control » (contrôle des mers) et celle de « sea denial » (interdiction). En tant que marine dominante, elle se cala naturellement sur le « sea control ». D’où le grand nombre de croiseurs nécessaires à l’exercice de cette stratégie[11]. On compte ainsi, sur la période 1880 à 1905, soit à l’apogée de la RN, 56 croiseurs de 1ère classe lancés entre 1889 et 1906, allant de 7350 tonnes (classe HMS Edgar) à 14600 tonnes (classe HMS Defence) et 74 unités de 2ème et 3ème classe allant de 2800 tonnes (HMS Medea, 1888) à 5750 tonnes (classe HMS Arrogant), soit un total de 130 unités. Ce sont ces unités qui représentent le mieux la fonction de « sea control ». La marine allemande ne compte sur cette même période 1880-1905 que 14 unités 1ère classe (allant de 6228 tonnes à 12 781 tonnes) et 27 unités de 2ème classe (allant de 1055 tonnes à 3756 tonnes) soit un total de 41 unités. La marine des Etats-Unis compte quant à elle 40 unités de tous types allant de 3750 tonnes à 14 500 tonnes. Mais, les Etats-Unis doivent de fait, avant l’entrée en service du canal de Panama, entretenir 2 marines relativement distinctes. Soumise à la pression de la Reichsmarine, la RN va certes dans la période qui couvre 1906 à 1921 produire un grand nombre de cuirassés (Dreadnought) et de croiseurs de bataille[12], mais elle va être obligée de dissocier sa force de croiseurs entre des unités susceptibles d’opérer sur l’ensemble des mers du globe dans la protection au commerce (sea control/Trade Cruiser) et des unités, plus petites, qui viendront renforcer les flottilles de Destroyers dans le cadre d’une bataille engageant les grandes unités de la Flotte (sea denial/Fleet Cruiser) et censée se passer en Mer du Nord. Ces unités représentent l’équivalent d’une cavalerie maritime dont les taches sont alors analogues à celle de la cavalerie terrestre : reconnaître, jalonner, protéger et retarder en cas de retraite, harceler l’ennemi qui s’enfuit en cas de victoire. Pas moins de 31 unités seront lancées pour cette tache de 1905 à 1914 tandis que 18 navires seront lancés pour des fonctions de Trade Cruiser (la classe des « Villes » ou Town class), fonctions qui demandent une grande autonomie, une capacité à rester « en station » de longues semaines, et un armement suffisant pour affronter les navires que l’adversaire pourrait lancer pour attaquer les voies de communication. Dans le cadre des programmes de guerre (de 1914 à 1920) seul cinq unités de type Trade Cruiser seront construites, la classe Hawkins contre 28 « Fleet Cruiser » et ce sans compter les unités construites sur les fonds du programme voté en 1913 pour 1914.
Ce basculement en dit long sur le pivotement des missions de la RN, et sur le changement de sa stratégie. Cette dernière aura recours à la marine impériale japonaise (IJN), alors alliée du Royaume-Uni, pour assurer la sécurité des convois en Mer de Chine et dans l’Océan Indien. Mais, la capacité de la RN d’attaquer les bases d’où pourraient partir ou se ravitailler les unités allemandes lancées contre les voies de communication traduit bien la position dominante de cette dernière et sa capacité à exercer le « sea control ». L’escadre de l’Amiral von Spee fut obligée de tenter de rejoindre ses eaux nationales et, en dépit d’un succès brillant devant le Chili (bataille de Coronel) elle fut détruite lors de la bataille de îles Falkland. Le succès de la croisière du SMS l’Emden prit fin sous les canons de l’HMS Sydney. De fait, l’exercice du « sea control » empêche tout adversaire de s’en prendre durablement aux voies de communication. Une marine configurée pour le « sea denial » ne peut être un instrument efficace dans la guerre d’attrition qui est celle de l’attaque contre les voies de communication.
LA Royal Navy DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Après 1919, la Royal Navy fut contrainte tant par les traités de désarmement des années 1920 et 1930 que par les difficultés économiques qu’elle connaissait à l’époque. Aussi, en dépit d’un rapport remis par l’Amiral Jellicoe fixant un objectif de 70 « Trade Cruiser » à la Royal Navy, les constructions qui seront financièrement possibles obligeront un mélange entre des unités de 10 000 tonnes (13 unités, plus deux réduites), des unités de plus faible tonnage (8 unités à 7000 tonnes) et des unités de tonnage bien plus réduit pour les « Fleet Cruiser », jouant à nouveau le rôle de « cavalerie ». Les constructions reprirent dans la seconde moitié des années 1930 du fait du réarmement, mais elles furent largement dominées par la construction de « Fleet Cruisers » ou de « Trade Cruisers » de taille relativement faible pouvant opérer en tant que « Fleet Cruisers » si nécessaire. Dans la période 1935 à 1941 10 navires susceptibles de remplir la fonction de « Trade Cruiser » furent mis en service contre 15 « Fleet Cruisers ».
La Royal Navy devra accepter d’être concurrencée tant par l’US Navy, qui basculera progressivement vers une stratégie de « sea control » que par la marine japonaise (IJN) qui restera durablement engoncée dans une stratégie de « sea denial » pour laquelle elle mettra au point des matériels adaptés, comme la torpille de 24 pouces à moteur à oxygène, et les bombardiers navals basés à terre.
Le basculement entre les deux stratégies sera évident lors de la seconde guerre mondiale ou, en Méditerranée, la RN sera obligée face à la pression conjointe de l’Italie et de l’Allemagne, de basculer vers uns stratégie de « sea denial » en 1941 et 1942. Elle ne pourra revenir, temporairement, à une stratégie de « sea control » qu’avec l’aide des moyens américains. Mais, ce basculement stratégique posa moins de problème qu’on ne pourrait le croire du fait de la doctrine et de l’état d’esprit agressif dans laquelle étaient éduqués les officiers de la RN. Cela permis aux unités de la RN de compromettre la circulations des convois italiens en Méditerranée avec la fameuse « Force K » basée à Malte, du moins tant que Malte pu jouer de manière efficace son rôle de base, et de pratiquer une des formes du « sea denial », l’attaque « à la source » comme lors du raid de Tarente en 1940 (opération « Judgement » du 11 novembre 1940).
Le chapitre que Michel Goya consacre à la Royal Navy n’explore pas la flexibilité intellectuelle et opérationnelle de la RN, une flexibilité issue d’une doctrine tant explicite qu’implicite, et qui lui permis de basculer du « sea control » au « sea denial » puis de revenir au « sea control » alors que dans d’autres marines, comme la marine italienne ou la marine japonaise, ces basculements ne furent pas possible. Pour la Marine italienne, en particulier, le cas est remarquable. Supérieure en nombre et en qualité à la RN en Méditerranée, elle ne sait pas exploiter le changement de contexte lié à l’attaque de la flotte britannique à Alexandrie par les plongeurs de la Xè MAS. Elle reste largement dans une stratégie de « Fleet in being », cherchant à immobiliser les moyens de l’adversaire. Cette flexibilité donc, mais aussi une longue tradition (dont les effets sont particulièrement clairs dans les opérations au large de la Norvège, en Méditerranée ou lors des convois de Mourmansk) et une acceptation des pertes plus grandes que dans d’autres marines (voir les opérations devant la Crète en 1941, ou les convois de Malte en 1942), permirent à la RN de jouer un rôle de tout premier plan dans le second conflit mondial.
Cette capacité se double d’une remarquable innovation intellectuelle qui permit à la RN d’inventer la guerre anti-sous-marine moderne, là aussi par une combinaison d’innovations techniques (le radar centimétrique et le HF/DF, le recours aux convois déjà expérimenté en 1917-1918), de grande agressivité des équipages, mais aussi d’improvisations brillantes. Il faut noter ici que l’offensive sous-marine de l’Allemagne Nazie échoua AUSSI parce que la RN fut capable d’empêcher la marine allemande d’intervenir avec la flotte de surface et l’aviation. Le fait que l’offensive contre les voies de communication (Sea Lines Of Communication ou SLOC dans le langage moderne) soit limitée aux sous-marins permit à la RN de construire une combinaison de moyens qui empêcha ces deniers d’avoir l’efficacité attendue à partir de la mi-1942. Ceci est un autre exemple des avantages que donne une posture de « sea control », même diminuée.
L’ECHEC DU BOMBARDEMENT STRATEGIQUE
Le quatrième chapitre présente moins de problèmes. L’histoire des doctrines britanniques et américaines du bombardement stratégique est connue, en particulier de ceux qui ont l’ouvrage de Patrick Facon[13]. L’évolution tant de la RAF que de l’USAAF entre la doctrine et la réalité est aussi un exemple intéressant d’innovation militaire. Michel Goya présente les différentes innovations, mais il montre aussi l’impact des luttes bureaucratiques entre les baronnies de la RAF, entre les différents services de l’armée des Etats-Unis.
Cela décale alors l’ouvrage sur l’impact et la dynamique des conflits « inter-bureaucratiques ». Michel Goya montre à juste titre qu’il existe différentes sortes d’hystérésis induites par l’ampleur des investissements consentis. Il explore la question de la psychologie des décideurs mais aussi celle d’un emploi différent des bombardiers lourds. J’ai rendu compte par ailleurs de l’ouvrage de Stephen Bourque qui interroge justement les conséquences d’un emploi tactique de ces bombardiers[14]. De fait, la question qui est posée est plus celle du ciblage d’objectifs réellement pertinents (les raffineries ou les chemins de fer). La focalisation sur l’attaque précise des usines (pour l’USAAF) ou l’attaque des villes (pour la RAF), et ce en dépit des retours indiquant la pauvreté des résultats obtenus[15], interpelle donc sur l’existence de rigidités profondes. En fait, les bombardements stratégiques ne furent efficaces qu’à partir de l’été 1944 quand les objectifs furent largement changés.
Le chapitre développe aussi sur des adaptations et des innovations tactiques, en particulier dans le cadre de l’offensive de bombardements nocturnes contre les villes allemandes conduite par la RAF. Il montre qu’il y eut une adaptation des deux côtés, chaque adversaire réagissant assez rapidement aux innovations de l’autre. Les innovations techniques (emploi par les britanniques de radars centimétriques et d’aides perfectionnées à la navigation, brouillage[16]) état compensées du côté allemand par des innovation techniques moindres mais combinées plus à des innovations opérationnelles.
L’USAAF démontra, dans une moindre mesure, un processus d’innovation dont Goya ne parle pas, en particulier pour les formations de bombardiers qui devinrent progressivement plus compactes, assurant une meilleur couverture réciproque des avions. Ces formations, une fois escortées, permirent des raids de pénétration relativement efficaces quant au ratio des avions détruits par rapport aux pertes de l’ennemi. Ce qui contribua, mais indirectement, à l’effondrement de la Luftwaffe en 1944.
Cela invite alors à comparer le domaine aérien au domaine maritime. De fait, le bombardement stratégique n’est « efficace » que si l’on a acquis l’équivalent du « sea control » pour les airs. Il faut tout d’abord démanteler les moyens d’alerte, de communication et de commandement du défenseur, réduire à l’impotence ses moyens de défense (chasse, armes anti-aérienne), pour pouvoir ENSUITE porter des coups décisifs à l’appareil industriel et économique de l’adversaire. Tant que ce dernier conserve une capacité d’interdiction de secteurs de son espace aérien, la force attaquante sera contrainte de subir des pertes importantes, comme ce fut le cas pour la RAF et l’USAAF. Par ailleurs, même dans le cas d’un contrôle de l’air total, avant l’invention des armes nucléaires, ou si leur usage est impossible, l’efficacité d’une offensive aérienne reste douteuse. De fait, le « sea control » ne permet la victoire à lui seul que dans le cas d’un pays largement, voire totalement, dépendant de ses approvisionnements maritimes. Le bombardement stratégique reste en réalité, lui aussi et fors l’hypothèse nucléaire, d’une efficacité limitée.
LE FEU NUCLEAIRE
Le chapitre cinq traite alors de l’atome. Il montre bien les évolutions auxquelles les diverses institutions militaires furent contraintes. On partage complètement la conclusion de l’auteur : la bombe atomique est avant tout une arme politique. Mais, si la France et la Grande-Bretagne sont rapidement arrivées à cette conclusion (la France après l’abandon des Pluton en 1994), Goya montre qu’il n’en a pas été de même pour les Etats-Unis.
Ce dernier pays est longtemps resté dans une logique d’emploi opérationnel de l’arme nucléaire et thermonucléaire. La doctrine dite de « flexible response » en fut la marque, comme l’est, aujourd’hui encore, les recherches sur le développement d’armes miniatures, à la puissance inférieure à un kilotonne. Ce sont des armes d’emploi et non des armes politiques.
Michel Goya n’analyse pas, ou pas assez, cependant deux autres cas importants, celui de l’évolution de doctrine nucléaire de l’URSS puis de la Russie et celui des pays « proliférateurs », c’est à dire Israël, le Pakistan, l’Inde et la Corée du Nord[17]. Dans le cas soviétique, le parcours est complexe qui va d’une logique de dissuasion ou de représailles à une doctrine d’emploi puis au retour progressif à une doctrine de dissuasion. La croissance de la production à la fin des années 1950 des ogives nucléaires est généralement donnée comme la raison du basculement à une doctrine d’emploi. Mais, c’est compter sans l’arrivée de Khrouchtchev qui va articuler à partir de 1959-1960 une doctrine de dissuasion nucléaire, certes moins sophistiquée que la doctrine élaborée par le Général Poirier en France, mais qui va tendre à ramener l’arme nucléaire au statut d’arme politique. Le développement frénétique des vecteurs susceptibles d’atteindre les Etats-Unis en témoigne, que ces vecteurs soient connus (comme le bombardier Tu-95 ou la fusée R-7, sous-marins lance-engins balistiques de la classe « Hotel ») ou qu’ils soient moins connus (emploi stratégique des croiseurs « Kynda » et des sous-marins « Echo »[18]). Cependant, cette doctrine aura toujours ses adversaires au sein tant des forces armées que du Parti. Les armes à emploi stratégique comme le missile SS-N-3C (ou P-5/P-35/P-6) emportées sur navires et sous-marins avaient aussi potentiellement des versions tactiques, à guidage radar. De fait, le déploiement de vecteurs tactiques armés d’ogives nucléaires ou susceptibles d’en être armés, se poursuivit sous Khrouchtchev, ainsi qu’en témoigne la présence lors de la crise des missiles de Cuba (1962) de deux régiments équipés de missiles FKR-Météor[19], les 561ème et 584ème, à Cuba pour cibler tant la base américaine de Guantanamo que des possibles forces de débarquement[20]. La question du contrôle effectif sur les armes nucléaires était néanmoins posée[21].
Après la destitution de Khrouchtchev, et jusqu’en 1973, l’arme nucléaire fut conçue comme une arme de bataille, en particulier parce qu’elle permettait de résoudre des problèmes de ciblage dans les armes tactiques antinavire. L’URSS avait adoptée une doctrine de « sea denial » reposant sur une multiplicité de plateformes (navires de surface, sous-marins, avions) pour contrebalancer l’écrasant puissance navale américaine. Mais, cette doctrine imposait une précision des missiles que l’industrie soviétique de l’époque ne pouvait garantir. L’arme nucléaire fut perçue comme un substitut à cette précision manquante. C’est au début des années 1970 que cette vision de l’arme nucléaire comme une arme de bataille fut remise en cause. La cause en fut la prise en considération de la force de dissuasion française, qui arrivait alors à maturité[22]. Les textes soviétiques montrent qu’au milieu des années 1970 les militaires eux-mêmes sont arrivés à la conclusion qu’une « victoire » dans une guerre nucléaire serait dépourvue de sens, et que l’emploi d’armes nucléaires dite « de théâtre d’opérations » rendrait la poursuite du conflit impossible car incontrôlable[23]. De ce point de vue, il est significatif que ce soit l’acquisition par une autre puissance que le binôme USA-URSS du feu nucléaire qui est induit le processus de retour vers une vision politique de l’arme nucléaire. Cela montre que le processus de prolifération n’est pas nécessairement déstabilisant.
L’évolution qui conduisit les soviétiques à revenir vers une vision politique de l’arme nucléaire passa aussi par la prise en compte de ce que des armes « conventionnelles » pouvaient, par leur précision et leur puissance, obtenir les effets des armes nucléaires mais sans les risques entraînés par ces dernières (années 1980). Le trajet des soviétiques, puis des russes, est ici intéressant. Il n’est pas le même que celui de la France et de la Grande-Bretagne mais il aboutit à des résultats similaires[24]. Le véritable problème qui est alors posé est celui de la survivabilité de la structure de commandement et de contrôle à une première frappe nucléaire de l’adversaire. Car, pour pouvoir jouer son rôle stabilisateur, l’arme nucléaire doit pouvoir être employé dans un « tir en second » soit après la constatation d’une première frappe nucléaire de l’ennemi. C’est ce que l’on appelle « launch after attack » (ou LAA). Mais, l’effondrement économique de la Russie dans les années 1990 fit craindre que le pays n’adopte une doctrine de « launch under attack » (ou LUA), autrement dit de déclenchement de la frappe alors que la première frappe est en cours. Cette posture est, elle, très dangereuse pour les deux adversaires. Le retour à une meilleure santé économique de la Russie dans les années 2000 a permis d’écarter le risque de LUA. Cela montre que l’on ne peut isoler l’évolution des systèmes nucléaires de la capacité économique du pays à les maintenir.
Ce qui pose, naturellement, la question des nouveaux proliférateurs. Il semble qu’actuellement seuls Israël, qui dispose suivant les estimations de 70 à 200 têtes nucléaires, et l’Inde disposent d’un système de commandement et de contrôle suffisamment robuste pour adopter une doctrine de LAA. Le Pakistan, et sans doute la Corée du Nord, seraient encore au stade du LUA. Mais, les capacités de ciblage de l’arsenal indien rendent problématique le déclenchement d’une première frappe à capacité de décapitation du système pakistanais, ce qui limite ici le danger.
SOCIETES DECHIREES, ARMEES EMPETREES ?
Les deux derniers chapitres du livre couvrent l’évolution de l’armée française aux guerres coloniales (spécifiquement à la guerre d’Algérie) et l’évolution de l’armée américaine après le traumatisme du Vietnam. Ces chapitres montrent des logiques d’évolutions qui sont cependant souvent contrecarrées par des conflits interinstitutionnels, voire des conflits d’appropriation au sein des mêmes forces armées (conflits budgétaires entre les différentes armes). Ces conflits sont d’ailleurs anciens, et ils ne peuvent être résolus que par un engagement clair du pouvoir politique.
Le processus d’évolution et d’innovation dans la guerre d’Algérie fut contradictoire, car cette dernière touchait au cœur d’un conflit d’intérêt, voire d’un conflit de classe, profond. L’intérêt du chapitre que Michel Goya lui consacre est de montrer pourquoi ces évolutions ont à un moment divergé, pourquoi s’est construit une « fausse » mémoire des enseignements de la guerre, autour des thèses du Colonel Lacheroy. Plus profondément, cela indique aussi une des limites du processus de transformation et d’innovation dans les institutions militaires. Si les buts de guerre sont considérés comme globalement légitimes par une grande partie de la population, le processus d’agrégation des compétences civiles à l’institution militaire peut se produire sans problèmes car ce processus est lui-même considéré comme légitime. Si les buts de guerre divisent la société dont cette institution est issue, alors d’une part ce processus d’agrégation se passe bien plus difficilement mais il devient de plus la source de conflits permanents.
C’est ici que l’on regrette que Michel Goya soit trop resté dans la description, certes nécessaires et bien souvent savante des phénomènes de transformation et d’innovation et qu’il n’ait pas développé plus sur les dimensions sociales. Car, toute institution militaire est en fin de compte le produit et l’image de la société qui l’a engendrée. Quand il existe si ce n’est une unanimité du moins une forte conviction au sein de la société sur les buts de guerre, sur la légitimité même de la guerre, alors le relation entre la société et l’institution militaire peut développer les synergies qui ont été montrées dans les deux premiers chapitres. Quant la liaison entre l’armée et la société s’affaiblit, que ce soit parce qu’il y a débat sur les buts de guerre ou parce que l’institution militaire tend à se replier sur elle-même (cas de l’armée des Etats-Unis après la « professionnalisation » post-Vietnam), le processus de transformation et d’innovation se restreint aux affrontements doctrinaux au sein même de l’institution. Si, de plus, ces débats sont aussi instrumentalisés par des groupes d’intérêts, eux-mêmes liés à des intérêts industriels particulier (cas dans l’USAF ou dans le corps des Sous-Mariniers) alors le processus de transformation tend à se rigidifier, à devenir simplement la traduction du changement ou de l’évolution des techniques. Une innovation seulement « techno-basée » est l’un des pièges dans lesquels une institution militaire moderne peut tomber. Michel Goya avait d’ailleurs fait, il y a un peu plus de dix ans, une éclairante analyse de ce type de pathologie dans l’un de ses articles[25]. Le type de pathologie qu’il y décrivait pouvait être rattachées soit au livre de Mary Kaldor, sur les arsenaux « baroque »[26], soit à l’ouvrage de van Ceveld qui, lui aussi, parle d’une « pathologie de l’information »[27].
On le voit, l’ouvrage de Michel Goya brasse large. Il constitue aujourd’hui une lecture indispensable pour qui veut penser les évolutions, tant passées que futures, des institutions militaires. Il est bon qu’il ait pu disséminer le contenu de ce livre, ou du moins une partie, dans son cours à Sciences-Po[28]. La mort récente au Mali de 13 de nos soldats pose aussi le problème de la capacité de l’armée française à évoluer, à s’adapter, pour si ce n’est vaincre, ouvrir un espace à une solution politique.
Il faut donc remercier l’auteur pour l’effort qu’il a fait, pour sa tentative de synthèse, même si on peut la considérer comme encore limitée et incomplète. La lecture de ce livre s’impose pour qui veut ne pas tenir des discours convenus ou naïfs sur le développement de nos forces armées.
On en profite aussi pour recommander le livre précédent « Sous le Feu » écrit par Michel Goya. Ce livre, produit de l’expérience personnelle de Michel Goya, fait prendre conscience de l’acre réalité de la fonction de soldat, une fonction dont la mort n’est pas l’accomplissement mais constitue néanmoins, comme le dit le sous-titre du livre une « hypothèse de travail ». La combinaison de ces deux lectures constitue un binôme nécessaire pour qui veut véritablement comprendre l’évolution des armées.
NOTES
[1] Goya M., S’adapter pour vaincre, Paris, Perrin, 2019.
[2] Goya M., Sous le feu: La mort comme hypothèse de travail, Paris, Tallandier, 2014
[3] Marx K. et F. Engels, Ecrits Militaires – Violence et constitution des Etats européens modernes, Traduit et présenté par Roger Dangeville. Paris: Éditions L’Herne, 1970, 663 pp. Collection: Théorie et stratégie, no 5.
[4] Van Creveld M., Command in War, Cambridge, Harvard University Press, 1985
[5] Hull I.V., Absolute Destruction, Ithaca et Londres, Cornell University Press, 2005.
[6] Général Andolenko S., (préf. Dominic Lieven), Généralissime Souvorov : père de la doctrine de guerre russe, 1729-1800, Genève, Éditions des Syrtes, 2016.
[7] J’y ai fait référence dans Sapir J., Qu’elle économie pour le XXIème siècle ?, Paris, Odile Jacob, 2005.
[8] Fridenson P. et P. Griset, (Edits.), L’Industrie dans la Grande Guerre, Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 2018
[9] Van Creveld M., Command in War, op.cit..
[10] Castillo, Edmund L. The Seabees of World War II, New York, Random House, 1963
[11] Gardiner R., Conway’s all the world Fighting Ships 1906-1921, Londres, Conway Maritime Press, 1985
[12] Les croiseurs de bataille, contrairement à ce qui est indiqué dans l’ouvrage sont plus chers que les cuirassés des mêmes programmes en raison de la puissance installées considérablement plus grande.
[13] Facon P., Le bombardement stratégique, Monaco, Éditions du Rocher, 1996, 355p.
[14] Bourque S.A., Au-delà des Plages – La guerre des alliés contre la France, Paris, Passés Composés, 2019, 414 p., traduction de Beyond the Beach: The Allied War Against France, Naval Institute Press 2018, compte rendu dans RussEurope-en-Exil, https://www.les-crises.fr/russeurope-en-exil-stephen-bourque-la-question-des-victimes-civiles-francaises-des-bombardements-allies-et-le-piege-du-point-de-vue-doloriste-par-jacques-sapir/ .
[15] Voir, The United States Strategic Bombing Survey – Summary Report – European War, Washington D.C., 30 septembre 1945. Consultable à l’adresse internet : https://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/USSBS/ETO-Summary.html
[16] Price A., Instruments of Darkness: The History of Electronic Warfare, 1939–1945, Londres Greenhill Books, 2005.
[17] On ne retient ici que les proliférateurs avérés et non les proliférateurs potentiels ou les pays ayant délibérément abandonné l’arme nucléaire comme la République d’Afrique du Sud.
[18] Sapir J.,”Les croiseurs soviétiques : 1935-1985 – Cinquante années de conflits interbureaucratiques dans la construction navale” in A. Joxe, R. Patry, Y. Perez, A. Santos, J. Sapir, Fleuve Noir, production de stratégies et production de systèmes d’armes, CIRPES, Cahiers d’Etudes Stratégiques N° 11, Paris, 1987, pp. 117 à 139. Idem, Le système militaire soviétique, La Découverte, Paris, 1988.
[19] Il s’agit du missile SSC-2a (code OTAN), un dérivé du KS-1 Komet employé sur Tu-16.
[20] Norris R.S., « The Cuban Missile Crisis: A Nuclear Order of Battle, October/November 1962 », Présentation faite au Woodrow Wilson Center, octobre 2012.
[21] Voir : Kramer M., “Tactical Nuclear Weapons, Soviet Command Authority, and the Cuban Missile Crisis,” Cold War International History Bulletin, Issue 3 (Fall 1993), pp. 40, 42-46 and James G. Blight, Bruce J. Allyn, and David A. Welch, “Kramer Vs. Kramer, Cold War International History Project Bulletin, Issue 3 (Fall 1993), pp. 41, 47-50.
[22] Garthoff Raymond L., Deterrence and the Revolution in Soviet Military Doctrine, Washington DC, Brookings Institution Press, 2010.
[23] Sapir J., Le système militaire soviétique, op.cit..
[24] Joxe A., Le Cycle de la Dissuasion, Paris, La Découverte, 1990. Garthoff R., Reflections on the Cuban Missile Crisis: Revised To Include New Revelations from Soviet & Cuban Sources (Revised) by Raymond Garthoff , Washington, Brookings Institution, 1989.
[25] Goya M., « Dix millions de dollars le milicien – La crise du modèle occidental de guerre limitée de haute technologie », in Politique Etrangère, 2007/1 (Printemps), pages 191 à 202, https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2007-1-page-191.htm
[26] Kaldor M., The Baroque Arsenal, Londres, Hill et Wang, 1981.
[27] Van Creveld M., Command in War, op.cit..
[28] Voir https://lavoiedelepee.blogspot.com/2019/09/sadapter-pour-vaincre-une-courte.html