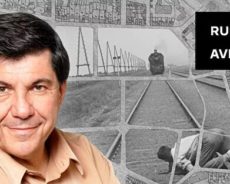L’impact économique de la pandémie pourrait se faire sentir durant des décennies –d’où l’intérêt d’en tenir régulièrement la chronique.

Quand la maladie et la mort frappent à la porte et que l’horizon se limite aux murs de son logement, il est difficile de s’intéresser au budget de l’État ou à la courbe du chômage. Pourtant, on le sait, nous sommes entré·es dans la crise économique la plus violente de l’histoire contemporaine.
Notre qualité de vie dans les prochaines années, voire dans les prochaines décennies, dépend des décisions qui sont prises maintenant. Pour cette raison, il nous a paru important de faire un point régulier sur la situation présente, les perspectives de sortie de crise et la préparation du monde d’après.
Prix négatifs pour le pétrole
S’il fallait choisir un fait résumant à lui seul la gravité de la situation, ce serait sans conteste le passage du prix du pétrole au-dessous de zéro sur le marché à terme des États-Unis.
Explication rapide: sur un marché à terme, on vend ou on achète des contrats portant sur la livraison d’une marchandise à une date donnée. En l’occurrence, il s’agissait de contrats portant sur la livraison de barils (159 litres chacun) de pétrole livrables en mai, dont le dernier jour de négociation était le 21 avril.
Sur ce marché, à côté des professionnels, interviennent des investisseurs qui essaient de gagner de l’argent en jouant sur les variations de prix du contrat d’un jour à l’autre, mais sans aucune intention de se faire livrer du pétrole.
Problème: avec une économie qui tourne au ralenti, les barils de pétrole s’accumulent et on ne sait plus où les mettre. Le plus grand centre de stockage des États-Unis, situé à Cushing dans l’Oklahoma, au croisement de plusieurs oléoducs, est plein à craquer.
Le lundi 20 avril, des acheteurs du contrat de mai se sont aperçus que le lendemain, ils risquaient de se retrouver avec du pétrole qu’il n’était plus possible de stocker –ou alors à des prix prohibitifs. Résultat: ils ont dû se résoudre à payer jusqu’à 37,63 dollars le baril [près de 35 euros] des personnes disposées à leur acheter ce pétrole.
Payer des gens pour qu’ils vous prennent votre marchandise, c’est ce qu’on appelle un prix négatif. Cela existait déjà sur les taux d’intérêt: des investisseurs ou des établissements bancaires paient des États pour qu’ils acceptent de se faire prêter de l’argent ou des banques centrales pour qu’elles prennent leur argent en dépôt –et ce n’est pas bon signe.
Pour le pétrole, cette situation n’a duré que quelques heures. Le vendredi 24, il valait plus de 21 dollars le baril en Europe et autour de 17 dollars aux États-Unis. Mais il faut rappeler qu’au début de l’année, les prix s’élevaient à plus de 60 dollars de part et d’autre de l’Atlantique.
Cette chute rapide a au moins l’avantage de faire le bonheur de celles et ceux qui roulent encore: en France, le prix moyen du gazole et du SP95, qui s’établissait à respectivement 121,3 et 126,2 centimes le litre le 17 avril, a reculé de plus de 27 centimes depuis début janvier.
À LIRE AUSSI La mondialisation est la solution pour lutter contre le coronavirus
Activité en chute libre
Les économies ainsi réalisées ne seront pas de trop pour compenser les pertes de revenus qui risquent d’être enregistrées cette année. Car l’écroulement des prix du pétrole n’est que le signe le plus visible de celui de l’activité mondiale.
Au moins 4,5 milliards de personnes dans 110 pays ou territoires, soit environ 58% de la population mondiale, vivent aujourd’hui confinées ou doivent limiter leurs déplacements pour tenter d’endiguer la propagation du coronavirus.
Les conséquences sont immédiates. Selon la dernière étude d’impact pour la France menée par l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), le PIB est réduit de 32% en période de confinement; huit semaines de quarantaine, c’est 120 milliards d’euros de PIB en moins, soit 5% du PIB annuel.
Les calculs de l’Insee et de la Banque de France aboutissent à des ordres de grandeur similaires, et les informations qui tombent jour après jour donnent toutes la même indication: l’activité s’effondre très bas dans le commerce, tout aussi brutalement mais un peu moins bas dans le bâtiment.
D’une façon générale, le climat des affaires enregistre une chute verticale qui l’entraîne au-dessous des niveaux enregistrés au moment de la crise financière de 2008. Il faut absolument regarder ces graphiques de l’Insee: ils sont vertigineux!
Huit semaines de confinement, c’est 120 milliards d’euros de PIB en moins, soit 5% du PIB annuel.
Selon une étude publiée le 20 avril par le cabinet McKinsey et relayée par Politico, «plus d’un quart de tous les emplois en Europe pourraient être touchés par les retombées économiques de la pandémie de coronavirus».
En France, on vient d’avoir un premier aperçu de la rapidité avec laquelle la situation peut se détériorer. Au premier trimestre, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs et demandeuses d’emploi en catégorie A (n’exerçant aucune activité) augmente peu, de 0,8% (+28.000 personnes), et reste en baisse de 1,9% sur un an.
Mais si l’on regarde les chiffres du seul mois de mars, on constate que ce nombre pour la France entière (hors Mayotte) enregistre sa plus forte hausse depuis le début de la série en 1996 (+246.100 personnes, soit +7,1%), pour s’établir à 3.732.500.
Menace sur l’emploi aux États-Unis
L’étude menée par McKinsey pour les États-Unis est encore plus sombre: c’est jusqu’à un tiers des emplois qui pourraient être touchés, et 80% de ces jobs en danger sont occupés par des salarié·es à bas revenus.
La population américaine ne se fait d’ailleurs guère d’illusions sur ce qui l’attend: d’après un sondage Gallup, un quart des Américain·es qui travaillent estiment qu’il est très ou assez probable de perdre leur emploi dans les douze mois qui viennent.
Les chiffres des inscriptions au chômage ne sont pas de nature à les rassurer: au cours de la semaine se terminant le 18 avril, plus de 4,4 millions de demandes ont été déposées. C’est un peu moins que la semaine précédente, mais il n’en demeure pas moins qu’au total, 26,4 millions d’inscriptions ont été enregistrées en cinq semaines.

Distribution à la volée de formulaires d’inscription au chômage à Hialeah, en Floride, le 8 avril 2020. | Chandan Khanna / AFP
Face à ce cataclysme, Donald Trump ne se contente fort heureusement pas de donner des conseils étonnants sur la façon de lutter contre le coronavirus; il a également promulgué le 24 avril une loi votée par le Congrès ajoutant 484 milliards de dollars [446 milliards d’euros] aux dépenses déjà prévues dans le domaine économique et sanitaire.
Pour l’essentiel (320 milliards), il s’agit d’aider les PME, mais 60 milliards iront à des secteurs particulièrement touchés comme l’agriculture, 75 milliards aux hôpitaux et 25 milliards au dépistage du virus.
Ces 484 milliards de dollars viennent s’ajouter aux 2.200 milliards du CARES Act, promulgué le 27 mars.
À LIRE AUSSI Tous ces milliards qu’il faudra rembourser, qui les paiera?
L’Europe avance… à son rythme
En Europe, la situation est un peu plus compliquée. Le Conseil européen réuni en visioconférence le 23 avril a certes approuvé le plan de sauvetage de 540 milliards d’euros proposé par l’Eurogroupe, qui comporte trois instruments distincts, «trois filets de sécurité importants, en faveur des entreprises, des travailleurs et des États», et devrait être opérationnel dès le 1er juin.
En revanche, il n’a pu déboucher sur un accord concernant un plan de relance, qui s’inscrirait dans la proposition de budget pour la période 2021-2027; il a juste été demandé à la Commission de formuler des propositions à partir de la mi-mai.
Les dirigeant·es européen·nes restent divisé·es sur le montant de ce fonds, sur la manière dont il pourrait être utilisé (prêts ou subventions aux États) et sur la façon dont il serait financé (par un emprunt commun avec l’émission de «coronabonds», par exemple). Cela fait beaucoup d’incertitudes…
Celles et ceux qui veulent garder confiance dans l’Europe soulignent néanmoins qu’il existe un réel climat de coopération. Le président du conseil italien, Giuseppe Conte, qui devrait être le plus mécontent de ces hésitations, parle d’une «étape importante», tandis qu’Angela Merkel a déclaré devant le Bundestag que les Allemand·es devaient se «préparer, dans un esprit de solidarité et sur une période limitée, à verser des contributions différentes, c’est-à-dire plus élevées, au budget de l’UE si nous voulons que les économies de tous les États membres de l’UE puissent se redresser». On n’en est pas encore à l’idée d’un emprunt commun, mais on progresse…
Parer au plus pressé sans hypothéquer l’avenir
L’ampleur de la crise à laquelle tous les gouvernements sont confrontés pose des problèmes inédits qu’il faut résoudre dans l’urgence pour parer au plus pressé, sans pour autant hypothéquer l’avenir.
Les décisions qui sont prises à Bruxelles en ce moment en l’espace de quelques jours ou quelques semaines vont dessiner le visage de l’Europe pour les décennies à venir.
De même, au niveau de chaque État, la décision de soutenir tel secteur ou telle entreprise contribue à l’édification du monde de demain, dont on nous dit qu’il devrait être différent du monde d’hier.
Les appels au changement sont légion: ils viennent de l’ONU, de l’OCDE et, en France même, du Haut Conseil pour le climat. Mais la traduction en actes de ces recommandations n’est pas toujours aisée.
Prenons l’exemple du transport aérien. Dans le monde d’après, celui dans lequel chaque citoyen·ne aura à cœur de limiter ses émissions de gaz à effet de serre et ne prendra plus l’avion simplement pour changer d’air le temps d’un week-end ou pour aller se baigner dans de l’eau chaude sous le soleil de la Méditerranée ou des tropiques, il n’y aura plus place en théorie pour toutes ces compagnies qui rivalisent d’ingéniosité –et d’économies sur les effectifs et les salaires– pour proposer des voyages à prix cassés.
Mais que fait un ministre lorsque le président de l’une de ces compagnies vient le voir pour lui demander de l’aide, en mettant dans la balance le sort de centaines ou de milliers de salarié·es, au moment où la compagnie concurrente du pays voisin vient d’obtenir le soutien de son gouvernement?
Bruno Le Maire vient de permettre à Air France de bénéficier d’une aide de 7 milliards d’euros, 4 milliards de prêts bancaires garantis par l’État à 90% et 3 milliards d’avance de l’État actionnaire. Ce n’est pas un «chèque en blanc», nous assure le ministre: Air France devra devenir «la compagnie aérienne la plus respectueuse de l’environnement de la planète».
Les écologistes jugeront certainement ce vernis vert un peu léger, mais Bruno Le Maire n’avait en fait pas d’autre choix: il ne lui aurait pas été pardonné, dans le monde d’aujourd’hui, de laisser tomber ce symbole de la puissance française rayonnant dans le monde. Les gouvernements européens auront probablement à prendre très bientôt des décisions comparables concernant Airbus.
À LIRE AUSSI Le Covid-19, bon pour le climat? Rien n’est moins sûr
Faut-il sauver le milliardaire Branson?
De son côté, le gouvernement britannique va devoir faire un choix beaucoup plus difficile. Va-t-il aider Richard Branson, le fringant milliardaire, plus habitué des magazines people que de la presse économique, à trouver les 500 millions de livres qu’il réclame depuis son paradis fiscal des îles Vierges britanniques pour sauver sa compagnie Virgin Atlantic?
On peut être tenté de penser que la réponse devrait être négative: il n’appartient pas aux contribuables de venir en aide à un riche exilé fiscal; qu’il mette lui-même la main à la poche! Mais Sir Branson, qui refuse d’être assimilé à un vulgaire exilé fiscal –le hasard fait qu’il a eu un coup de cœur pour cette île achetée il y a quarante ans!– ne manque pas d’arguments, qu’il développe dans une longue lettre ouverte adressée aux 70.000 salarié·es de Virgin Group.
Certes, il est riche, explique-t-il, mais cette richesse est essentiellement virtuelle: elle est calculée d’après la valeur de ses entreprises, et celles-ci sont pour l’essentiel tournées vers le tourisme, le transport et les loisirs, des activités actuellement en grande souffrance. De surcroît, cette richesse n’est pas immédiatement mobilisable, or il a besoin de cash pour faire face à des dépenses immédiates.
Richard Branson ajoute que ce qu’il demande est simplement un prêt, pour lequel il apporterait son île en garantie et que son groupe rembourserait. Bref, il ne s’agirait pas d’aider le milliardaire, mais de sauver les 8.500 emplois de sa compagnie aérienne.
Au-delà de cette affaire très médiatisée, les pouvoirs publics vont être confrontés dans tous les pays à de difficiles arbitrages dans les prochains mois: quels sont les «bons» emplois que l’on va sauver et les «mauvais» que l’on va laisser disparaître parce qu’ils ne correspondent plus aux priorités du monde d’après le Covid-19?
Il ne sera pas toujours facile d’expliquer aux employé·es concerné·es que l’on fait ces choix dans l’intérêt général, pour le bien-être de la population et la sauvegarde de la planète.