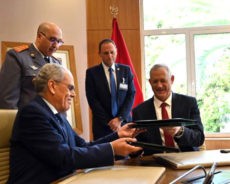STRUCTURE DU POUVOIR D’ÉTAT
Le statut et les fonctions des partis dirigeants algériens (1ère partie)
par Badr’Eddine Mili
le 30.09.2018
Avant-propos
Dans la violente offensive lancée, en 2013, par Amar Saâdani, le secrétaire général du parti du FLN, contre le chef du Département renseignement et sécurité (DRS), le général de corps d’armée Mohamed Mediène, suspecté d’être derrière les révélations sur les scandales de corruption qui éclaboussèrent le très proche entourage présidentiel et d’être plus que rétif à l’idée de voir le Président Abdelaziz Bouteflika briguer un 4e mandat, l’argument massue qui revenait, en boucle, dans le discours officiel justifiant cet affrontement était la nécessité «impérieuse » qu’il y avait à instaurer «enfin» un «Etat civil» en Algérie. Cet Etat était appelé, d’après les quelques projections suggérées par ses promoteurs, à rompre, définitivement, avec les restes de prépondérance conservés par les militaires dans les institutions dirigeantes, après leur retour à l’exercice direct du pouvoir en janvier 1992. Le débat ouvert, dans un climat d’extrême tension, autour de cet enjeu, très disputé, devait – à son terme – décider qui, du président de la République ou du chef du DRS, était le véritable détenteur de la prééminence suprême dans la direction des affaires du pays. Le conflit se termina par le limogeage de ce dernier sans que rien soit venu, ultérieurement, confirmer la volonté des vainqueurs de l’épreuve de force – le Président appuyé par le chef d’état-major de l’ANP – de réunir les conditions de l’émergence effective de l’Etat promis, la révision constitutionnelle de 2016 n’ayant apporté aucun élément de droit, abondant dans ce sens, qui lui eut conféré de la consistance et du crédit, à part, quelques réaménagements, de pure forme, relatifs à la justice, à la saisine du Conseil Constitutionnel et à la surveillance des élections. L’unique enseignement probant fourni par le dénouement de ce qui s’avéra, en réalité, comme une opération de recentrage de la source de décision qui profita, du reste, autant à la Présidence qu’à l’institution militaire – mise, davantage, en cohésion, au niveau de sa hiérarchie — fut de rappeler que ce clash ressemblait à tous ceux qui l’avaient précédé. Et comme eux, il n’allait rien changer – quant au fond — à la loi d’airain d’un rapport de forces vieux de plusieurs décennies, jalonnées par des crises à répétition qui mirent aux prises les civils et les militaires, la constante la plus indiscutable de l’Histoire contemporaine de l’Algérie pré et postindépendance.
Une histoire très ancienne
Les luttes entre ces deux ailes du pouvoir algérien ont des racines historiques profondes. Dans un enchaînement cyclique, fortement, déstabilisateur couvrant la période qui va de la préparation du soulèvement du 1er Novembre 1954 à l’épisode évoqué, ci-dessus, prolongé par le chamboulement, sans précédent, qui décapita, en été 2018, les sphères supérieures du ministère et de l’état-major des armées, avec, en toile de fond, des positions antagoniques sur des questions d’orientation idéologique, de choix stratégiques et d’hommes, ces luttes opposèrent :
• les révolutionnaires de l’OS (Organisation Spéciale) aux militants légalistes du MTLD entre 1952 et 1954 ;
• les principaux chefs de l’insurrection à la nouvelle direction cooptée par le Congrès de la Soummam en 1956 ;
• les «militants en uniforme» de l’EMG (état-major général de l’ALN) au GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne), en 1961-1962 ;
• le ministre de la Défense nationale, le colonel Houari Boumediène, au président de la République, Ahmed Ben Bella, en 1965 ;
• et, enfin, le Haut-Commandement de l’ANP au FIS (Front islamique du salut), après la suspension du processus électoral multipartite de 1991, un acte dénoncé par Abdelhamid Mehri, alors secrétaire général du parti du FLN, futur cosignataire de la plate-forme de Sant’ Egidio, qui transgressa, de façon spectaculaire, les protocoles en usage au sein de «la Maison de l’Obéissance ».
Avant de commencer à charrier, dans leur prolongement, des rivalités claniques et régionalistes et des ambitions purement personnelles, ces luttes tournaient, durant la phase prérévolutionnaire, autour d’idées politiques exprimées, démocratiquement, et défendues, souvent, avec une grande force de conviction. De proclamation en révision et de contestation en redressement, elles prirent un autre sens, dans les phases qui suivirent, et eurent pour moteur la volonté des chefs politico-militaires de la Révolution de conserver la direction exclusive du FLN originel, au motif d’en préserver «la pureté», opposés aux «ralliés», leurs «compagnons de route» du Mouvement national – centralistes, udmistes, ulémistes et communistes – à chaque fois qu’ils les soupçonnaient d’ambitionner de partager le pouvoir, dans une position autrement que subalterne, ou de tenter de le «confisquer» à leur seul avantage pour le dévier de son sens initial. C’est, sans doute, la première signification qu’il conviendrait de donner à ces rapports conflictuels qui ont, durablement, marqué, dans un mouvement de balancier continu, l’ensemble des stations du mouvement révolutionnaire et de l’Etat algérien restauré : de la création de l’OS et du CRUA aux évènements qui caractérisèrent, dans les conditions que l’on sait, la reconquête de la souveraineté nationale, en 1962, en passant par le Congrès de la Soummam de 1956 – rectifié par la session du CNRA tenue au Caire en 1957 –, le conclave des colonels réuni dans la capitale égyptienne, en 1959, et le Congrès de Tripoli convoqué et suspendu, en 1962, dans la désunion et la confusion les plus totales.
Aux sources de la discorde
Afin de comprendre les ressorts de cette substitution – rampante puis brutale – du pouvoir des «militants en uniforme» au pouvoir des «militants civils» que certains acteurs-mémorialistes ont voulu expliquer par la prévalence de la logique du terrain et par la nécessité de rectifier les déviations, il faudrait la rattacher à l’évolution, en dents de scie, qui fut celle du FLN du 1er Novembre jusqu’au Congrès de Tripoli. Dès sa création, le 10 octobre 1954, suivie de celle de l’ALN, intervenue, sous son égide, quelques jours plus tard, et signée par les mêmes chefs, le FLN connut une évolution ascendante illustrée, durant trois années, par une parfaite osmose entre les révolutionnaires politiques et les moudjahidine, solidairement unis, dans ce qu’on avait appelé «le nidham», l’organisation fondée sur un consensus sans faille autour du contenu de la Proclamation. Le Front se distingua, au cours decette période faste, par une unité de pensée et d’action incontestée, malgré l’éparpillement territorial de ses forces et la faiblesse de ses moyens logistiques, avant de la voir s’étioler à l’amorce d’une courbe descendante qui donna, à la fin des années 1950, le coup d’envoi au dessaisissement d’une partie essentielle de ses prérogatives au profit d’une ALN transfigurée par son arrière – l’armée des frontières dérivée de la fusion des EMG – Est et Ouest – qui, une fois bien installée, en 1960, étala, ouvertement, ses prétentions politiques hégémoniques. L’équilibre entre les deux entités était rompu et les ingrédients explosifs d’une crise annonciatrice d’un nouvel ordre en marche réunis et mis en action au cours de l’été 1962. Les raisons qui expliquent cette évolution atypique sont à chercher, d’abord, dans les différences de vision entre les principaux segments composant le Front sur les questions de l’Etat à venir et de l’identité idéologique et patronymique des forces et des hommes candidatés pour le diriger. Il y en avait d’autres, sous-jacentes, dont il faut bien tenir compte dans une analyse des éléments de fond éclairant, a posteriori, la perte de vitesse enregistrée par le FLN, après le Congrès de la Soummam, imputable, à, au moins, deux données sociologiques et politiques déterminantes :
• la première a trait à la place minoritaire occupée dans la société et, donc, dans le FLN, par les élites qui n’ont pas pu dépasser les écarts objectifs existant entre leurs matrices sociales hétérogènes ainsi qu’entre leurs itinéraires politico-culturels formateurs – traditionnalistes/arabophones et modernistes/ francophones – un écueil qui leur fit accepter, avec quelque résignation, la prise du commandement de la Révolution par la paysannerie pauvre, colonne vertébrale de l’ALN et classe qui a le plus pâti de la politique coloniale, d’autant que ces élites se sont vu reprocher d’avoir rejoint, tardivement, l’insurrection ;
• le second élément qui joua dans l’enclenchement de ce processus est la forte mobilisation de ces élites dans la seule gestion diplomatique, doctrinale et administrative de la Révolution qui les éloigna, physiquement, du centre de l’action militaire, surtout, après la décision du CCE de quitter Alger pour siéger à Tunis.
Le plus clair de l’encadrement supérieur du FLN fut versé dans l’action internationale et dans la rédaction des textes structurants du mouvement, des tâches qui l’accaparèrent, longtemps, sur les tribunes du non-alignement et de l’ONU et, aussi, dans les ministères du Gouvernement provisoire où il travailla à doter la cause nationale de vecteurs de communication – presse écrite et radiodiffusion – et à fournir, début 1962 — il faut l’avouer, dans une position de porteur d’eau au service du triumvirat plutôt que de décideur autonome — aussi bien les dossiers que les effectifs d’experts de la délégation dépêchée à Evian pour négocier la fin de la guerre. Acté au Congrès de Tripoli, l’isolement définitif des élites civiles s’explique en effet par la distance qu’elles ont prise avec la réalité du champ de bataille militaire, entièrement, contrôlé par les katibate de l’ALN dont les chefs décidaient de tout — recrutement, logistique, collecte de fonds – empiétant sur les territoires des commissaires politiques et des moussabiline de l’organisation civile du FLN placés, de facto, sous l’autorité des états-majors des wilayas, lesquels commençaient à se méfier de la délégation extérieure jugée laxiste, surtout, par rapport à ce qui allait devenir la pierre d’achoppement principale entre les deux parties : la difficulté des responsables installés au Caire et à Tunis à approvisionner le maquis en armes.
La marginalisation des politiques, à une étape aussi cruciale de l’insurrection, constitue, au regard de l’Histoire des révolutions, un cas assez singulier pour ne pas être souligné si l’on devait le comparer à ceux des révolutions bolchevique, chinoise, vietnamienne ou cubaine, dirigées — même si elles n’avaient pas été, toutes, anti-coloniales — par des partis qui avaient fait respecter le principe de la subordination des militaires à la hiérarchie civile jusqu’à la victoire finale, et plus loin encore.
Une règle et des exceptions
La ligne de démarcation entre les uns et les autres – faudrait-il, toutefois, relativiser – n’était pas nette. A force d’être floue et fluctuante, il se trouva que ceux qui détenaient, aujourd’hui, la puissance de feu pouvaient en être désarmés, le lendemain, sans préavis, victimes des règles excommunicatrices qu’ils avaient eux-mêmes conçues et appliquées à leurs adversaires. Il en fut, ainsi, de Krim Belkacem, Abdelhafid Boussouf et Lakhdar Bentobbal qui, après leur victoire sur Abane Ramdane — par élimination physique – devinrent, au grand désappointement du Président Ferhat Abbas, les véritables chefs du GPRA, maîtres du puissant appareil formé du ministère de la Guerre, du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Armement et des Liaisons générales, matrice de l’arme du renseignement et des transmissions, une position omnipotente qui ne les empêcha pas, au lendemain d’Evian — malgré une résistance de dernière minute — d’être coiffés, sur la ligne d’arrivée, par l’inattendu Houari Boumediène, leur ancien subordonné. La même mésaventure fut vécue par des chefs de l’OS et du groupe des 22 – Mohamed Boudiaf, Hocine Aït Ahmed et, en 1965, par Ahmed Ben Bella – quand, de leur côté, des chefs de Wilaya – les colonels Salah Boubnider et Youcef Khatib – prirent le contrepied de leur hiérarchie — l’EMG — en défendant la légitimité du CNRA et du GPRA, les armes à la main, dans le Titteri et le Constantinois, face à l’avancée de l’armée des frontières ; les mêmes qui troquèrent, après l’indépendance, leur statut de militaires contre celui de militants politiques. Une autre illustration de ces retournements de situation paradoxaux est incarnée par le Président Chadli Bendjedid, militaire de «carrière», ancien colonel, chef du groupe dit du «Bec de Canard» de l’extrême Est algérien, qui se découvrit une vocation de «démocrate» en promulguant la Constitution de 1989 par laquelle il souhaita entrer dans l’Histoire en «père du multipartisme», la porte ouverte au retrait des militaires de la gestion des affaires politiques ; un répit de courte durée car le deal, durement, négocié avec les autres pôles du pouvoir d’Etat qui fit rentrer l’armée dans les casernes, confinée aux tâches de «la défense de l’unité et de l’intégrité du territoire », vola en éclats, lorsque, menacés par les leaders du FIS triomphant, les officiers supérieurs de l’ANP choisirent de donner congé au président de la République, de suspendre la Constitution et de créer, ex nihilo, aux lieu et place, une institution paraétatique – le HCE (Haut-Comité d’Etat) – investie de l’autorité de gouverner le pays en leur nom. Les militaires revenus à la gestion directe expérimentèrent plusieurs formules – «Présidence de l’Etat», «gouvernement d’union nationale» à plusieurs étiquettes (FLN, dissidents du FIS dissous, Hamas, FFS, RCD…) dans le but d’asseoir, sur une base politique civile, la lutte antiterroriste et de desserrer l’étau international dans lequel se débattait l’Etat algérien, accusé par les puissances occidentales de «massacrer le peuple» et de «refuser de reconnaître le verdict des urnes».
L’émergence des partis dirigeants
L’intermède du Président Liamine Zeroual élu, à la régulière, à la magistrature suprême, en novembre 1995, dans un scrutin qui montra de quel côté le fléau de la balance de la société penchait, fut mis à profit pour étrenner, en 1996, dans une Constitution rééquilibrée, un gouvernement appuyé, à partir de 1997, sur une coalition dite de «l’Alliance présidentielle». Formée du FLN – déclassé en raison de son positionnement de 1992 – et du MSP – passé maître dans l’infiltration des centres de décision –, cette coalition fut coordonnée par le RND (Rassemblement national démocratique), «parti de l’Administration», majoritaire à l’Assemblée populaire nationale, six mois après sa naissance sur les décombres de l’ex-parti unique vidé d’une grande partie de sa base et de ses cadres. L’entrée de la notion de «partis dirigeants » dans le lexique politique national date de la formation de cette coalition qui prit le nom de «Majorité présidentielle» élargie par le Président Abdelaziz Bouteflika, à l’entrée en vigueur de la loi sur la réconciliation nationale. Celle-ci aggloméra d’autres partis moins importants – ANR, MPA, TAJ … — ainsi que des organisations patronales – le FCE –, l’expression des nouvelles clientèles produites par les changements socio-économiques post-terrorisme : ouverture, plus grande, de l’Algérie au capitalisme national et international ainsi qu’aux nouvelles tendances de l’islamisme exportées par les pays du Golfe. Le régime ne put reprendre la main qu’au bout de plusieurs compromis d’étapes entre les protagonistes des crises passées, inaugurant un cycle de gouvernance rythmé – à l’orée des années 2000 – par une providentielle embellie financière conjuguée à des réformes drastiques auxquelles il dut se plier sous la charge d’une mondialisation conquérante. Tout en injectant dans la nouvelle recomposition politique des clones des formations du Mouvement national d’avant 1954 – dans des versions dégénérées ou apostasiques, il n’en rénova pas moins le tableau du paysage politique en lui apportant, ne serait-ce qu’au plan de la forme, une touche «pluraliste», corrigée par des arrière-pensées caporalisatrices ou récupératrices parce que menée sous un étroit contrôle politico-sécuritaire. Les Présidents algériens à l’épreuve du pouvoir et L’opposition politique en Algérie, nos deux précédentes études parues, entre 2015 et 2017, dans la collection «Essais» de Casbah-Edition, ont, abondamment, décrit et analysé les grands moments de cette période mouvementée de la vie politique nationale. La présente recherche se propose, elle, d’explorer les territoires méconnus du pouvoir d’Etat algérien et de faire remonter à la surface les dessous de ceux qui furent, insuffisamment, mis en relief, en essayant d’éviter les interprétations schématisées ou manichéennes, abusives, qui en biaisèrent la compréhension correcte. Parmi ces interprétations, il y en eut qui sous-estimèrent l’aptitude politique des civils à peser sur les orientations et les décisions de la direction du pays, fût-elle à dominance militaire, et d’autres qui ont surévalué les capacités démiurgiques des messianiques de l’armée, faiseurs solitaires de présidents. Les lecteurs suivront, ainsi, durant les sept mois qui nous séparent de l’élection présidentielle d’avril 2019, un exposé et une analyse détaillés des origines et des mutations des «partis dirigeants» — essentiellement le FLN et le RND – aux facettes moins conventionnelles qu’il n’y paraît, à première vue, subissant «les coups d’Etat scientifiques » et les scénarios «venus d’en haut» ou réactifs à la chape de plomb de l’autorité suprême avec un certain volontarisme, comme ce fut le cas en 1992.
Constances et métamorphoses du FLN et du RND
L’idée qui sera développée, à l’appui de cette démarche, est qu’il y eut plusieurs FLN dans le FLN et plusieurs RND dans le RND. Chacun de ces deux partis fut, à certains moments de son Histoire, rétrogradé et humilié ou, à l’opposé, dopé par les faveurs du prince, tant il est vrai qu’ils furent dépendants des parrainages ou des reniements sanctionnant des convergences ou des déphasages intervenus dans leurs rapports avec les forces du pouvoir réel, partenaires ou rivales, dans le déroulement d’un parcours historique, loin d’être uniforme. Le FLN de Tripoli de 1962 n’était, déjà, plus, celui de la Proclamation de 1954, pas plus que celui de la Soummam de 1956 auquel ne ressemblera ni le parti de la Charte d’Alger de 1964 du Président Ahmed Ben Bella, ni l’Exécutif – Appareil du Président Houari Boumediène, subordonné, en 1965, à un Etat appelé «à survivre aux évènements et aux hommes», encore moins, à celui du président-secrétaire général Chadli Bendjedid qui s’en servit pour tenter de réaliser, en 1979, une osmose armée-administration- parti, réglée par l’article 120. Celle-ci finira dans le divorce d’octobre 1988 et la destitution de Mohamed Cherif Messaâdia, responsable du Secrétariat Permanent du Comité central, l’homme qui fit siéger la direction du parti au Palais du gouvernement, haut lieu du pouvoir exécutif ; un emménagement destiné à afficher, ostensiblement, sur fond de déchirements entre «socialistes» et «libéraux», un leadership de façade resté dans les annales. Enfin, le Président Mohamed Boudiaf avait eu l’intention déclarée de lui assener le coup de grâce, en 1992, en recommandant de le « remiser au musée » et de le remplacer par le RPN (Rassemblement populaire national). Le RND dont l’un des motifs de création fut de procéder au ravalement de la façade du pouvoir d’Etat et, par là même, punir le parti du FLN pour sa collusion avec l’opposition, en 1992, n’a pas, non plus, obéi à une linéarité qui l’aurait exempté de divisions et de mises au pas. Le RND, considéré par Abdelhak Benhamouda, son principal inspirateur, comme «un rempart contre l’intégrisme et le fer de lance du patriotisme et de la démocratie», fut, après l’assassinat de ce dernier, récupéré et dévitalisé par celui de Tahar Benbaïbèche et Abdelkader Bensalah pour donner le RND d’Ahmed Ouyahia, une formation passée, sans transition, de l’éradication de l’islamisme à la réconciliation avec lui et du social-libéralisme au néo-capitalisme expansionniste. Toutes ces évolutions et involutions seront passées en revue et mesurées à l’aune des rapports que ces partis ont entretenus et continuent d’entretenir — via les autres institutions de la République — avec l’ANP ; le but étant de reconstituer les processus réels de production de la décision et, par conséquent, de cerner la part de réalité et la part de fiction du pouvoir dont ces formations sont supposées être porteuses, ou non, face ou sous la houlette de l’institution militaire.
B. E. M.
Prochainement : «Les partis dirigeants algériens» (2e partie) : «Le front de libération nationale : Des origines au Congrès de la Soummam»
P.S. : Mes pensées, très fortes, vont, en ces jours de victoire — toute relative —sur une infime partie du déni colonial français, à tous les intellectuels, historiens, auteurs, militants et citoyens algériens qui ont porté haut, par l’action, la parole ou la plume, pendant des décennies, le combat pour la vérité historique et la préservation de l’honneur et de la dignité de la mémoire du peuple algérien.
Ce combat se poursuivra jusqu’à ce que l’état français aura reconnu et assumé, au-delà du cas de Maurice Audin, sa responsabilité, pleine et entière, dans les crimes contre l’humanité qu’il a commis dans notre pays, de la conquête génocidaire de 1830 à la sale guerre livrée, sept années durant, par une armée sans foi ni loi contre des populations sans défense.
LES PARTIS DIRIGEANTS ALGÉRIENS (2e partie)
Le Front de libération nationale : des origines au Congrès de la Soummam
Publié par Badr’Eddine Mili
le 31.10.2018
De sa création, sous cette appellation œcuménique, à sa transformation en parti, au 4e congrès réuni, en 1979, le FLN muta, au moins, à quatre reprises. En vingt-cinq ans, il passa du statut de Front révolutionnaire, au faîte de sa gloire, qui fut le sien, entre 1954 et 1956, à celui de Front explosé, en 1962, entre groupe de Tlemcen et groupe de Tizi-Ouzou, puis de Front populiste de gauche, en 1964, redressé et réduit à la portion congrue d’Exécutif-Appareil, en 1965, pour ressusciter, en 1979 , après le décès du Président Houari Boumediène, dans le costume de Parti-Etat contrôlé par l’armée et la Haute Administration qui n’hésiteront pas à décréter sa déchéance, une fois emporté par la débâcle d’Octobre 1988.
Il cumula, aussi bien pendant la Révolution qu’après l’indépendance, toutes les vicissitudes, des schismes et des mises à mort aux retours gagnants, préservé, quand
même, après 1962, en dépit de ses avanies, comme vitrine, miroir, fonds de commerce ou machine électorale par les différentes directions du pouvoir d’Etat qui n’ont, à aucun moment, rechigné, au nom de leurs intérêts, à utiliser son Histoire, son mythe, sa culture politique et ses chevaux de Troie, toujours aussi fascinants, même dans les phases de reflux et de crucification les plus noires qu’il connut.
La séquence qui va de la Proclamation du 1er Novembre 1954 au Programme de Tripoli de juin 1962 fut, pour lui, aussi longue qu’éprouvante, à cause, d’abord, de la guerre fratricide que lui livra le MNA, à ses débuts, et dont il faudra, forcément, un jour, dresser l’effroyable bilan humain et politique et, dans une autre mesure, à cause de la terrible répression coloniale, avec son hécatombe de morts, de disparitions et d’arrestations et, aussi, ses règlements de comptes internes qui ont, lourdement, impacté le fonctionnement, le rendement et la stabilité de ses effectifs et de son encadrement.
Il est possible de diviser cette séquence en deux temps forts :
• le premier correspond à la prédominance des civils, à sa tête, incarnée par les 6, une direction, partiellement, reconduite, avec des modifications, par le Congrès de la Soummam, congrès de l’élargissement et de la synthèse ;
• le second coïncide avec leur éviction du cercle de la décision par «les militants en uniforme» laquelle fut, entièrement, consommée, par leur mise sous tutelle, au congrès de Tripoli, congrès de la double option du parti unique et de la voie de développement socialiste.
A ces étapes succéderont, après l’indépendance, deux autres au contenu et aux implications organiques et institutionnelles tout à fait opposées : celle du gouvernement de l’Etat par le parti et celle, consécutive au «réajustement» du 19 Juin 1965, qui imposa le gouvernement du parti par l’Etat, en attendant les suivantes qui lui feront subir les misères de son immersion dans le multipartisme, magiquement, gommées par un retour en force, sous le mandat de Abdelaziz Bouteflika, son président d’honneur.
Aux origines du Front de libération nationale
Le projet de fondation du FLN fut contemporain de la crise du MTLD qui divisa, au début des années 50, les rangs des militants en deux camps : «les centralistes», membres du comité central, entrés, sous la direction de Hocine Lahouel, secrétaire général, en sédition ouverte, contre leur président, et «les messalistes» conduits par un carré de fidèles s’appuyant sur une base inconditionnelle pour qui Messali Hadj devait rester le prophète intouchable, auréolé d’un culte de la personnalité proche de la divination, un fait assez rare dans la courte Histoire des formations politiques de cette époque.
1- De l’Organisation Spéciale au 1er Novembre 1954
Plus tôt, en février 1947, fut réuni à Zeddine, près de Rouina, dans la vallée de Chlef, dans une ambiance plus légaliste que révolutionnaire, le congrès extraordinaire du parti qui décida, dans la discrédition la plus totale, de créer, à l’instigation insistante de Mohamed Belouizdad, Ahmed Ben Bella, Hocine Aït Ahmed et Mohamed Boudiaf, en dehors de ses structures, une organisation paramilitaire clandestine — l’OS (Organisation Spéciale) — composée, en majorité, de soldats démobilisés choisis en raison de leur expérience au combat acquise au cours de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de leur engagement tranché en faveur de l’action radicale contre la puissance occupante.
Ce fut à ces assises que Hocine Aït Ahmed présenta son fameux exposé de polémologie sur la guerre de guérilla, un texte d’une acuité prospective saisissante, inspiré par la prise de conscience aiguë du peuple et des militants face à l’horreur des massacres du 8 Mai 1945.
Emmenés – dans sa première direction – par Mohamed Belouizdad secondé par un responsable militaire, Abdelkader Belhadj Djilali — une répartition des tâches reconduite dans l’organigramme du FLN de 1954 —, les membres de l’Organisation furent, pour des motifs de sécurité évidents, séparés des militants civils qui continuaient, eux, à activer, dans le cadre des statuts et du règlement intérieur en vigueur, à travers les canaux de la vie partisane normale, pour tout ce qui touchait à la discipline, au vote et à l’investiture dans les postes de responsabilité.
Le démantèlement de l’Organisation par la police française, le 18 mars 1950, sur dénonciation de l’un des siens, Khiari Abdelkader, se plaignant d’avoir fait l’objet de sévices de la part de ses responsables, changea la donne du tout au tout.
La direction du parti, fidèle à sa ligne électoraliste et tenant à demeurer en règle avec l’administration coloniale, la dissout, en 1951, en invitant ses membres à réintégrer les rangs, un appel auquel ces derniers – unitaires – répondront, positivement, en dehors de ceux qui étaient poursuivis par la police ou sous le coup d’une condamnation par contumace.
Il faut remarquer que l’OS — plus sourcée à l’esprit du PPA de 1937, du temps de la direction du Dr Mohamed Lamine Debaghine, qu’à celui du MTLD, mené par des dirigeants de moindre envergure — était restée, avant et après son échec, à l’écart des dissensions entre les factions concurrentes, plutôt focalisée sur l’intérêt qu’il y avait à rétablir, en priorité, l’unité du parti même si ses responsables étaient pressés d’aller au feu, de peur que le train des évènements d’Indochine, de Tunisie et du Maroc ne les relègue, à l’arrière, et ne les abandonne sur le quai du combat anti-colonial qui avait pris une longueur d’avance, à l’échelle internationale.
Le Crua (Comité révolutionnaire pour l’unité et l’action) qui vit le jour le 23 mars 1954, fut pensé, ainsi que son nom l’indique, comme un cadre rassembleur de toutes les forces du parti susceptibles d’être engagées dans la lutte sur une position offensive commune.
Les deux tendances qui le composaient – deux représentants de l’OS (Mohamed Boudiaf et Mostefa Ben Boulaïd) et deux représentants des centralistes (Bachir Dekhli et Ramdane Bouchebouba) – n’étant pas parvenues à s’entendre sur une sortie de crise allant dans ce sens, l’aile révolutionnaire du Crua, mise sous la pression des nouvelles en provenance du front indochinois, fut astreinte à passer à une vitesse supérieure.
La chute de Dien Bien Phu, le 6 mai 1954, lui offrit l’opportunité d’accélérer le processus de préparation, en multipliant les contacts pris au Caire et à Berne, entre Boudiaf, Ben Bella, Ben M’hidi, Didouche, Aït Ahmed, Khider, Lahouel et même – parce que l’espoir de partir unis dans l’action n’était pas, définitivement, perdu – avec Mezghana, un des proches de Messali Hadj et beau-frère de Mourad et Madjid Boukechoura, activistes de l’OS, visant à mettre en place une structure dirigeante chargée de coordonner la mise en œuvre de l’insurrection armée.
Décision est prise de réunir, le 25 juillet 1954, au domicile de Lyès Derriche, au Clos-Salembier (El-Madania), le groupe des 22.
Constitué, en grande partie, d’anciens de l’OS et originaires (16 sur 21) de l’Est parce qu’approchés par Mohamed Boudiaf qu’il connaissait personnellement, ou qui relevaient de son autorité, lorsqu’il était responsable de l’Organisation pour le Constantinois, le groupe désigna, à sa tête, le même Boudiaf assisté par Ben Boulaïd et Bitat. Ce choix et cette méthode de désignation furent critiqués par Abderrahmane Gherras, vieux routier du PPA-MTLD, non convoqué à la réunion, mais soutenu par son fidèle ancien adjoint, chef de l’OS du Sud-Oranais, Mohamed Mechati présent à la rencontre qu’il qualifia dans ses mémoires de «premier coup d’Etat du militaire contre le politique».
Après quoi, le bureau délégua Ben Boulaïd pour entreprendre une ultime médiation auprès de Messali Hadj.
Cette tentative de la dernière chance s’étant soldée par un résultat infructueux, plus aucun obstacle ne se dressait sur la voie de l’engagement armé, d’autant que le MTLD venait de se scinder en deux, après la tenue — séparément — des Congrès d’Hornu en Belgique (juin 1954) par les messalistes et d’Alger (août 1954) par les centralistes.
L’heure n’était plus aux atermoiements : le territoire national est divisé en 5 zones d’opérations : Aurès, Nord-Constantinois, Kabylie, Algérois et Oranie et rendez-vous est pris chez les frères Boukechoura, le 23 octobre 1954, dans leur maison du 24, rue Comte-Guillot, à la Pointe Pescade, où se retrouvèrent les 5, Boudiaf, coordinateur, Ben Boulaïd, Ben M’Hidi, Didouche et Bitat, chefs des zones militaires, rejoints par Krim Belkacem, en rupture avec Messali, et envoyé par la Kabylie pour la représenter dans la nouvelle direction.
C’est ce jour-là et dans cette demeure historique que la date du 1er Novembre fut retenue pour déclencher l’insurrection. La proclamation qui devait l’annoncer fut rédigée par Didouche et Boudiaf et confiée à ce dernier chargé de la remettre – en même temps qu’un tract de l’ALN et la liste des objectifs à attaquer dans la nuit du 31 octobre – à Ahmed Ben Bella, au Caire.
Le Crua, arrivé en fin de mission, transmit, alors, le flambeau au FLN, après avoir œuvré à la constitution d’une direction révolutionnaire dont son périodique Le Patriote se fit l’écho amplificateur, pendant sa brève existence, dans un contexte difficile vécu dans l’attente du feu vert par le peuple et les militants résolus à se battre.
Le succès des actions militaires programmées à l’insu de la police et de l’administration françaises, par les 6, dans les Aurès, en Kabylie et dans le Constantinois, attestèrent du bien-fondé de l’option militaire et signèrent les débuts réussis d’une guerre qui conduira, dans un long martyrologue, le peuple algérien à son indépendance et au rétablissement de son Etat éclipsé pendant 132 ans d’occupation et de déni.
De ce survol de la phase prérévolutionnaire du mouvement national indépendantiste, on retiendra trois éléments d’appréciation très instructifs quant à la signification que les fondateurs avaient voulu donner à leur projet et, à travers lui, au Front et à l’Armée de libération nationale.
a- Le FLN, bien qu’ayant résulté d’une concertation entre militants du MTLD, ne constituait, nullement, dans la perspective qu’ils s’étaient tracée, la continuation de leur ancien parti sous un autre sigle.
Le Crua et le groupe des 22 n’étaient, dans la programmation qu’ils avaient arrêtée, que des étapes nécessaires sur la voie du processus prérévolutionnaire et non une fin en soi et, encore moins, un artifice politicien sans lendemain.
De ce point de vue, le Front devait être perçu comme le dépassement, voire le surclassement, de toutes les enseignes qui l’avaient précédé dans le champ du mouvement national, des enseignes dont il s’empressa, dès le 1er Novembre, de se déclarer «totalement, indépendant».
b- La dénomination de «Front» avait été choisie, comme de bien entendu, pour affirmer son caractère rassembleur.
«Le Front, est-il écrit dans la Proclamation, offre la possibilité à tous les patriotes algériens de s’intégrer dans la lutte de libération sans aucune autre considération», une indication claire pour dire à l’intention du peuple, des militants et de l’opinion étrangère, que le Front était une entité transpartisane et non une addition de partis liés par un accord d’appareils révisable au gré des intérêts étroits de ceux qui y auraient adhéré.
c- Ce qui apparaît, dans cet acte fondateur, plus significatif encore, de l’essence politique de la préoccupation des initiateurs du 1er Novembre, réside dans le statut de dirigeants civils qu’ils s’étaient octroyé dans l’organigramme du mouvement, même s’ils avaient été amenés, pour les besoins de la cause, à coiffer des zones militaires.
Ils étaient dans la même situation que Ho Chi Minh, l’ex-étudiant vietnamien de Paris, fondateur du Vietminh.
Fidel Castro, Che Guevara, Nelson Mandela, Agosthino Neto, Amilcar Cabral, Samora Machel engagés dans le combat mondial contre le colonialisme et la dictature leur emboîtèrent le pas, plus tard, dans le même état d’esprit.
Boudiaf, Ben M’hidi, Didouche, Bitat, Ben Boulaïd, Krim Belkacem s’étaient présentés devant l’Histoire en révolutionnaires venus reprendre, par le moyen d’une guerre juste, ce que la colonisation avait ravi à leur peuple par le moyen d’une violence sans limites.
Du fait des responsabilités politico-militaires qui leur échurent, à la tête des wilayas du nouveau découpage territorial décidé, le Congrès de la Soummam éleva Krim, Ben M’hidi, Zighoud et Ben Boulaïd (à titre posthume), au grade de colonel, suivis de Boussouf, Bentobal, Benaouda, Ouamrane, mais Boudiaf, Ben Bella, Aït Ahmed, Khider restèrent responsables civils avec Abane, pourtant successeur de Rabah Bitat à la tête de la zone 4 (Algérois) après l’affectation de Ouamrane à la zone 3.
d- A partir des principes posés, le 10 octobre 1954, il coulait de source que, bien que couplés dans un binôme soudé, l’ALN n’était que le bras armé du FLN qui devait demeurer maître de l’initiative, tendu, par-dessus ses différences, vers un seul objectif : la libération ; une ambition qui ne vivra que le temps de l’euphorie de l’engagement, contrariée, dès la fin de 1956, par d’autres visées nourries, précisément, des disparités que le mouvement a voulu dépasser à la Soummam, dans un essai, volontariste, de synthèse, et que les redresseurs de 1957 et de 1959 ont ramenées à la surface pour les faire éclater, au grand jour, avec les conséquences que l’on sait.
e- Les 6 membres de la Direction avaient, avant de se séparer, le 23 octobre 1954, à la sortie du studio de photographie de Bab El-Oued où ils posèrent, avec une incroyable prémonition, pour la postérité, convenu de se retrouver, une fois le mouvement bien ancré au sein du peuple, dans le but d’évaluer ses effets et de définir les étapes qui devaient en assurer le prolongement et l’extension.
2- L’étape antérieure au Congrès de la Soummam
Quelques observations liminaires gagneraient, à ce stade, à être notées pour cerner, aussi bien l’environnement politique et militaire des préparatifs du congrès, que les facteurs qui ont concouru à ses conclusions.
Elle sont en nombre de trois :
a- Ce n’était pas chose aisée que de tenir un rassemblement aussi important dans une des zones de guerre les plus exposées et les plus surveillées. Prévu d’abord, par une lettre de Abane à Ben Bella, dans le Nord-Constantinois, près d’El-Milia, à l’invitation de Zighoud Youcef, le rendez-vous fut déplacé vers le territoire de la zone 3, dans un premier temps à la Qalaâ des Béni Abbès, puis sur les hauteurs d’Ouzalaguen surplombant la vallée de la Soummam où étaient stationnées de nombreuses garnisons et unités militaires françaises, fixes ou en mouvement.
La tâche ne s’annonçait guère facile, mais c’était compter sans ces hommes habitués, depuis le PPA, à participer à des congrès et à rédiger des textes doctrinaux, pièces maîtresses témoignant de la pertinence des travaux de réflexion effectués par le mouvement national indépendantiste.
Il suffit, aussi, d’avoir à l’esprit la fréquence et la célérité avec lesquelles ils se déplaçaient pour maintenir le contact entre eux et avec la base en empruntant tous les moyens disponibles, de l’avion et du bateau lorsqu’ils devaient se rendre en Europe ou au Moyen-Orient jusqu’aux cars et aux bêtes de somme qui les acheminaient, clandestinement, vers les innombrables points de chute et les refuges disséminés sur tout le territoire national, du Tell au Sahara, ainsi que Mohamed Mechati le raconta dans Parcours d’un militant.
En fin de compte, ils y parvinrent grâce à un travail organisationnel et sécuritaire méticuleux auquel veillèrent les hôtes de l’évènement : Amirouche, Dehilès, Mira, H’mimi, Mohammedi Saïd, membres du comité qui accueillit et accompagna, à travers la zone 4, jusqu’à la Petite Kabylie, Krim, Ben M’hidi, Zighoud, Bentobbal, Abane, Ouamrane et Benaouda, les dirigeants de l’extérieur ayant fait faux bond, Ben Boulaïd et Didouche tombés au champ d’honneur, Rabah Bitat arrêté et Ali Mellah, commandant la zone du Sud, absent pour une raison indéterminée.
b- Le congrès se réunit, une année, jour pour jour, après que le face-à-face FLN-armée d’occupation eut pris une autre tournure avec l’offensive, lancée par Zighoud Youcef, dans le Nord-Constantinois, qui transforma l’insurrection en guerre totale, un évènement d’une grande résonance nationale et internationale.
Les opérations combinées par l’ALN contre les positions de l’armée française et de ses relais ultras fut la première et la plus grande des batailles de la Révolution, celle qui poussa les gouvernements de la IVe République à faire voter les pouvoirs spéciaux et à battre le rappel des réservistes et du contingent pour venir à bout de ce qu’ils désignaient par l’euphémisme réducteur «d’évènements».
L’effet désintégration ne toucha pas, seulement, le dispositif politico-militaire français désarçonné et obligé d’engager les grands moyens — associés à ceux de l’OTAN – pour limiter les dégâts et prévenir une contagion plus étendue.
Le 20 Août 1955 eut une conséquence plus magistrale qui déjoua les pronostics de l’administration coloniale en réussissant à avoir raison de l’entre-deux des centralistes, des réformistes et des communistes.
Il poussa les forces attentistes à se déterminer et à prendre fait et cause pour la Révolution en la rejoignant, débarrassées de leurs étiquettes partisanes, la condition posée par les insurgés.
c- Ces avancées militaires et politiques qui ont conforté les bases de la Révolution et rendu le Congrès de la Soummam possible ne sauraient, cependant, faire oublier qu’elles furent obtenues en payant le prix fort. Les morts au champ d’honneur, les arrestations, l’expatriation de plusieurs dirigeants, ouvrirent de nombreuses brèches dans la chaîne du commandement : la disparition de Benabdelmalek Ramdane, le premier martyr tombé les armes à la main, le 1er Novembre même, à Cassaigne, suivi, le 18 janvier 1956 de Didouche Mourad, chef de la zone 2 (Nord- Constantinois) non loin de Philippeville (Skikda) ; l’arrestation, à La Casbah, de Rabah Bitat, chef de la zone 4 (Algérois), peu de temps après le début de la guerre, puis de Mostefa Ben Boulaïd, chef de la zone 1 (Aurès-Nememchas), incarcéré à la prison de Constantine d’où il s’évada, en compagnie de Tahar Z’biri, avant d’être victime de l’explosion d’un poste radio piégé parachuté d’un hélicoptère en mars 1956 ; des pertes considérables ayant atteint, de plein fouet, la direction historique du FLN, complétées par la mise en détention de plusieurs ex-membres du groupe des 22 – Lamoudi, Merzougui, Bouarroudj, Bouchaïb –, le départ de Mohamed Boudiaf et de plusieurs ex-membres de l’OS missionnés pour structurer la Fédération de France, précédés du décès prématuré, en 1952, de Mohamed Belouizdad et les assassinats de Mohamed Bouras, Rédha Houhou, Cheikh Larbi Tebessi et Aïssat Idir, perpétrés dans le continuum des décapitations, de l’emprisonnement et des déportations des tribus de la résistance et de leurs chefs, de Cheikh El-Mokrani et Boubaghla à Cheikh Bouamama, Cheikh El-Haddad, Boumaza, Benchohra et Cheikh Amoud.
C’est dire le poids immense de la responsabilité qui allait peser sur les épaules des congressistes auxquels revenait la tâche de doter la Révolution d’une vision à long terme et d’un Etat à la hauteur de sa nouvelle stature.
B. E. M.
N. B. : Pour les lecteurs intéressés à approfondir les points traités dans ce compte rendu sur les origines et les mutations du FLN, il est recommandé de consulter les mémoires, les témoignages et les travaux effectués, sur le sujet, par Mohamed Boudiaf, Rabah Bitat, Hocine Aït Ahmed, Abdeslam Habachi, Mohamed Mechati, Amar Benaouda, Abdelkader Lamoudi, Ahmed Doum, Ali Mahsas, Bachir Boumaza, Tahar Z’biri, Ferhat Abbas, Benyoucef Benkhedda, Mohamed Said Mazouzi, Rédha Malek, Lamine Khane, Belaïd Abdeslam, Saâd Dahleb, Tewfik El-Madani, Cheikh Bachir El-Ibrahimi, Chadli Bendjedid, Mostefa Lacheraf, Aïssa Kechida, Pierre et Claudine Chaulet, Mabrouk Belhocine, Yacef Saâdi, Djamila Bouhired, Zohra Drif, Meriem Belmihoub, Isa Abane, Louisette Ighil Ahriz, Fatima Ouzegane, Lotfi Boudeghane, Amar Ouzegane, Mohamed Lebdjaoui, Abdelhafid Amokrane, Youcef Khatib, Ahmed Taleb El-Ibrahimi, Commandant Azzeddine, Laroussi Khelifa, Abdelkrim Hassani El Ghaouti, Hocine Ben Maâlam, Omar Oussedik, Omar Boudaoud, Ali Haroun, Mohamed Akli Benyounes, Boualem Bourouiba, Mohamed Chérif Sahli, Mohamed Harbi, Bachir Hadj Ali, Sadek Hadjerès, Henri Alleg, Germaine Tillon, Francis Jeanson, Alice Cherki, Mohamed Teguia, Belkacem Saâdallah, Mahfoud Keddache, Mahfoud Bennoune, Zoheir Ihaddaden , Slimane Chikh, Daho Djerbal, Ali El-Kenz…
Prochainement : «Les partis dirigeants algériens» (3e Partie) «FLN : de la synthèse de la Soummam au schisme de Tripoli».
LES PARTIS DIRIGEANTS ALGÉRIENS
Le FLN historique : de la synthèse de la Soummam au schisme de Tripoli (3e partie)
Publié par Badr’Eddine Mili
le 28.11.2018
Evènement capital dans l’Histoire de la jeune Révolution algérienne, le Congrès de la Soummam, par les participants qu’il a réunis, les textes qu’il a rédigés, les décisions qu’il a prises et les répercussions politico-militaires qu’il a eues, fut et continue d’être le premier et unique congrès du FLN à avoir été, aussi longtemps et aussi longuement, analysé et commenté, parce qu’il a, d’un avis général, apporté à la problématique de la lutte de libération — dans ses portées politique et institutionnelle, nationale et internationale — des réponses neuves, audacieuses et adaptées aux exigences du contexte de l’heure et du long terme.
Le propos n’est pas, ici, de glorifier, ou de disqualifier, ce congrès et ses textes mais, simplement, de les comprendre et d’en tirer les enseignements utiles à l’écriture, sans passion, de leur Histoire.
1- Les participants
Les congressistes de la Soummam – essentiellement, pour rappel, Ben M’hidi, Abane, Krim, Zighout, Bentobal, Benaouda, Ouamrane, Dehiles… — étaient des dirigeants qui se connaissaient bien, grandis dans le creuset du PPA-MTLD dont ils avaient vécu les moments durs, des massacres du 8 Mai 1945 et de la crise berbériste de 1949 à l’implosion du parti, encore vivaces dans leur conscience.
Venus d’horizons sociaux voisins, ils étaient porteurs de la diversité des cultures et des langues de leur peuple, mais, par-dessus tout, de ses fortes aspirations communes, déterminés à transformer les professions de foi théoriques de la Proclamation du 1er Novembre en actes fondateurs d’une nouvelle réalité politique, sociale et morale de l’être national algérien. Il serait présomptueux de vouloir sonder, rétrospectivement, leurs états d’âme et de chercher à connaître les intentions et les ambitions qu’ils nourrissaient, secrètement, pour le mouvement ou pour eux-mêmes. De telles informations, si elles avaient été disponibles, auraient, bien sûr, permis d’éclairer, pour les besoins de la vérité historique, certains aspects des décisions qu’ils avaient prises, les désaccords et les non-dits qui les avaient, sans doute, entourés.
Ce qui peut, cependant, être tenu pour certain c’est que ces hommes – «ni anges ni démons» — étaient des pragmatiques dont on aurait pu tout penser sauf qu’ils n’avaient pas les pieds sur terre. Comment, autrement, s’y seraient-ils pris pour énoncer, proposer, débattre et adopter des textes chargés d’autant de cohérence et de sens de la prévision ?
2- Les rédacteurs
La première mouture du projet de la Plateforme discuté par les participants fut rédigée par une commission dont le principe a été arrêté au printemps 1956. Il n’est, nulle part, certifié que le texte final fut l’exacte réplique du brouillon commandé par la direction de la Zone 4. Les recoupements effectués par les historiens autorisent, toutefois, à affirmer que la trame du texte adopté, à la fin des travaux, avait repris les principaux éléments de l’état des lieux et des propositions élaborés par la commission.
La composition de celle-ci correspondait, déjà, à l’esprit d’ouverture et d’intégration que Ben M’hidi et Abane comptaient imprimer au congrès. Etaient, en effet, représentées au sein du panel les principales sensibilités partisanes ralliées à la Révolution.
En plus de Ben M’hidi et Abane, il y avait, là, Benyoucef Benkhedda, Saâd Dahleb, Abdelmalek Temmam, anciens cadres du MTLD, ainsi que Amar Ouzegane, un des premiers secrétaires généraux du Parti communiste algérien, révoqué par sa direction pour avoir traité, le 8 mai 1945, des militants du PPA, «d’agents hitlériens», avant de collaborer au Jeune Musulman d’Ahmed Taleb El-Ibrahimi puis de se réconcilier avec le parti de Messali.
Les autres rédacteurs du texte étaient Mohamed Lebdjaoui, futur dirigeant de la Fédération FLN de France, et Abderazzak Chentouf, avocat et ancien militant de l’Etoile nord-africaine proches des milieux nationalistes de la bourgeoisie algéroise.
3- Les textes
Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur la Plateforme et ses résolutions préconisant les fameuses primautés du politique et de l’intérieur, mais peu ont fait ressortir, comme il se doit, son apport à l’ébauche des premières incarnations institutionnelles de l’Etat révolutionnaire que certains historiens, ont, volontairement, ou non, éludé au profit de l’Etat de la Régence ottomane et de l’Etat de l’Emir Abdelkader présentés – à tort pour le premier – comme les précurseurs de l’Etat algérien indépendant. Même s’ils étaient, linéairement, rattachés à l’héritage de la résistance nationale de 1830, les premiers actes de cet Etat révolutionnaire n’en avaient, pas moins, revêtu la forme d’une conquête moderne qui dota l’Algérie au combat, du sommet à la base, de structures et de moyens d’administration et de représentation, absolument, souverains et différents, par nature et par vocation, de ceux de la puissance occupante.
a- Au sommet, il fut décidé l’institution d’un Comité de coordination et d’exécution (CCE), le premier gouvernement de l’histoire de la Révolution et d’un Conseil national (CNRA), instance suprême, premier parlement représentatif des principaux courants rangés sous la bannière du FLN.
Aussi stratégiques qu’elles aient pu être, ces décisions auraient été incomplètes, si elles n’avaient pas été accompagnées par la structuration de l’ALN sur la base d’un nouveau découpage territorial, de mécanismes de fonctionnement et de procédures d’avancement et de discipline qui en firent une armée organisée et hiérarchisée enrichissant les traditions militaires de l’Algérie historique.
b- A la base, furent installées des structures de proximité nécessaires à l’administration des affaires publiques de la population qui avait, désormais, la possibilité d’actionner des moyens de droit, indépendants, pour régler les problèmes de la vie courante.
L’enregistrement des actes d’état-civil auprès de l’OCFLN et la saisine des tribunaux de la Révolution ayant pouvoir de connaître des litiges entre justiciables nationaux constituèrent, de ce point de vue, les manifestations pratiques les plus perceptibles de cet Etat.
Cette organisation a servi, en particulier dans les zones rurales, non seulement, à soustraire le quotidien du peuple à l’arbitraire de l’autorité coloniale, mais aussi à établir un climat de confiance dans les relations entre le FLN et les citoyens, entachées, au tout début, par des atteintes à l’intégrité physique des personnes – égorgements et mutilations – déshonorantes pour l’image du Front.
Quelles aient concerné l’administration ou la protection des populations, ces décisions changèrent, sensiblement, les rapports sociaux, remettant en question, entre autres, les dispositions relatives à la condition des femmes, ces dernières — en commençant par les combattantes du maquis — s’étant vues mieux traitées grâce à la codification des valeurs d’égalité et d’émancipation defendues par un Etat qui s’était déclaré, d’emblée, antiféodal.
c- L’architecture de la construction institutionnelle— le socle sur lequel la Révolution allait vivre, agir et progresser, pendant des années — avait besoin de reposer sur des normes logiques— primauté de l’intérieur sur l’extérieur et du politique sur le militaire — dont l’usage était répandu dans les révolutions similaires.
La direction de la Révolution fut, à ce titre, confiée aux civils ainsi que la pratique l’avait établi pour le groupe des 22 et des 6. Installée sur le territoire national et chargée de la conduite de la guerre et de l’action politique et diplomatique, il apparut à cette direction impossible d’accepter de partager ses prérogatives avec les militaires et la délégation extérieure, l’objectif étant, pour elle, de vaincre le système colonial, à partir de l’intérieur et dans le cadre d’une formation à commandement civil et non le contraire.
d- Quant à la condamnation du messalisme et du berbérisme qui n’avait fait l’objet d’aucune réserve, elle s’expliquerait par le fait que la bataille entre le FLN et les messalistes du MNA battait son plein et que les dirigeants gardaient, certainement, encore présents à l’esprit les stigmates de la crise de 1949, craignant que les deux courants ne viennent casser la dynamique unitaire de la Révolution. Que Krim, Abane, Ouamrane et leurs compagnons Dehiles, Amirouche, H’mimi, Mohammedi Saïd, Mira, Abdelhafid Amokrane aient souscrit à cette condamnation était révélateur de la volonté générale de préserver l’unité d’action, en privilégiant la question nationale sur celle de l’identité qui fut le cheval de bataille d’Aït Ahmed contre Messali à qui il reprochait son rapprochement avec les leaders de l’arabisme et du réformisme musulman moyen-oriental. Il faut dire, à la décharge de celui-ci, qu’il ne s’y était résolu que parce qu’il fut déçu par les tergiversations du Komintern au sujet de «l’émancipation des Nations d’Orient» subordonnée à «la conquête du pouvoir par le prolétariat dans les pays colonisateurs».
4- Les décisions
Elargissement et synthèse furent les deux leitmotivs d’un congrès, protégé, faut-il le rappeler, par une ceinture de sécurité insoupçonnée des services de renseignements français qui essuyèrent, en la circonstance, un revers sanctionnant leur faible maîtrise de l’évènement dont ils ne prirent connaissance — sur le tard — qu’après avoir compulsé les documents transportés par une monture qui avait fui lors d’un accrochage entre le comité d’accueil des congressistes et une unité de militaires français.
Comme tout le monde le sait, les débats furent dirigés par Larbi Ben M’hidi à la présidence et, au secrétariat, par Abane Ramdane, le leader politique, en pleine ascension, qui prit la relève de Rabah Bitat à la tête de l’Algérois, une zone qu’il transforma en base avancée, à fort potentiel médiatique, plantée au cœur du dispositif répressif de l’armée d’occupation.
Et comme attendu, la désignation des membres des nouvelles instances de direction s’effectua en phase avec la ligne du congrès axée, donc, sur :
a- l’élargissement :
Le congrès se fit un devoir d’appliquer, à la lettre, l’appel lancé par la Proclamation du 1er Novembre à tous les patriotes de rejoindre la Révolution «sans aucune autre considération» se félicitant d’avoir obtenu le ralliement au FLN de ceux qui défendaient, jusque-là, la voie du dialogue et de la paix avec l’administration coloniale. L’élargissement de la base sociale de la Révolution à la frange nationaliste de la bourgeoisie, à la classe ouvrière et aux élites intellectuelles était une victoire stratégique remportée sur la politique algérienne de la France pour qui l’insurrection était une affaire de hors-la-loi dépourvus d’ancrage social et de vision politique.
Le démenti à cette théorie fut, déjà , apporté par Ferhat Abbas, à son départ, en 1955, pour Tunis, après avoir dissous l’UDMA, déclarant que «dès lors que le sang a coulé» il n’y avait plus d’autre alternative que de s’engager aux côtés de la lutte du peuple.
b- la synthèse :
La conséquence de cet élargissement de la base de la Révolution se traduisit, organiquement, par l’intégration des centralistes, des udmistes et des ulémistes au CCE composé de 5 membres et au CNRA comptant 34 membres (17 titulaires et 17 suppléants). Se retrouvèrent au CNRA, en tant que titulaires, Ferhat Abbas, Benyoucef Benkhedda, Tewfik El-Madani, M’hammed Yazid, Lamine Debaghine tandis que Lakhdar Bentobal et Abdelhafid Boussouf — membres de la première vague de l’insurrection — furent relégués au rang de suppléants, un classement, aussitôt, contesté.
La même chose se produisit au CCE où Benyoucef Benkhedda et Saâd Dahleb, des centralistes indécis sur l’engagement armé, en 1954, siégèrent, sur un pied d’égalité, aux côtés de Larbi Ben M’hidi et de Krim Belkacem, des «amalgames» qui serviront de détonateur à une crise aiguë qui fit convoquer le CNRA, au Caire, en 1957, appelé à revoir sa copie.
L’entrée massive au FLN des ailes modérées du Mouvement national eut pour effet de multiplier le nombre des intervenants dans le concert d’une direction jusque-là réservée, uniquement, aux anciens de l’OS, des 22 et aux 6, une évolution qui, aux yeux des orthodoxes inquiets, risquait d’altérer, voire de dénaturer la ligne initiale du mouvement.
Les candidats à un rôle d’influence dans les institutions post-Soummam se recrutaient parmi les élites.
D’extraction sociale assez différenciée, celles-ci ne formaient pas un corps homogène doté d’une identité et d’un pouvoir autonomes.
Chacune de leurs composantes avait son point de fixation sociale : la petite bourgeoisie urbaine pour les unes et les couches moyennes de la paysannerie pour les autres. Cet ancrage, associé à leur formation, déterminait leurs apparentements idéologiques et leurs conduites politiques.
Telles que représentées dans le spectre qui les regroupait, formellement, ces élites se répartissaient entre deux blocs cloisonnés.
– Au premier appartenaient des penseurs, des dirigeants des syndicats estudiantins et des représentants des professions libérales, liés par les mêmes cursus universitaires, des références intellectuelles modernistes et l’usage courant de la langue française.
Ils ont adhéré au FLN après avoir fait leurs classes dans le militantisme corporatif ou, pour les aînés, dans le PPA-MTLD et, même, dans l’Etoile nord-africaine.
Médecins, avocats, écrivains, journalistes, ils furent affectés, dès le départ, à l’exécution de tâches en relation avec la diplomatie, l’information, l’administration et, pour les historiens et les sociologues, dans le travail de réflexion dont il leur arrivait de publier les textes dans les revues de renom qui soutenaient la cause algérienne comme Esprit, La Pensée et Les Temps modernes.
Rédha Malek, Mohamed Seddik Benyahia, Abdelmalek Benhabylès, Belaïd Abdeslam, Lakhdar Brahimi, M’hammed Yazid, Mohamed Seghir Mostefaï, Mostefa Lacheraf, Tayeb Boulahrouf, Brahim Mezhoudi, Omar Oussedik, Abdelmalek Temmam, Ahmed Boumendjel, Abdelhafid Keramane, Amar Bentoumi, Ali Yahia Abdenour, Mohamed Khemisti, Layachi Yaker, Abdelhamid Adjali, Hocine Djoudi Messaoud Aït Chaâlal, Mohamed Lebdjaoui, Mabrouk Belhocine, Salah Louanchi, Hadj Smaïn, Mohamed Sahnoun, Abdelkader Benkaci, Abdelkader Chanderli, Mohamed Khelladi, Abdelkrim Benmahmoud, Nafissa Chentouf, Messaoudi Zitouni, Mohamed Boureghda, Mohamed Harbi, Mohamed Chérif Sahli, Houari Moufok, Ahmed Mahi gravitèrent, à divers niveaux, autour de la galaxie du CCE, du CNRA et du GPRA, dans les cabinets ministériels, les syndicats étudiants, les médias ou les ambassades ouvertes auprès des capitales des pays amis.
D’autres intellectuels et étudiants s’étaient, directement, engagés dans l’ALN qu’ils servirent, en actifs ou en formation, dans les armes des transmissions, du génie, de la médecine militaire, des blindés, de l’aviation et, pour quelques-uns, dans les secrétariats des état-majors des wilayas.
Mohamed Boukharouba, Ali Kafi, Amara Rachid, Taleb Abderrahmane, Hassiba Ben Bouali, Lotfi Boudghène, Azzeddine Zerari, Salim Saâdi, Hocine Benmaâlem, Lakhdar Rebah, Abdelkrim Hassani El-Ghaouti, Laroussi Khalifa, Chérif Belkacem, Abdelaziz Bouteflika, Boualem Bessaieh, Abdelhamid Temmar, Abdelhamid Brahimi, Kasdi Merbah, Nourredine Zerhouni, Mohamed Lemkami, Abderahmane Laghouati, Abderazzak Bouhara, Saïd Aït Messaoudène, Mourad Benachenhou, Mohamed Terbeche, Ahmed Benai, Mokhtar Maherzi, Hachemi Cherif, Abderahmane Chergou, Abdelaziz Zerdani, Abdelaziz Maoui, Abdelmadjid Aouchiche, El Hachemi Hadjeres, Mohamed Alleg, Abdelhamid Latreche, Mouloud Hamrouche, les DRS Benaouda Benzerdjeb, Tidjani Haddam, Bachir Mentouri, Omar Boudjellab, Mohamed Toumi, Mohamed Seghir Nekkache, Mahmoud Atsamena, Abdelhalim Medjaoui, Abdelaziz Khelfallah, dit Mostefa Boutmaira, et Adjaoud Rachid, ces deux derniers, respectivement, chef de la zone 5 et assistants du colonel Salah Boubnider, à la Wilaya II et du colonel Amirouche à la Wilaya III.
– Le second bloc, animé par le leader de l’Association des Ulémas algériens, Cheikh Bachir El-Ibrahimi, très actif dans la presse écrite, les radios et les universités d’Égypte, des pays du Golfe et des pays musulmans d’Asie où il contribua à populariser la cause nationale, rassemblait les intellectuels arabophones qui avaient suivi leur formation sur les bancs de l’école badisienne, de la Zitouna et d’El-Azhar où on enseignait la réforme de l’Islam en vogue dans le mouvement de la Nahda.
Historiens, philosophes, poètes, prédicateurs, ils avaient, eux aussi, commencé à écrire ou à éditer leurs œuvres à l’exemple de Malek Bennabi, Mohamed Laïd El-Khalifa, Ahmed Aroua, Tewfik El-Madani, Cheikh Ahmed Hamani, Ahmed Taleb El-Ibrahimi, Mouloud Kassem, Mohamed El Mili, Cheikh Yalaoui, Abdelhafid Amokrane sous la protection desquels activaient les étudiants Abdelkader Hadjar, Othmane Saadi, Abdellah Rekibi, Abdelkader Nour….
Leur discours réservait une place prépondérante à l’apologie de l’Islam présenté comme une référence idéologique majeure de la Révolution de Novembre.
Il faut, néanmoins, signaler que tous les intellectuels arabophones – ou bilingues – ne partageaient pas, obligatoirement, cette orientation ; nombreux étaient ceux qui défendaient, à partir de leur position d’hommes de culture ou de communication, un nationalisme moins marqué, religieusement : Moufdi Zakaria, Abdelhamid Mehri, Larbi Demagh El Atrous, Aïssa Messaoudi, Lamine Bechichi, Belkacem Saâdallah, Abdelmadjid Meziane, Madani Haoues, Mahfoud Keddache, Lazhari et Abdellah Cheriet, Mahieddine Amimour, les équipes rédactionelles d’El Moudjahid, de La Voix de l’Algérie combattante et de l’APS… en faisaient partie.
Cette mobilisation de sensibilités, au centre ou à la périphérie de la Direction, relança la guerre des chapelles avec toutes les retombées préjudiciables qu’elle pouvait entraîner sur le rendement de l’action révolutionnaire.
L’absence de passerelles entre elles fit que, finalement, ni les unes ni les autres n’arrivèrent à prendre le dessus et réduisirent leur marge de manœuvre jusqu’à se neutraliser cédant l’initiative aux «militants en uniforme» dont la colonne vertébrale était formée par les officiers de l’armée des frontières et «les Malgaches» cités ci-dessus. Entre cléricalisme et laïcité, droitisation et gauchisation – clivages reproduits, à l’indépendance, par les partis marxistes et les partis islamistes –, la Révolution tenta de garder le cap sur les dénominateurs communs identifiés par la Proclamation de 1954, sans, toutefois, produire de nouveaux instruments conceptuels capables de l’immuniser contre les débordements des uns et des autres, autrement qu’en jouant, surtout après 1965, sur l’équilibre entre «socialisme spécifique» et «islam progressiste», l’exercice dans lequel Houari Boumediène excella, à travers la Charte nationale de 1976, les séminaires sur la pensée islamique ou les déclarations du type qu’il fit à Lahore, au Pakistan, lors d’un sommet de l’OCI.
5- Les répercussions politico-militaires
Les décisions prises à la Soummam eurent un retentissement immédiat, assez négatif, dans les maquis et au Caire où la délégation extérieure, par la voix d’Ahmed Ben Bella, soutenu par Mohamed Boudiaf, les déclara de nul effet.
Motivées par des raisons propres à chaque partie, les réactions hostiles des militaires et des principaux chefs historiques, encore vivants, n’avaient pas de quoi étonner.
Elles étaient, dans une certaine mesure, attendues, après que ces derniers se soient abstenus de réserver une suite favorable à l’invitation de Abane.
On ignore si cette défection était intervenue à la prise de connaissance anticipée des documents du congrès ou non ; le fait est qu’elle signifiait, clairement, le rejet et du contenu de ces textes et plus fondamentalement du principe même de la rencontre, qu’ils envisageaient, vraisemblablement, sous un angle différent.
Les évènements ultérieurs le confirmeront puisqu’une année plus tard, en août 1957, la session du CNRA réunie au Caire, à l’initiative de Krim Belkacem, le seul membre des 6 encore en activité, expurgera la plateforme de ses parties contestées, révisera l’ordre de préséance de ses membres, entre titulaires et suppléants, et ouvrira ses portes à de nouveaux venus, «les militants en uniforme» des Wilayas I et V, Mahmoud Chérif et Houari Boumediene, les dirigeants de la nouvelle génération qui feront, bientôt, parler d’eux, le premier au CCE, puis dans le futur GPRA, aux côtés de Krim, Boussouf et Bentobal, et le second à l’EMG de l’armée des frontières qu’il entrevoyait dans sa stratégie de conquête du pouvoir total comme le moyen le plus dissuasif à opposer au wilayisme développé par les chefs de l’intérieur et au noyau des centralistes et des réformistes du GPRA considérés comme un danger à prendre au sérieux. Pour en arriver là, il avait fallu que se produisirent des évènements de grande ampleur renversant, de fond en comble, les rapports de force et rendant possible le virage à 180° pris au Caire.
* En quelques mois, la direction de la Révolution fut étêtée du reste de ses membres :
– rejoignant Didouche, Souidani, Badji Mokhtar, Ben Boulaïd, Zighoud Youcef tombent au champ d’honneur, en septembre 1956, sur le chemin du retour vers le PC de la Wilaya II, en provenance de la Soummam ;
– les quatre principaux chefs de la Révolution (Boudiaf, Ben Bella, Aït Ahmed et Khider) sont emprisonnés après l’arraisonnement, le 22 octobre 1956, de leur avion, en provenance du Maroc ;
– l’arrestation, en février 1957, de Larbi Ben M’hidi par les parachutistes de Bigeard et son assassinat par Aussaresses met un terme à la bataille d’Alger déclarée par le général Massu contre la Zone autonome.
La répression qui s’abattit sur le FLN entraîna l’effondrement de la pyramide de l’Organisation avec l’arrestation de son chef, Yacef Saâdi, et la mort de ses compagnons Hassiba Ben Bouali, Ali La Pointe et Yacef Omar, dans leur cache de la rue des Abderames explosée par les artificiers militaires français.
L’échec de la grève des 8 jours de janvier 1957 et les pertes enregistrées par les fidaïne et la population poussa le CCE – Abane, Ben Khedda, Dahleb, sans Ben M’hidi, arrêté – à quitter Alger pour Tunis plutôt que de se retirer sur les arrières sûrs des Wilayas I et II, une erreur stratégique d’après les combattants de l’intérieur.
Ce déplacement, décidé dans la précipitation, détériorera, encore plus, les relations entre les politiques et «les militants en uniforme» et entre l’intérieur et le nouvel extérieur, le CCE devenant la cible des accusations d’impéritie portées, auparavant, par les chefs de wilaya – Amirouche, Si El Haoues… — contre les représentants du Front à Tunis et au Caire, au sujet de l’insuffisance de l’approvisionnement du maquis en armes.
* La Révolution prenait, à ce stade, un tournant dangereux pour sa survie, un tournant qui exigeait, selon les responsables à l’origine de la convocation de la session du CNRA, un retour impératif aux sources, c’est-à-dire à la ligne de la Proclamation du 1er Novembre et à la collégialité.
Ce retour passait, donc, par une remise en cause de la construction politico-idéologique du Congrès de la Soummam dénoncée comme un complot déviationniste monté par «les ralliés», une façon d’incriminer Abane et d’instruire, contre lui, un procès qui se conclut par son éloignement du centre de la décision et son assassinat à Tétouan. Concrètement, les retombées de ce redressement se traduiront par la désignation :
– d’un nouveau CCE qui passera de 5 à 9 membres : Krim, Abane, Boussouf, Bentobal, Mahmoud Chérif, Ouamrane, Debaghine, Mehri, Abbas moins les centralistes impliqués dans «la déviation» ;
– et d’un Conseil national de 54 membres où siégeront, à part entière, les ex-suppléants rejoints par Benyahia et Mezhoudi, les futurs chefs de cabinet de Ferhat Abbas, à la présidence du GPRA.
La toute fraîche ligne de séparation entre «militants en uniforme» et militants civils, entre l’intérieur et l’extérieur, fut, purement et simplement, effacée, au terme de la résolution finale adoptée par le Conseil. «Tous égaux», avait-elle déclaré : la route vers le pouvoir convoité par les militaires, au nom de «la pureté révolutionnaire», était grande ouverte. Il leur fallait, tout juste, patienter, un peu, pour s’en saisir totalement.
En attendant, appuyés par les nouveaux colonels, Krim, Boussouf et Bentobal sortirent de l’opération grands vainqueurs et pouvaient régner sur le CCE, sans adversaire. Le triumvirat verra le registre de ses pouvoirs s’élargir, dans une mesure plus importante, avec l’avènement du GPRA dont ils décidèrent du principe, pour conférer à la Révolution une représentativité et une audience internationales. Celui-ci fut annoncé, au Caire, le 18 septembre 1958, par son président Ferhat Abbas dont on ne savait pas, encore, s’il allait être un simple faire-valoir ou un atome libre fidèle à sa réputation d’homme difficilement manipulable.
L’avenir dira tout l’inconfort d’un chef de gouvernement démuni des moyens de gouverner, d’où les cassures qui accompagnèrent le 2e GPRA (18 janvier 1960) et le 3e dirigé par l’ancien centraliste Benyoucef Benkhedda (9 août 1961). Le remplacement de Ferhat Abbas par ce dernier, considéré comme de moindre mal, fut décrété au moment où celui-ci aspirait, sans doute, légitimement, à conduire la délégation du FLN aux négociations avec le gouvernement français qui pointaient à l’horizon.
Mais le noyau dur du GPRA avait, là-dessus, une toute autre idée tout comme, d’ailleurs le général de Gaulle. Celui-ci comptait poursuivre les contacts avec les militaires du FLN, même après l’échec de ses pourparlers sur «la paix des braves» avec le colonel Mohamed Zaâmoum, chef de la Wilaya IV, plutôt que de discuter de l’avenir de l’Algérie avec Ferhat Abbas à propos de qui il avait dit, en privé : «Qu’est-ce que ce Ferhat Abbas qui est marié avec une Allemande ?», sous-entendu «une nazie», Mme Stœtzel, en fait une Française d’origine alsacienne, militante de l’Udma, convertie à l’islam, un dérapage dont il s’excusera, tardivement, après l’indépendance, auprès de l’intéressé en lui dédicaçant ses Mémoires.
Avant cela, en 1959, le CNRA sera, de nouveau, invité à se réunir, en conclave, au Caire avec les colonels de l’ALN, la plupart étant devenus membres de «l’extérieur» (Kafi, Mendjeli, Dehilès, Ouamrane, Hadj Lakhdar, Othmane, Kaïd Ahmed, Yazourène, Zerari, Boumediène… les seuls à être restés au maquis étaient Zbiri, Boubnider, Mohand Oul Hadj, Bounaâma, Khatib, Chaâbani.)
L’ordre du jour proposé laissait, clairement, entendre, que toutes les initiatives engagées par le GPRA, dans le sens des négociations, étaient scrutées, de très près, par les «militants en uniforme», une surveillance dont les résultats apparaîtront, au grand jour, après la signature, le 18 mars 1962, des Accords d’ Evian entre Krim Belkacem et Louis Joxe.
Le colonel Houari Boumediène était à la manœuvre, servi par la normalisation de la dissidence de la base de l’Est et la mésentente entre les détenus du château d’Aulnoy. Tout en brandissant, dans son bras de fer avec le GPRA, une menace de démission, dilatoire, il envoya Abdelaziz Bouteflika sonder les intentions de Boudiaf, Aït Ahmed et Ben Bella sur leur disponibilité à diriger l’Etat indépendant dont l’avènement était proche.
Après plusieurs coups de théâtre et des milliers de morts dues à la politique de la terre brûlée de l’OAS, le congrès de Tripoli sur lequel pesait, déjà, de lourdes incertitudes, se réunit, accueillant un aréopage de participants à forte teneur explosive : les dirigeants de la Révolution libérés d’Aulnoy, les chefs de wilaya, le GPRA, le CNRA, les centralistes, les udmistes, les ulémistes, les chefs de la Fédération de France, les délégués des organisations syndicales, tout ce que la guerre avait drainé dans un fleuve de rancœurs, de récriminations et d’anathèmes capables de tout, sauf de ressusciter l’unité d’action et de pensée du FLN du 10 octobre 1954.
Mohamed Seddik Benyahia qui en présida les travaux échoua à faire admettre la composition d’un bureau politique du FLN associant les 5 d’Aulnoy et les 3B et dut les suspendre. Il eut, à peine, le temps de faire voter, à l’unanimité, le projet de Hammamet, baptisé «Programme de Tripoli» qui posa les deux principes qui régiront la vie politique et économique de l’Algérie indépendante, 30 ans durant : l’unicité du parti comme mode de gouvernement et le socialisme comme voie de développement.
Après cela, le FLN entrera, non pas à Alger — ainsi que le fit le GPRA à travers la personne de son Président, Benyoucef Benkhedda – mais en rangs dispersés, à Tlemcen et à Tizi Ouzou, explosé en plusieurs tendances qui déclencheront, bientôt, des affrontements fratricides.
De cette cascade d’évènements survenus, sur une longue période, et dans un paysage politico-militaire des plus opaques, il est, quand même, possible de dégager quelques ébauches de lectures susceptibles d’aider à rendre compte de la cristallisation des processus autour desquels le dénouement de l’insurrection révolutionnaire s’était structuré, politiquement, idéologiquement et institutionnellement :
-politiquement : la hantise des premiers militants révolutionnaires civils relayés, à partir de 1959-62, par les «militants en uniforme», fut de voir, un jour, l’âme du nationalisme indépendantiste et ses caractères populaire et unanimiste dilués dans la dissidence ou la discordance, d’où la constance de leur position de vigiles intraitables. Incarnation de ce nationalisme irrédentiste, enfin, victorieux, l’OS marqua de sa culture et de son empreinte dirigiste plusieurs générations de combattants qui se sont reconnus beaucoup plus dans l’ALN continuatrice légitime de l’OS que dans le FLN fédérateur des forces d’avant 1954, continuellement suspectées de tentatives de confiscation du combat des pionniers ;
– idéologiquement : la paysannerie s’est imposée force dirigeante de la Révolution pour les raisons expliquées plus haut. Dans cette position, et au fur et à mesure de l’avancée de la lutte armée, elle imprima à celle-ci un ensemble de valeurs dont elle a, de tous temps, été porteuse et dont la religiosité référencée au sunnisme malékite était l’un des vecteurs les plus visibles.
La lutte commença, alors, à revêtir le caractère d’un djihad, les djounoud furent désignés par le vocable de moudjahidine, le rituel de la prière collective, avant chaque opération militaire, devint un acte de foi patriotique, l’organe central du FLN, successeur de la Résistance, prit le nom d’El Moudjahid, quelques années après que l’Union générale des étudiants algériens ait opté pour une appellation comportant dans son sigle le qualificatif de musulmans ; des faits qui ont introduit, dans le glossaire de la Révolution, une terminologie nouvelle par rapport à son premier corpus, plutôt universaliste, même si la Proclamation du 1er Novembre avait projeté de construire l’Etat algérien indépendant dans «le cadre des principes islamiques», pour bien marquer la différence qui devrait exister entre le Code de l’indigénat qui réserva aux Algériens le statut de sous- citoyens dits «français-musulmans» et le futur Etat national fondé sur une identité ethnico-religieuse récupérée et rétablie dans ses droits naturels.
Il n’est pas inintéressant de relever, dans cet ordre d’idées, que les principaux officiers de wilaya de l’ALN, originaires du Nord constantinois, furent les élèves de la Ketanya et de la Tarbiya oua Etaâlim, entre autres, Ali Kafi, Mohamed Salah Yahiaoui et Mohamed Boukharouba qui adopta le nom de guerre de Houari Boumediène, en signe de filiation spirituelle à deux saints vénérés de l’ouest du pays ;
– institutionnellement : «les militants en uniforme» entrés, à Alger, en été 1962, en vainqueurs, après des combats meurtriers dans la Wilaya IV, avaient auparavant conclu à Tlemcen un accord avec les militants civils, au terme duquel le commandement de l’institution militaire leur reviendrait, exclusivement, tandis que serait dévolu à une Assemblée constituante la mission de rédiger une Constitution – laissée, pour le moment, à la discrétion de ses futurs membres — et au bureau politique du FLN le pouvoir de gérer les affaires du parti consacré, pour le moment aussi, façade civile du nouveau régime.
Fort, quelques mois plus tard, de son élection à la tête de l’Etat et du FLN, transformé, en 1964, en parti d’avant-garde par la Charte d’Alger, Ahmed Ben Bella, entouré de ses fidèles Ben Alla, Mahsas, Boumaza, Nekkache, Hadj Smaïn, crut les conditions suffisantes réunies pour renverser la vapeur et remettre en selle les militants civils.
Conseillé par les marxistes de l’aile gauche du FLN, il initia, au pas de charge, des réformes «socialistes» dont il pensait, par conviction, qu’elles allaient aboutir dans un contexte international dominé par l’émancipation générale des peuples du colonialisme et du capitalisme occidental.
Le colonel Houari Boumediène, tout puissant ministre de la Défense nationale qui avait la haute main sur l’état-major de l’ ANP qui prit la suite de l’ ALN, les régions militaires, la police, le corps national de sécurité, la gendarmerie et les services de renseignement, ne l’entendait pas, ainsi, estimant que l’orientation imprimée au parti dans lequel il voyait grandir l’influence des communistes contrevenait aux constantes arabo-islamiques et «à la pureté» de la Révolution de Novembre, tout pour conclure à une nouvelle «déviation» à stopper net.
L’accord conclu, à Tlemcen, fut rompu, le 19 juin 1965, dans le fracas d’un énième «réajustement» qui tourna une page de l’Histoire politique de l’Algérie indépendante et en ouvrit une autre d’une toute autre nature.
B. E. M.
Prochainement : «Les partis dirigeants algériens» (4e partie). Du gouvernement de l’Etat par le parti au gouvernement du parti par l’Etat.
LES PARTIS DIRIGEANTS ALGÉRIENS FLN : 1962-1978
Du gouvernement de l’État par le parti au gouvernement du parti par l’État (4e partie)
par Badr’Eddine Mili
le 26.12.2018
L’édification de l’Etat algérien indépendant sur un territoire aux frontières géographiques, sans précédent, et, dans le cadre d’une République continuatrice de l’Etat révolutionnaire post-Soummam et refondatrice de l’Etat de la Résistance de 1830, occupa, de 1962 à 1978, deux tranches de temps dominées par deux conceptions de gouvernement que tout opposait.
La première – 1962-1965 – fut baptisée gouvernement de l’Etat par le parti, et la seconde – 1965-1978 – peut être qualifiée de gouvernement du parti par l’Etat.
1- Le gouvernement de l’État par le parti
Ce type de gouvernement que la Charte d’Alger actualisa, en 1964, en l’infléchissant, d’une façon très prononcée, dans le sens voulu par l’aile gauche du parti n’avait rien à voir avec un choix circonstanciel.
Il découlait de l’option du parti unique entériné par le Congrès de Tripoli qui avait reconduit, sur ce point précis, l’orientation orthodoxe de la Révolution conservée, grosso modo, intacte, malgré les conflits de personnes qui l’avaient, longtemps, malmenée.
Ce ne fut donc, pas par hasard, que le néo-FLN, né de l’alliance entre les militants civils de la vieille souche recomposée et «les militants en uniforme», a été investi, à ce congrès – sur la base d’un quorum contesté – de la mission de jeter les premiers jalons de cet Etat et que sa direction, instruite des postulats relatifs à sa filiation historique, s’interdisit, en cet été 1962, de procéder à toute passation de pouvoirs avec l’ex-puissance coloniale, ni directement, avec son représentant officiel – Paul Delouvrier — ni indirectement, avec l’Exécutif provisoire présidé par Me Abderahmane Farès, l’ALN ayant, fermement, repoussé la proposition de traiter, avec le commandement de la Force Locale, le déploiement de ses forces sur le territoire national.
Les premières décantations
En prenant de facto le contrôle du pays, aux lieu et place du GPRA, ce FLN-là, détenteur d’un pouvoir délégué par les militaires, n’avait pas entièrement achevé la mue qu’on lui connaîtra quelques mois plus tard, occupé à apurer, rapidement, les comptes de l’après-Tripoli et à gérer, avec prudence, les alliances utiles à la demande de l’étape, au gré d’un opportunisme politiquement intéressé.
Il commença par se défaire de Mohamed Boudiaf et de Hocine Aït-Ahmed qui contestaient la légitimité de sa Direction, puis des «3B» traînant le grief d’avoir négocié les Accords d’Evian, à minima, et enfin des dirigeants de l’ex-Fédération de France et des chefs des Wilayas II et IV réputés anti-EMG et pro-GPRA. Une fois le noyau de la Direction «assaini», il passa au deuxième cercle, les ulémistes de Cheikh Bachir El-Ibrahimi et Cheikh Kheireddine, ancien membre influent du CNRA, réduits au silence, précédés par les communistes interdits d’activités partisanes. Les seuls alliés provisoirement épargnés par ce délestage furent les udmistes et leur chef, Ferhat Abbas, qui fit, on s’en souvient, partie du groupe de Tlemcen, sans que l’on sache exactement les motifs réels qui l’y poussèrent, mis à part les démêlés qu’il eut avec les «3B», du temps où il présidait le Gouvernement provisoire.
Cette épuration avait un sens politique, sans doute débattu en interne, qui donnait à penser qu’il exprimait le souhait des pionniers indépendantistes de renouer avec les racines et l’esprit du PPA-MTLD et de l’OS considérés comme le vivier de l’encadrement de leur formation, le plus fidèle et le plus sûr, dont ils auraient besoin, le moment venu, pour concrétiser leur projet de gouverner l’Etat par un parti réincarné, débarrassé des «compagnons de route» et des «militants en uniforme» devenus encombrants.
Ces décantations ramèneront, au-devant de la scène du parti, une constellation de dirigeants, Ben Bella, Khider, Ben Alla, Mahsas… anciens membres de l’OS ou de la Délégation extérieure, de quoi légitimer une organisation qui fonctionnera, sous cette identité, jusqu’à ce qu’elle mute en décidant de devenir un parti d’avant-garde, le prélude à l’éloignement – pour d’autres raisons – de Mohamed Khider, secrétaire général, favorable à une organisation du type parti de masse. Sous ce nouvel habillage de parti populaire de gauche qui ne sera validé, définitivement, qu’après avoir reçu l’onction de la Charte d’Alger adoptée par un congrès dit de la clarification portant la griffe des socialistes marxisants, le FLN se prit à penser, sérieusement, à reprendre le leadership perdu au profit de l’armée et à se réapproprier la totalité du pouvoir en s’en émancipant.
Ahmed Ben Bella – «Le Frère militant» —, leader charismatique, ami de Khrouchtchev, Nasser, Nehru, Chou En-laï, Tito, Castro, Nkrumah, Sékou Touré…, crut, avec l’appui d’une coalition rassemblant les travailleurs, les paysans, les étudiants, les jeunes, les femmes et leurs syndicats, pouvoir renverser la tendance du rapport de force Parti-ANP et remettre en course ce qui restait de l’ancienne aile révolutionnaire du MTLD – parée des couleurs socialistes – dans le processus en cours ; une projection qui aurait pu tenir la route, dans le contexte international ambiant, si le resurgissement des vieux démons de la messalisation de l’exercice du pouvoir ne l’amena à commettre les mêmes erreurs fatales que le leader nationaliste dont il eut à subir le même sort, après s’être enfermé dans la tour d’ivoire d’un culte de la personnalité qui le perdit.
Avant d’en arriver à cette inattendue bifurcation de son Histoire, le FLN s’était fixé trois tâches classées prioritaires : l’élection d’une Assemblée constituante, la formation d’un gouvernement – chose faite le 29 septembre 1962 – et la préparation d’un congrès prévu pour le reconstruire, sous la couverture du même sigle, dans une configuration élaguée, libérée de la subordination à l’ANP.
La réalisation de ces tâches était considérée comme le préalable à toute action visant à mettre en place les fondations de l’Etat et à sauver un pays où tout revêtait le caractère de l’extrême urgence et de l’absolue nécessité, tant les ravages causés par la guerre avaient généré une situation de besoins à satisfaire, toutes affaires cessantes.
Les défis de l’après-guerre
Pour bien appréhender la situation tragique dans laquelle l’Algérie se débattait, en cette première année de l’indépendance, il faut replonger dans son contexte.
Jean-Marcel Jeanneney, premier ambassadeur de France à Alger, adressa à son gouvernement, à l’automne 1962, une note d’information dans laquelle il décrivait «un pays sombrant dans le désordre, le chômage et la sous-administration», condamné «à retomber dans son anarchie ancestrale».
En dehors de ce dernier jugement de valeur puisé dans le vieil arsenal du racisme colonial, le constat n’était pas éloigné de la réalité ; une réalité qui était, à des degrés de gravité divers, partagée par l’ensemble des ex-colonies françaises que René Dumont résuma dans la formule «L’Afrique est mal partie», le titre donné à son premier ouvrage sur la décolonisation ; sauf que l’honnêteté aurait dû inciter le diplomate à reconnaître que cela n’était pas dû à un gouvernement, en place, seulement, depuis 3 mois, mais à la politique de dépossession, d’exploitation et d’asservissement que la France coloniale pratiqua, pendant plus d’un siècle, au détriment des intérêts de l’Algérie qu’elle transforma, au bout d’un conflit meurtrier, en un champ de ruines.
On sait, à commencer par les Français eux-mêmes, que cette politique fut sanctionnée par un bilan des plus funestes : un million et demi de morts, des millions de veuves et d’orphelins, un million de déplacés et de réfugiés, des dizaines de milliers de détenus dans les camps de concentration, une agriculture pillée, une industrie extravertie, une administration désertée par les fonctionnaires et les techniciens pieds-noirs et une population traumatisée qui continuera à payer un lourd tribut au prolongement de la guerre et à ses effets à retardement : les expériences nucléaires au Sahara et les mines semées par l’armée d’occupation le long des frontières orientales et occidentales du pays.
Par quoi le jeune gouvernement, investi en septembre de cette année-là, allait-il commencer ? Avec quels moyens allait-il faire face à ce désastre, lui qui n’avait, même pas un droit de regard sur l’exploitation par les sociétés françaises des gisements de pétrole découverts, en 1956, à Edjeleh ? Sous l’éclairage de quels principes directeurs et selon quel programme ?
La tâche paraissait gigantesque et la mission quasi impossible, même si les pays amis – URSS, République populaire de Chine, Inde, Cuba, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Égypte, Irak, Syrie, Etats-Unis… —, les organisations internationales – ONU, Unicef, Unesco, OIT, OMS… —, les mouvements progressistes et les associations caritatives – Fédération syndicale mondiale, Croix-Rouge Internationale… —, et les réseaux de soutien de la Révolution – internes avec Duval, Béranger, Mandouze … et externes avec Jeanson, Curiel, Tillon, Gluksmann, Vidal Naquet, Montaron… — s’étaient portés au secours du peuple algérien en mettant à sa disposition les moyens de survie, ainsi que des techniciens, des enseignants et des médecins venus, en nombre, encadrer, au pied levé, les secteurs de l’économie, de l’éducation, de la santé et de l’information, démunis de tout.
A côté des défis conjoncturels – campagne labour et rentrée des classes placée sous le signe d’une scolarisation massive chargée d’une très forte symbolique –, le gouvernement était attendu sur des terrains plus compliqués.
En sus des institutions à inventer à partir de l’embryon de l’Etat révolutionnaire préexistant, il était sollicité pour garantir la sécurité des biens et des citoyens et administrer un territoire – continent où seules quelques rares villes étaient équipées du minimum nécessaire au maintien en état de fonctionner des grands services publics – transport ferroviaire, poste et télécommunications, électricité et gaz, hôpitaux, ports et aéroports – à l’exclusion de bien d’autres dont la Radiotélévision qui dut attendre le 28 octobre 1962 pour être placée sous la souveraineté de l’Etat algérien.
Les tâches d’édification nationale : principes directeurs et socle social
Certes, le gouvernement du FLN, mis sous pression, était obligé, dans bien des situations – réinsertion des réfugiés, reconstruction des villages détruits… —, de faire montre de pragmatisme, de créativité, et même d’improvisation, pour résoudre les problèmes qui ne souffraient pas d’attendre. Mais cela ne signifiait pas qu’il naviguait à vue. Il disposait d’une boussole qui le guidait dans la réalisation de ce qui fut dénommé «tâches d’édification nationale» — réforme agraire, électrification, irrigation, reboisement – répertoriées par le Programme de Tripoli qui leur fixa un cap obéissant à des principes directeurs et reposant sur un socle social aux contours bien définis.
Les principes directeurs
Parmi les principes directeurs arrêtés, il y en avait deux qui se distinguaient par leur caractère intangible :
• le premier fermait la porte à la reconduction de tout ce qui rappellerait l’ordre ancien fondé sur l’exploitation de l’homme par l’homme. Le capitalisme étranger et le féodalisme furent, de ce fait, déclarés hors-la-loi et leurs domaines nationalisés, rétablissant le droit des paysans sur les terres dont ils furent dépossédés.
Le capitalisme algérien écopa de la même sanction. Déclaré «exploiteur et antinational», il fut étatisé et ses biens versés au fonds de l’autogestion institué en 1963 par les Décrets de mars ;
• le second déjà en œuvre, à travers l’unicité du parti, se manifesta de façon plus accentuée, lorsque le Bureau politique du FLN rejeta le projet de Constitution parlementariste défendu par Ferhat Abbas, une décision qui confirma la résolution du nouveau pouvoir d’exclure du champ référentiel de l’organisation de l’Etat toute idée de recycler sous une forme ou une autre le système institutionnel de l’ancienne puissance coloniale.
Le texte qui lui fut substitué pencha en faveur d’un régime de démocratie populaire censé être plus adapté aux réalités nationales et aux alliances internationales – socialistes et tiers-mondistes – de l’Algérie, avec cette particularité que l’Assemblée nationale, nouvellement élue, était animée par des députés – Aït Ahmed, Kaïd Ahmed, Mériem Belmihoub, Ouamrane … — très critiques vis-à-vis du gouvernement, ce qui agaçait le président Ben Bella peu disposé à s’en accommoder.
Le socle social
Armé de ces orientations dont il tirait ses principaux mots d’ordre, le FLN mobilisa autour de lui toutes les organisations de masse, représentatives des «forces vives de la Nation», avec en pole position les puissants syndicats ouvriers et estudiantins, le socle social sur lequel il s’appuya pour défendre et concrétiser un programme qui sera bientôt revu et corrigé par la Charte d’Alger et «les Thèses d’avril», dans l’esprit et la lettre d’un socialisme autogestionnaire, l’expérience menée en Yougoslavie sous l’égide de la Ligue des communistes où l’idéologue Edvard Kardelj s’occupait à conceptualiser le titisme.
Dans cette construction politico-idéologique qui rompait avec la tradition frontiste, il n’y avait plus de place, dans un parti régi par le centralisme démocratique, pour les défenseurs du pluralisme politique et du libéralisme économique consacrés plus tôt par la Conférence de Monrovia, tenue, après leur indépendance, par les Etats africains pro-occidentaux.
A ce niveau d’un processus compris par les militants écartés comme un reniement du passé, bien que beaucoup préparaient, en sous-main, le retour sur la scène nationale de leurs formations d’avant 1954, peut-on affirmer que le FLN s’était transformé en un parti monocolore dédié, exclusivement, aux militants socialistes ?
On serait, de prime abord, tenté de répondre oui, si on considère les purges opérées et aussi si on regarde comment la direction issue du 3e Congrès avait récupéré les thèses, les mots d’ordre, la presse – Alger républicain – et nombre de militants de l’ex-PCA entrés dans son Comité central.
Les grands perdants dans l’affaire furent les udmistes et les ulémistes dont le chef Cheikh Bachir El-Ibrahimi mourut sans avoir eu droit à des funérailles officielles et sans que son fils, détenu, soit autorisé à assister à son enterrement.
Ces mutations qui étaient impensables, quelque temps plus tôt, heurtèrent, sensiblement, «les militants en uniforme » qui avaient suivi, de loin, le déroulement du 3e Congrès. Le colonel Houari Boumediene, très réservé sur ces changements, avait pris du recul par rapport à ce qu’il estimait être des libertés que le président Ben Bella s’était permis de prendre avec le Programme de Tripoli.
Il laissa, d’abord, faire, car il savait que le rapport de forces jouait en sa faveur.
Ahmed Ben Bella n’avait, en effet, autour de lui que quelques personnalités : à la Présidence – Tayeb Belaïz, Abdelmadjid Meziane… —, au gouvernement – Nekkache, Mahsas, Boumaza, Hadj Smaïn, Khemisti, Ouzzegane, Guennez, Ahmed Francis, Tewfik El-Madani, Bentoumi, Hadj Hamou, Sadek Batel, Khobzi, Kadi, plus les jeunes technocrates Ghozali, diplômé de l’Ecole des ponts et chaussées de Paris, et Houhou, premier gestionnaire du dossier de la coopération algéro-française au ministère des Affaires étrangères… — le préfet Fettal, le maire Belamane, à la sécurité M’hamed Yousfi, Bouabdellah et Hamadache – et enfin, au parti, outre les ténors déjà cités, les «idéologues» Harbi, Lebdjaoui, Zahouane… — le reste des ministres détenteurs des portefeuilles les plus importants – Medeghri, Bouteflika, Cherif Belkacem, Kaïd Ahmed, membres du groupe d’Oujda, plus Ali Mendjeli, vice-président de l’Assemblée nationale… — échappaient à son autorité, placés, là, pour servir le ministre de la Défense qui avait installé ses hommes de confiance – Z’biri, Draïa, Bencherif, Kasdi Merbah, Chabou, Chadli, Yahiaoui, Belhouchet, Tayebi Larbi, Messaoud Zeggar, Djelloul Khatib, Ferhat Zerhouni… à la tête des secteurs sécuritaires stratégiques et des réseaux de l’ombre, prêts à parer à toute éventualité.
Le parti d’avant-garde : un dessein contrarié
Face à cette polarisation de forces qui s’avéra déséquilibrée, le benbellisme, alchimie des contraires – islam traditionnel en voie de démaraboutisation et socialisme pur et dur – allait-il prendre sur un tissu social conservateur attaché à la petite propriété privée ? Possédait-il les moyens d’emporter l’adhésion, au moins, des franges de cette société qu’il a su toucher par ses promesses de justice sociale et de solidarité ? En ces années de troubles internes —sédition de la Kabylie et affaire Chaâbani — et de guerre aux frontières – agression marocaine au Sahara —, le pari était extrêmement risqué. Il l’était d’autant plus que les militaires avaient boudé le congrès du parti et son Comité central et préféré œuvrer à la sécurité, à l’unité et à l’administration du pays sur lesquelles ils misaient en priorité.
D’un autre côté, ils n’avaient pas vu d’un bon œil la reconduction de la législation française, référence du droit rendu par la justice algérienne ainsi que la place privilégiée concédée à l’enseignement du français, langue de travail du gouvernement.
L’activisme international du Président – prix Lénine – qui passait trop de temps à l’étranger ainsi que sa propension à monopoliser plusieurs portefeuilles ministériels, à la fois, n’avaient pas, non plus, eu l’heur de plaire.
Aussi, l’intention qui lui fut prêtée de démettre Abdelaziz Bouteflika de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères qu’il voulait placer sous sa coupe, à la veille du sommet afro-asiatique et du Xe Festival mondial de la Jeunesse, avait été exploitée par ses adversaires pour mettre fin à ses «errements».
Le passif que le président Ahmed Ben Bella accumula, de ce point de vue et de bien d’autres, dépassait, en réalité, ce qui pouvait paraître comme un fait du prince venu allonger une liste de gestes d’humeur, les uns plus déroutants que les autres.
Bien avant cet incident détonateur, l’échec de l’expérience benbelliste était déjà écrit. Il fut précipité par l’addition de plusieurs obstacles mis sur son trajet par des phénomènes sociopolitiques objectifs sur lesquels le Président n’avait pas de prise.
La base composite du parti, la faible réactivité aux réformes d’une administration récalcitrante, l’indocilité des syndicats ouvriers et estudiantins et les pesanteurs culturelles et spirituelles de la société étaient telles qu’il était impossible que le régime en place évite la faillite.
a- Le parti sur lequel Ben Bella, secrétaire général, avait compté n’existait qu’à Alger, à travers les meetings du 1er Mai et les états généraux de l’autogestion ouvrière et paysanne.
Son enracinement en province rendu problématique par son élitisme avant-gardiste n’a pas eu lieu.
Envahi par les carriéristes recrutés durant la période clair-obscur du 19 Mars, il ne faisait pas le poids face à l’armée et, aussi, à une administration décidée à ne pas se laisser doubler.
b- Cette administration infiltrée par les promotions d’autochtones lancées, dans le cadre du Plan de Constantine de 1958, et dites «promotions Lacoste», du nom du gouverneur ultra de l’Algérie d’alors, était tenue par les fils des grandes tentes et de la bourgeoisie «antisocialiste».
La réforme agraire, entre autres mesures sociales, fut étouffée par leur juridisme tatillon et le blocage des crédits bancaires dont elle avait besoin.
c- Les organisations de masse qui constituaient le prolongement du FLN dans la société civile n’étaient pas toutes réglées sur son pas. L’UGTA et l’Unea, attachées à leur autonomie, n’étaient pas faciles et n’obtempéraient pas toujours à ses injonctions. Les vives tensions qui brouillèrent ses relations avec leurs deux dirigeants – Rabah Djermane et Houari Mouffok – le contraignirent à les contourner en créant, à leur périphérie, des structures parallèles mises sous tutelle comme ce fut le cas avec «la section des étudiants du parti» implantée à l’Université d’Alger et où se distinguèrent Abdessadok et, déjà, Abdelkader Hadjar de retour de Baghdad où il étudiait.
d- Enfin la société recevait, avec circonspection, les mots d’ordre de collectivisation propagés par les militants du parti et n’était pas loin de les assimiler au communisme soviétique.
Les intellectuels progressistes — écrivains, hommes de théâtre, peintres, cinéastes, journalistes… — avaient beau créer et écrire, dans un remarquable mouvement de renouveau de la pensée et de l’art, des œuvres faites pour déclencher le déclic libérateur de la société, cela ne servit à rien. Là aussi, l’élitisme, la barrière des langues et des cultures avaient freiné l’élan — pourtant bien amorcé — de la modernisation de l’Algérie.
Quoiqu’il en soit, avec son solide ancrage dans le pays profond, sa culture arabo-musulmane et sa méfiance instinctive à l’égard des civils, l’armée savait qu’elle n’allait pas faire longtemps bon ménage avec ce FLN-là.
L’occasion n’allait pas tarder à se présenter. Face à un Président qui s’était forgé une image internationale immunisatrice – grâce aux journalistes Simon Malley, Aquino de Bragança, Serge Michel, Hervé Bourges… — et qui était à deux doigts de gagner une position d’où il aurait été impossible de le déloger, à la veille de deux rendez-vous mondiaux, il était plus qu’urgent de passer à l’action.
Ce moment arriva le 19 juin 1965, le jour où le gouvernement de l’Etat par le parti céda, par la force, le pas au gouvernement du parti par l’Etat, et où «les militants en uniforme» barrèrent la route à une tentative audacieuse de retour au pouvoir des militants civils après s’en être fait éjecter, à deux reprises, au Caire, en 1959, et à Tripoli, en 1962.
2- Le gouvernement du parti par l’Etat
Cette forme de gouvernement fut instituée par la Proclamation du 19 juin 1965, le texte fondateur d’un pouvoir pensé, selon les auteurs, non pas dans une démarche de rupture mais bien dans celle de la continuation d’un processus révolutionnaire à «ressourcer» car «perverti» par la gestion du président Ben Bella auquel il a été promis un «Livre Blanc» sur «les crimes commis» contre la ligne de Novembre.
Brève et concise, la Proclamation va, en effet, affirmer, solennellement, que le changement effectué, sans effusion de sang, est un «redressement» — plutôt qu’un putsch – voué à rétablir l’ordre des priorités dans la reconstruction du pays, désormais, conditionnée par la primauté de l’Etat sur le parti.
L’organisation du nouveau régime sera précisée par l’ordonnance du 10 juillet 1965 qui viendra suppléer, en source de droit transitoire, à la vacance de la Loi fondamentale et des institutions remplacées par un «Conseil de la Révolution» qui concentrera, entre ses mains, pour une durée indéterminée, les prérogatives exercées par les organes exécutif et législatif déchus.
Les conséquences de ce «réajustement» brutal vont effacer, d’un coup, tout ce qui avait été, laborieusement, entrepris, en trois ans, pour monter les premières structures d’un Etat, plus ou moins, cautionné, aux élections législatives du 20 septembre 1962, par une population qui aspirait à une gouvernance apaisée et juste.
Concrètement, ces conséquences affecteront, à la fois, ce qui restait de la direction historique de la Révolution et la place occupée par le FLN dans l’Etat et dans la société.
La fin politique de la direction historique du FLN
• Avant sa disparition de la nomenclature du pouvoir, Ahmed Ben Bella aura été le dernier membre de la direction historique du FLN à être resté aux commandes, après avoir écarté ses anciens compagnons arrêtés ou mis en retrait de la vie politique comme Rabah Bitat qui ne sera réactivé qu’à la suite de son repêchage, en 1976, par le président Houari Boumediène qui le fera élire à la présidence de la première Assemblée populaire nationale.
Avec la mise au secret, pendant 13 ans, de celui qui fut surnommé, avant son élargissement par le président Chadli Bendjedid, «le marabout de M’sila», il ne subsista à la tête du parti et de l’Etat plus aucun des dirigeants qui déclenchèrent l’insurrection du 1er Novembre 1954.
Leurs successeurs au Conseil de la Révolution de 1965 – Houari Boumediène, Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Medeghri, Cherif Belkacem, Kaïd Ahmed, Ali Mendjeli, Chadli Bendjedid, Ahmed Draïa, Abdellah Belhouchet, Mohamed Salah Yahiaoui, Ahmed Ben Ahmed Abdelghani, Salah Soufi, Ahmed Boudjenane Abbas, Tahar Zbiri, Ahmed Bencherif, Kasdi Merbah, Tayebi Larbi… — n’étaient quand même pas en mesure de prétendre à une légitimité historique égale à celle de leurs aînés, mais ils n’en sonnèrent pas moins le glas pour la génération des pionniers de la Révolution.
• Le FLN paiera, lui aussi, pour son dévoiement idéologique et organique, le même prix. Toutes ses instances, Bureau politique, Comité central, issus du 3e Congrès, seront dissoutes et leurs membres incarcérés ou mis en fuite. Aucun d’eux — mis à part Bachir Boumaza, un des rares civils cooptés au Conseil de la Révolution, parce qu’opposant, en 1962, à Ben Bella — n’a échappé à la disgrâce : Ben Alla, Nekkache, Hadj Smaïn, Harbi, Zehouane, Boudia, Mouffok arrêtés, entrés en clandestinité seront interdits d’activité politique.
Seront également poursuivis et chassés du pays tous les conseillers «pieds-rouges» du Président et du gouvernement.
Du parti proscrit au parti restauré
• Dans une volonté non dissimulée de le rétrograder au plus bas de l’échelle du pouvoir, les nouvelles autorités confectionneront au FLN, décapité et dépossédé de ses attributs, un statut d’Exécutif puis d’Appareil confiés à Chérif Belkacem et Adda Benguettat, le secrétaire à l’organique chargés – en présence de Salah Boubnider et de Youcef Khatib qui l’ignoraient – de le niveler par le bas puis à Kaïd Ahmed et Brahim Kabouya – lui aussi responsable de l’organique – auxquels reviendra la reprise en main de l’ex-Fédération de France rebaptisée «Amicale des Algériens en Europe», avec Aït Ouazzou, ainsi que la normalisation des organisations de masse hors contrôle – l’UGTA et l’Unea clandestine – qui seront mises au pas, soit par la nomination à leur tête de nouveaux dirigeants – Abdelkader Benikous à la Centrale syndicale, en remplacement de Mouloud Oumeziane, en 1969 — soit par leur dissolution.
Le FLN qui ne sera plus désigné que par le vocable de «parti» subira dix années de purgatoire qui ne prendront fin qu’avec sa restauration sous la responsabilité de Mohamed Salah Yahiaoui, son coordonnateur, un titre inexistant dans ses statuts.
Le régime qui évolua, alors, à gauche, sous l’effet des révolutions socioéconomiques des années 70 – révolution agraire, gestion socialiste des entreprises –, ainsi que des relations Est-Ouest qui le hissèrent aux côtés des leaders du mouvement des pays non alignés changea, complètement, de cap, une situation qui ne lui permettra plus de faire l’économie d’un levier politique de mobilisation et d’encadrement de la société aussi nécessaire que le FLN, à la seule différence que celui-ci avait cessé d’être une source de pouvoir, un privilège dont ne jouissait que la seule institution militaire.
Le «pouvoir révolutionnaire» avait, en effet, réussi à agglomérer, au sein de l’Etat et donc, parallèlement au parti, un ensemble de compétences, de moyens de conceptualisation idéologique et de relais de communication qui remplacèrent le FLN dans l’action de formulation, de défense et d’illustration des politiques qu’il engagea au nom d’un Etat appelé «à survivre aux évènements et aux hommes».
• Les élites
La concentration des élites dans les structures névralgiques de l’Administration fut la première manifestation concrète du déplacement du centre de réflexion et d’action du parti vers l’Etat. Très sensible à la question, le président Houari Boumediène installa, à sa proximité immédiate, une task-force composée de technocrates, pour jeter les bases d’une économie intégrée, autocentrée à la croissance auto-entretenue, réglée par une planification élevée au niveau d’institution.
Encadrée par des militants chevronnées – Belaïd Abdesselam, Mohamed Liassine, Lamine Khane, Abdelmalek Temmam… — et drivée par Abdellah Khodja et Smaïl Mahroug qui n’hèsitaient pas à recourir aux conseils des économistes marxistes comme Bobrowski, Popov et d’Estanes de Bernis, cette nouvelle élite d’économistes, de financiers, de statisticiens, de planificateurs, de professeurs d’université – Layachi Yaker, Abdelatif Benachenhou, Amokrane Cherifi, Hamid Aït Amara, Isli, Oubouzar, Ourabah, Anane, Remili, Hamdi et les jeunes universitaires Henni Benali, Abdelmadjid Bouzidi, Brachemi, Benarbia, Mokaddem, Boumati, Bedrani, Chergou, Ameziane, Boudechiche, Touati, Khelladi, Terzi, Mokrane, Hamza… — travaillera à penser et à élaborer tous les plans que le Conseil de la Révolution lui commanda avec, en ligne de mire, la réalisation de l’indépendance économique du pays par l’industrialisation, la modernisation de l’agriculture et le développement des régions.
• Les schémas et instruments de conceptualisation et de coordination
La mise en œuvre de cette stratégie globale – une première dans l’histoire économique de l’Algérie – donna lieu au lancement de schémas et d’instruments de conceptualisation et de coordination inédits auxquels le parti ne fut pas associé dans la même position de réservoir d’idées et de compétences qui fut la sienne sous l’ancien régime.
Les conférences des cadres de la nation présidées par le chef de l’Etat, en personne, se tenaient, régulièrement, et réunissaient ministres, walis, ambassadeurs, directeurs centraux, experts pour harmoniser et évaluer les conduites de gestion et d’exécution des plans, un canal de concertation central reproduit au niveau des wilayas sous la forme d’une structure permanente de coordination constituée par le chef de la région militaire, le wali et le mouhafedh du parti.
La navette centre-périphérie était, utilisée, de la même manière, par l’organe de planification pour le recueil des besoins des populations au niveau des assemblées communales et wilayales – élues pour la première fois en 1967 – puis leur consolidation au sommet et leur répercussion aux échelons inférieurs pour exécution, une procédure attestant, selon ses concepteurs, de la pratique d’une démocratie participative, en l’absence, là encore, du parti.
• Les relais de communication
La communication par la propagation et l’explication des politiques publiques n’était plus du ressort du parti, mais de l’Etat, à travers ses moyens institutionnels – RTA, APS, El-Moudjahid et Ech-Chaâb – dirigés, alors, par Mohamed Rezzoug, Mohamed El-Mili, Nourredine Naït Mazi et Salah Louanchi, sous la supervision de Mohamed Seddik Benyahia, ministre de l’Information, et de Mahieddine Amimour, conseiller du Président. La RTA joua, grâce à ses moyens de transmission et de diffusion, le rôle que jouait, habituellement, le parti, ce qui poussa le président Boumediène à lui accorder – dans le cadre du plan — des enveloppes substantielles destinées à l’équiper et à en faire le porte-parole de sa politique auprès de l’opinion ainsi que la voix de l’Algérie à l’extérieur. Ce fut, à cette époque, que sera lancée la couverture du Sahara par le satellite et que sera crée à Sarajevo, en 1977, le Comité des radios-télévisions des pays non alignés, à l’initiative de la Yougoslavie et de l’Algérie.
Le même cheminement sera emprunté lorsque la Charte nationale sera proposée au débat, en 1976, précédant le retour à la légalité constitutionnelle avec l’adoption d’une nouvelle Constitution, l’élection d’une Assemblée populaire nationale et d’un président de la République.
Substitué, en l’absence, encore une fois, du parti, à la Charte d’Alger jugée trop «internationaliste», le texte servira de gouvernail doctrinal au nouveau front populaire rendu possible grâce à la Révolution agraire, à la réforme de l’université, au volontariat et à l’action de l’Algérie sur la scène internationale en faveur de la décolonisation, de la fin de l’apartheid et du sionisme ainsi que de l’instauration d’un nouvel ordre économique international et d’un nouvel ordre de l’information.
Le FLN bénéficiant du «soutien critique» du Pags reprit l’initiative et Mohamed Salah Yahiaoui — un autre «militant en uniforme», assisté de Mohamed Chérif Messaâdia, devint sa figure de proue, défenseur du socialisme. Le parti aspirait à ce moment-là à redevenir le rempart d’un régime décidé à barrer la route «aux velléités de la bourgeoisie réactionnaire» après que Ferhat Abbas, Cheikh Kheireddine, Hocine Lahouel et Benyoucef Benkhedda aient rendu public un appel demandant la libéralisation du pouvoir politique et de l’économie.
Le président Houari Boumediène parti, en 1965, sur une hostilité ouverte au FLN, déboucha sur la réhabilitation d’une formation dont il avait besoin pour affronter ses adversaires de droite.
Ses fidèles lui prêtèrent même l’intention de déclencher «une révolution démocratique» à l’occasion du 4e Congrès du parti qui était prévu à la fin de 1978.
Il n’aura pas le temps de le faire. La maladie — mystérieuse selon certains —l’emportera. On pourra épiloguer, à perte de vue, sur le bilan de l’homme et, aussi, sur ses méthodes qui ont beaucoup coûté de déperditions à la société, en termes de libertés et de droits humains, mais lorsqu’on tire une balance entre son actif et son passif, c’est l’actif qui l’emporte.
Les Algériens ont, à cet égard, retenu surtout :
– son envergure de bâtisseur ;
– son sens élevé de l’Etat emprunté à l’Emir Abdelkader auquel il s’identifiait ;
– sa capacité d’adaptation aux changements de la société et du monde qui le firent évoluer d’une position réservée à l’égard du socialisme et de son socle social à une autre indexée sur les standards internationaux des pays de l’Est corrigés, il est vrai, par la sacro-sainte règle de l’équilibre entre progressisme et conservatisme symbolisés par Mostefa Lacheraf et Ahmed Taleb El-Ibrahimi, leurs représentants emblèmatiques ;
– son aversion pour la corruption qui l’amena à exclure des centres de décision des dirigeants qui confondaient «ettawra oua etherwa» (la Révolution et la fortune), leur demandant «min aïna laka hadha ?»(d’où tiens-tu cela ?) ;
– son puissant soutien aux mouvements de libération auxquels il ouvrit des tribunes d’expression et des casernes d’entraînement supervisées par Slimane Hoffman – chef du département des relations extérieures, la seule structure du parti à détenir un pouvoir réel et où travaillaient également Djelloul Malaïka et Sadek Kitouni ;
– sa stature de leader influent du mouvement des pays non alignés, hôte d’une centaine de chefs d’Etat au sommet d’Alger de 1973, arbitre du conflit Irak-Iran, voix écoutée à l’ONU, à l’Opep, dans le monde arabo-musulman et même en Occident, si l’on en croit ce que Henry Kissinger en a dit dans Les années orageuses, ses mémoires.
A contrario, il ne s’était jamais considéré comme un politicien ou un chef de parti. Il voulait demeurer «le militant en uniforme» gardien — à tort ou à raison — du temple de «la pureté et de la grandeur de la Révolution», chef d’une armée qu’il réorganisa et modernisa avec le concours des DAF préférés aux maquisards qu’il écarta de sa direction.
Quelqu’aurait pu être sa perfection, toute œuvre de gouvernement est, par définition, porteuse de limites et d’échecs, une vérité aussi vieille que la politique qui échappa à la vigilance du président Boumediène, surpris par une lame de fond qu’il n’avait pas vu venir. Il s’en alla prématurément, sans avoir achevé son œuvre.
A sa mort, le peuple descendit dans la rue pour le pleurer et essayer de porter sa dépouille sur les épaules par rejet du conformisme du cérémonial officiel et de ses acteurs. A travers cette démonstration spontanée, on pourrait y lire la considération qu’il vouait à l’homme à qui il pensait devoir un Etat souverain, une monnaie forte, un système social protecteur, une dignité retrouvée et une aura célébrée dans le Tiers-Monde et au-delà.
Son successeur, Chadli Bendjedid, qui n’avait jamais figuré sur ses tablettes dans cette perspective, rompit avec son héritage en décidant d’engager le pays sur la voie de l’infitah.
Le FLN , intronisé «Parti-Etat» — vitrine et alibi —, fut embarqué dans cette entreprise jusqu’à ce qu’il succombe sous la déferlante du 5 Octobre 1988, sacrifié sur l’autel d’un multipartisme dans lequel il fit, à son corps défendant, une immersion des plus humiliantes.
B. M.
N. B. :
Les détails de la gouvernance des présidents Ahmed Ben Bella et Houari Boumediene n’ont pas été tous évoqués ici. Les lecteurs qui s’y intéresseraient sont invités à consulter les chapitres qui leur furent consacrés dans Les Présidents algériens à l’épreuve du pouvoir, essai paru, en 2015, chez Casbah Edition.Prochainement : «Les partis dirigeants algériens (5e partie). Le parti du FLN : du parti-État au multipartisme».
LES PARTIS DIRIGEANTS ALGÉRIENS
FLN : du parti-Etat au multipartisme (5e partie)
Publié par Badr’Eddine Mili
le 27.01.2019
Le 4e congrès du FLN prévu, du vivant du président Boumediène, à la fin de 1978, n’eut lieu qu’en janvier 1979, après le décès de celui auquel furent réservées, en présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, et d’un peuple, profondément, éploré, de grandioses funérailles mises au point par le directeur des services de renseignements, Kasdi Merbah, le chef de la 5e Région militaire, Mohamed Benahmed Abdelghani, futur Premier ministre du président Chadli Bendjedid, et Abdelmadjid Allahoum, directeur du protocole à la Présidence de la République.
Les forces — visibles — qui «pesaient», à ce moment-là, sur l’échiquier national avaient laissé entendre que les assises du parti allaient donner lieu, selon les vœux du président Boumediène, nouvellement élu à la tête de la République, le 10 décembre 1976, à une véritable «révolution» dans la gouvernance du pays. Mais personne n’était en mesure de dire en quoi elle consisterait ni ce qu’elle était censée devoir ou pouvoir changer.
Les acteurs de la scène politique aussi bien que les observateurs algériens et étrangers, informés des grincements répétés de la machine économique et sociale, n’ignoraient, cependant, pas que face aux vents mauvais annoncés par les contre-performances de la Révolution agraire et le désengagement de la bourgeoisie d’Etat qui ne jouait plus le jeu en s’alliant à la bourgeoisie privée, remontée à la surface, le président comptait bien assainir l’appareil corrompu de l’Administration et de l’économie où sévissaient ses adversaires les plus coriaces.
L’écho de cette annonce — ni confirmée ni infirmée par une source crédible — n’était amplifié, dans l’opinion, que par les cercles proches de la coordination du parti, l’Union nationale de la jeunesse algérienne de Mohamed Bourzam et l’Union nationale des paysans algériens de Aïssa Nadjem, auxquelles on avait prêté une envergure disproportionnée par rapport à leur poids politique réel.
Aussi, lorsque les 3 300 congressistes se retrouvèrent installés sur les travées de la coupole du 5-Juillet — certains scandant des mots d’ordre pro-socialistes — peu nombreux étaient au courant du scénario, déjà écrit par les officiers supérieurs de la sécurité militaire, aux termes duquel Chadli Bendjedid avait été désigné candidat à la succession du président Houari Boumediène, à la place de Yahiaoui, Bouteflika et Bencherif qui briguaient les suffrages des huit survivants du Conseil de la Révolution, l’un se prévalant d’un testament que le président défunt aurait laissé, les autres de leur compagnonnage militaire avec lui.
La surprise des partisans de la rupture avec les anti-socialistes essaimés dans les centres de décision de l’Etat d’où avait été expulsé, plus tôt, Kaïd Ahmed, opposé à la Révolution agraire, fut totale.
Non seulement, ils n’eurent pas droit à la «révolution» qu’ils tenaient pour acquise mais essuyèrent une défaite qui entama, sérieusement, et la solidité du socle du socialisme — option officielle de l’Etat — et l’assurance de ses dirigeants à commencer par Mohamed Salah Yahiaoui, invité, après l’invalidation de sa candidature, à céder le poste qu’il occupait à la tête du Front.
Les résolutions qui en signifièrent, en filigrane, le rejet, furent adoptées, à main levée, au pied d’un portrait géant représentant, au-dessus de la tribune du congrès, le président Houari Boumediène vêtu de son burnous noir, surmonté d’une légende prêtant — en décalage avec la dynamique en marche — le serment de fidélité du parti à sa personne et à son œuvre.
Elu secrétaire général du «parti du FLN» — la nouvelle appellation du Front —, Chadli Bendjedid, commandant de la base de l’Est pendant la Révolution, colonel, chef de la 5e puis de la 2e Région militaire, après l’indépendance, membre du Conseil de la Révolution, de 1965 à 1978, fut choisi par le congrès candidat unique à l’élection présidentielle du 7 février 1979 au titre d’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, ainsi que suggéré par ses compagnons.
Président, il gardera le pouvoir durant le même nombre d’années — 13 — que son prédécesseur, remplissant 3 mandats, le premier – 1979-1984 – employé à détricoter l’héritage boumediéniste, le deuxième — 1984-1988 — à restructurer l’économie en prévision d’une libéralisation rappelant l’Infitah du Président égyptien Anouar El-Sadate, et le dernier – 1988-1992 — à instaurer le multipartisme, aussitôt dévié de son cours par ses promoteurs comme par ses bénéficiaires, dirigeants du pouvoir d’Etat et partis d’opposition confondus.
1- Le FLN : parti de l’armée
Le FLN, sevré de congrès pendant 14 ans, sort, en ce mois de janvier 1979, d’une longue traversée du désert et renoue avec un rendez-vous statutaire qui accouche, contre toute attente, de l’antithèse de «la révolution» espérée par «les socialistes».
Ce que les «militants en uniforme» n’avaient pas jugé nécessaire d’entreprendre après Tripoli et après le 19 Juin, mettant du champ avec le parti, séparé, théoriquement, de l’armée par une cloison hermétique, le président Chadli Bendjedid le fit admettre.
Autant le président Houari Boumediène avait dédaigné la direction du parti — la confiant à des adjoints, Chérif Belkacem, peu rompu à ce genre de fonctions, et Kaïd Ahmed, ex-militant de l’Udma — parce qu’il estimait ne pas être un politicien, lui le chef militaire, exclusivement dévoué à la construction de l’Etat, autant le président Chadli Bendjedid qui ne s’embarrassait pas trop de la règle établie par son ancien responsable s’empara, à l’exemple d’Ahmed Ben Bella, du secrétariat général du parti qui lui sembla être le meilleur piédestal pour s’assurer les pleins pouvoirs.
N’étant pas, comme Houari Boumediène, le chef incontesté de l’ANP, il ne lui avait pas, en effet, échappé que ses pairs qui avaient appuyé sa candidature pensaient que, président par défaut, il serait plus maniable et, peut-être même éphémère à une charge qu’il avouera, dans ses mémoires, n’en avoir jamais voulu.
Cette donnée en main, il se révéla, à l’expérience, sous un jour inattendu : habile manœuvrier, derrière des dehors de pater familias, il réussit là où le sérail avait cru pouvoir limiter son rayon d’action, le prenant de vitesse par un renversement de rôles qui, au final, n’avait pas du tout déplu. Il fit entrer au bureau politique et au comité central, dès le congrès de 1979, tous les cadres dirigeants de l’armée, une tendance confirmée au congrès extraordinaire et au 5e congrès qu’il convoqua pour neutraliser, durablement, ses adversaires et asseoir un pouvoir dont il se servit pour amorcer un virage surprenant dans le gouvernement du pouvoir d’Etat.
Durant une décennie, jusqu’au retrait de l’institution militaire de la gestion politique du pays, en 1989, siégèrent, majoritairement, aux plus hautes instances du FLN, les officiers supérieurs – certains élevés, plus tard, au grade de général — Belhouchet, Belkheir, Kasdi Merbah, Abdelghani, Guenaïzia, Gheziel, Zerguini, Benyellès, Chelloufi, Hadjerès, Alleg, Latrèche, Lakhal Ayat, Lamari, Nezzar, Touati, Belloucif, Hamrouche, Abdelhamid Brahimi, Larbi Si Lahcène, Salim Saâdi, Rouis… aux côtés des civils Mehri, Taleb, Benyahia, Belaïd Abdeslam, Boualem Benhamouda, Lakhdiri, Hadj Yala, Benhabylès, Messaoudi Zitouni, Bessaïeh, Goudjil, Bouhadja, Ghozali, Bouhara, Djeghaba, Belkacem et Mohamed Nabi, Bouzbid… et d’une nouvelle vague de responsables recrutés dans les courants conservateurs de la politique et des organisations de masse, Belkhadem, Benmohamed, Othmane Saâdi, Kharoubi, Djilali Afane Guezzane, Mostefa Hachemaoui, Larbi Zoubeïri, Mohamed Abada, Larbi Ould Khelifa, Hasbellaoui, Baki, Gherieb, cohabitant, pour faire équilibre, avec les syndicalistes Mouloud Oumeziane, Abdellah Demène Debbih, Tayeb Belakhdar… et des militants et militantes formés dans les structures de base du parti et des organisations des paysans, des jeunes et des femmes, Ali Amar, Ghazali, Belayat, Bounekraf, Benfreha, Alioui, Z’hor Ounissi, Leïla Tayeb, Fatma Laoufi, Hamdadou, Cheriet, Hama Chouchane, Bachir Khaldoun, Bourzam, Bouchama, Laroussi… et de nouveaux arrivants, technocrates, Abdelhak Brerehi, Abdelaziz Khellaf, Mohamed Rouighi, Driss El-Djazaïri…
C’est avec l’appui de ces effectifs représentatifs des principaux pôles intermédiaires associés au pouvoir de l’armée que le président Chadli Bendjedid réalisera, avec des hauts et des bas, des objectifs maturés, au fur et à mesure qu’il prenait de l’ascendant, conseillé par les golden boys de l’infitah à l’algérienne qui déclassèrent les politiciens et les experts boumediénistes versés, dans le meilleur des cas, dans des commissions techniques sans incidence sur la décision finale.
En le replaçant sur une position dominatrice, fusionné, quasi organiquement, avec l’armée, le président Chadli Bendjedid fit du FLN le parti de l’Etat, presque un Etat dans l’Etat, le lieu des grandes messes où se prenaient les décisions les plus importantes débattues aux sessions thématiques du comité central.
Transformé en parti de l’armée, le FLN puisera dans le vivier de l’institution militaire les cadres destinés aux postes de commandement stratégiques, notamment, de Premier ministre et de chef de gouvernement : Mohamed Benahmed Abdelghani, Abdelhamid Brahimi, Kasdi Merbah et Mouloud Hamrouche qui se succédèrent à ce poste, prévu par la Constitution de Houari Boumediène et non pourvu sous son mandat, furent, à un moment ou à un autre de leur carrière, colonels ou lieutenants-colonels, chefs de corps ou anciens membres du Malg. Quant aux hautes fonctions ouvertes aux civils, leur accès était subordonné aux conditionnalités de l’article 120.
Dans un espace aussi fermé et avec des pouvoirs aussi exorbitants, souvent étalés sur la scène d’une politique-spectacle que le président se plaisait à orchestrer, le parti du FLN sera l’instrument central de la réalisation des trois tâches citées plus haut : la déboumediénisation, le passage à l’économie de marché et l’ouverture politique qui firent franchir à l’Algérie le Rubicon que les prospectivistes les plus hardis n’auraient imaginé que dans des scénarios de politique-fiction.
A ce stade de la passation des pouvoirs — là encore — entre deux conceptions de gouvernement, ce qui importait le plus au secrétaire général-président et à ses soutiens ce n’était pas tant de fissurer la cohésion du corps gouvernemental qu’il savait, parfaitement, recyclable, et auquel il reconnaissait, de toutes façons, en avoir été partie prenante consentante, le plus urgent était de rompre avec les options et les méthodes du système Boumediène que nombreux, parmi ses anciens acteurs, commençaient à avouer qu’elles étaient complètement dépassées.
On comprend, alors, pourquoi les cibles à avoir été visées, en priorité, furent le socle doctrinal et institutionnel du socialisme (Charte nationale et Constitution révisées en 1986) et l’expérience socialiste elle-même.
Les mesures préliminaires qui en balisèrent la voie — privatisation des terres de la Révolution agraire, lancement du Programme anti-pénurie, abrogation du droit au logement et suppression de l’autorisation de sortie du territoire national — seront présentées à l’opinion dans le paquetage d’une approche plus ouverte des problèmes de l’économie et de la société, une approche destinée à desserrer l’étau dirigiste qui les corsetait.
Mohamed Benahmed Abdelghani, Premier ministre-ministre de l’Intérieur qui en exécuta la première phase, avec une extrême rigueur, ne laissa à aucune excroissance du boumediénisme la chance de survivre.
Le processus de la Révolution agraire fut arrêté et ses exécutants – Tayebi Larbi et Mohamed Abdelaziz – renvoyés et leur Commission nationale dissoute, simultanément au gel de la Gestion socialiste des entreprises (GSE) et de ses Assemblées.
Bien entendu, le parti du FLN acquiesça, sans broncher, à ce New Deal dont il sera le premier à profiter en rachetant, au dinar symbolique, les terres nationalisées et les biens vacants, opérant, dans ce sillage, sa conversion en carrefour des courants d’affaires boostés par la gestion opaque du PAP et le lancement, avec des entreprises étrangères, de nombreux chantiers infrastructurels.
Dans un ordre et une discipline qui l’avaient déserté, depuis longtemps, il s’était réorganisé avec de nouveaux militants encadrés par 48 mouhafadas — une par wilaya — ses organes supérieurs —bureau politique, comité central et commissions — réunis régulièrement et fonctionnant à plein temps.
A l’aide de cette machine bien huilée, le secrétaire général-Président n’eut aucune difficulté à faire passer ses projets, dans le silence impuissant des «socialistes» mis en minorité.
2- La déboumediénisation : 1979 – 1983
Dans les faits, la déboumediénisation prit l’allure d’une purge soft qui ne toucha qu’un nombre limité d’anciens collaborateurs de l’ancien président.
Chadli Bendjedid sut y mettre les formes. Il se contenta de les dessaisir de leurs postes de responsabilité sans les humilier ni les mettre, complètement, hors jeu, puisqu’il continua à les consulter.
Mohamed Salah Yahiaoui, populaire auprès des officiers qu’il avait formés du temps où il dirigeait l’Académie militaire de Cherchell, bénéficia de ce comportement «civilisé» qui trancha avec les méthodes du passé.
Plusieurs boumediénistes convaincus, firent, ainsi, leur entrée dans les deux gouvernements de Mohamed Benahmed Abdelghani (1979-1980 et 1980-1982) : Benyahia, Aït Messaoudène, Liassine, Messaâdia, Houhat nommés à des ministères importants, Mouloud Hamrouche appelé à la direction du protocole de la Présidence en remplacement de Abdelmadjid Allahoum promu ministre du Tourisme, Mahieddine Amimour et Abdelmalek Kerkeb maintenus dans leurs fonctions, Ahmed Draïa et Redha Malek affectés à des postes diplomatiques, en furent la preuve, contrairement à Smaïl Mahroug et Abdellah Khodja, non reconduits, à Messaoud Zeggar déféré devant la justice et, plus tard, à Rabah Bitat appelé à céder la présidence de l’APN à Abdelaziz Belkhadem.
Le seul proche compagnon de Houari Boumediène à avoir été, brutalement, écarté de la Présidence où il était ministre conseiller fut Abdelaziz Bouteflika mis en débet par la Cour des comptes, présidée par Messaoudi Zitouni, pour une affaire de mauvaise gestion des budgets des ambassades algériennes à l’étranger et traduit, pour le même motif, devant la commission de discipline du parti dirigée par Mostefa Benaouda qui l’exclut du comité central. Chérif Belkacem et Kaïd Ahmed étaient déjà tombés en disgrâce du fait de leur chef, lui-même, et leur sort, scellé depuis longtemps, ne nécessitait pas un réexamen.
3- La restructuration de l’économie
En accordant leur quitus aux plans quinquennaux qui projetaient de restructurer l’économie à tous ses paliers – production, commercialisation, transport –, les congrès successifs du parti prirent sur eux d’agréer une doctrine et une méthode sans avoir évalué les risques encourus, de leur fait, par l’intégration des secteurs, l’équilibre du monde du travail et la cohésion de la société, principes supposés imprescriptibles du modèle social algérien.
Ministre de la Planification et de l’Aménagement du territoire dans le 2e gouvernement de Mohamed Benahmed Abdelghani, l’architecte et le metteur en œuvre de ces plans, tout désigné, devait être, immanquablement, Abdelhamid Brahimi.
Son pouvoir renforcé par son élévation au rang de membre suppléant du bureau politique, il prit possession du Premier ministère avec, en main, les clés de tout le dispositif que son cabinet avait préparé au ministère de la Planification qui sera, d’ailleurs, supprimé dans l’organigramme du nouveau gouvernement.
Ce dispositif prévoyait de «réorganiser» le tissu industriel qui passait pour être lourd, coûteux et improductif. Les entreprises industrielles, premières cibles de cette restructuration, furent disloquées, leurs fonctions, production, commercialisation, séparées et leurs sièges décentralisés. Les autres secteurs – en principe non concernés – seront sacrifiés de la même façon.
Même la RTA n’échappa pas à ce démantèlement, éclatée en 4 entreprises, cédant son espace aux chaînes du PAF français et à leurs écrans publicitaires qui initièrent les Algériens aux rites consuméristes des pays capitalistes grâce aux paraboles importées par l’informel et apparues, en nombre, sur les façades des immeubles des grandes villes du pays.
Le balisage de ce blitzkrieg économique fut préparé, aussi, par un travail diplomatique.
Dès 1980, le secrétaire général-président décida de se mettre en retrait du mouvement des pays non alignés, s’abstenant, inexplicablement, au 6e Sommet de La Havane, de prendre la parole devant ses pairs, une des prémices du renversement, spectaculaire, des alliances internationales de l’Algérie, complètement à rebours des traditions bâties par sa diplomatie à Bandoeng.
Le seul dossier sur lequel la position officielle sera maintenue fut celui de la Palestine dont l’Etat est proclamé, à Alger, grâce au concours prêté par la direction des relations extérieures du FLN et son responsable Zouaten.
On ne jura plus, à Alger, que par l’amitié déclarée aux présidents Reagan et Mitterrand, au roi Hassan II, hôte du sommet de Marrakech, fondateur de l’UMA, ainsi qu’à la reine Elisabeth et au roi Baudouin avec lesquels le président échangeait des visites d’Etat, ne conservant avec les pays communistes que des relations distendues.
Du faîte de cette soudaine gloire sur lequel il s’était juché, le FLN n’avait pas vu pointer à l’horizon la débâcle pétrolière et financière, le premier signal de la bourrasque qui allait l’emporter, tout qu’il était à rêver de rééditer, en Algérie, l’exploit du parti révolutionnaire institutionnel, héritier du Parti national révolutionnaire du Mexique qui gouverna le pays, sans interruption, plus de 150 ans après son indépendance.
Il l’avait, même, ignoré, engagé dans une fuite en avant qu’il fut le premier à payer, en Octobre 1988, après avoir été au centre des scandales de la corruption dont il montrait, ostensiblement, les signes extérieurs aux Algériens révoltés.
Mohamed Chérif Messaâdia, coordinateur du secrétariat permanent du comité central qu’il fit siéger au Palais du gouvernement dans un geste destiné à leurrer ses adversaires sur sa toute-puissance, dut quitter ses fonctions sous le feu des dizaines de kasmas incendiées par les jeunes manifestants.
L’Algérie privée de ressources, criblée de dettes, éclaboussée par l’affaire des 26 milliards – ballon-sonde ? — éventée par Abdelhamid Brahimi, minée par la crise identitaire et l’apparition du maquis de Bouyali, avait perdu ses repères.
Le président Chadli Bendjedid et la troïka Belkheir-Hamrouche-Khediri n’entrevirent le salut du régime que dans l’ouverture politique s’en remettant à la bienveillance des Clubs de Paris et de Londres et obligés de passer sous les fourches caudines du FMI et de son austère Programme d’ajustement structurel.
4- L’ouverture politique
Les réticences des conservateurs vis-à-vis de cette ouverture la retardèrent de onze mois, le temps de les circonscrire au moyen d’un gouvernement de compromis — novembre 1988-septembre 1989 — que Kasdi Merbah, renvoyé à la vie civile, après des pérégrinations dans plusieurs vice-ministères et ministères, pensa, probablement, utiliser pour se tailler un destin national similaire à celui d’Andropov, l’éphémère chef du parti et de l’Etat soviétiques détrôné par la Perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev.
Son débarquement mouvementé du gouvernement ne laissa à l’ancien directeur des services de renseignements aucune autre alternative que de créer quelques mois plus tard – novembre 1990 – un parti d’opposition, le Majd.
Mouloud Hamrouche lui succéda, le 9 septembre 1989, délégué dans la mission de mettre en place la nouvelle organisation politique et économique décrétée par la Constitution d’avril 1989.
En 21 mois, le nouveau chef d’un gouvernement d’où avaient été supprimés les portefeuilles des Moudjahidine et de l’Information s’appliqua à refonder les institutions de l’Etat et à soumettre l’économie aux nouvelles règles libérales inspirées par Hidouci, Goumeziane, Belaïb, Benyounès et Korichi — le père de la formule : «Ça passe ou ça casse» —, règles formalisées par une législation portant ouverture, au marché, des entreprises, du commerce, de la monnaie et du crédit.
Ce gouvernement «réformateur» qui encouragea la fondation d’une Ligue des droits de l’homme, présidée par Me Miloud Brahimi, se déclara indépendant du parti du FLN confié à la direction de Abdelhamid Mehri, vétéran du mouvement national, auquel incomba la tâche ingrate de limiter la casse pour une formation qui frôla l’infamante injonction d’introduire auprès du ministère de l’Intérieur une demande d’agrément nécessaire à sa mise en conformité avec la nouvelle loi.
Le secrétaire général, Chadli Bendjedid, et, à sa suite, tous les officiers de l’armée s’étant retiré de ses organes dirigeants ainsi que l’édictait la nouvelle Constitution, le FLN où Abderrazak Bouhara voulait créer, en vain, quatre tribunes – nationaliste, islamiste, berbériste et de gauche – chuta à un rang encore plus subalterne que celui qu’il occupait en 1965.
La négociation de ce gap fut rude entre les deux tendances de l’armée, qui s’opposaient sur l’avenir institutionnel du régime, l’une dirigée par Chadli Bendjedid décidée à promouvoir «la démocratie» et l’autre regroupée autour des DAF qui, n’était son implication directe dans la répression de la révolte d’Octobre, n’aurait, jamais, accepté ce dénouement qui la mettait en position de retrait intenable pour une institution qui avait pris l’habitude de décider de tout.
Le dévoiement de l’expérience mena droit à la démission de Mouloud Hamrouche, poussé — après l’autorisation accordée aux troupes du FIS de stationner sur les principales places d’Alger — à céder la place, le 5 juin 1991, à Sid Ahmed Ghozali qui déroula – avec la révision du découpage des circonscriptions électorales et du mode de scrutin – le tapis rouge à la victoire du Front islamique, au premier tour des élections législatives du 26 décembre 1991.
Les officiers du Haut-Commandement de l’ANP, menacés dans leur vie et défiés par l’insurrection lancée par les islamistes contre l’ordre républicain, suspendirent le processus électoral et procédèrent – une fois la démission du président Chadli Bendjedid rendue publique le 12 janvier 1992 — à la création du HCE (Haut-Comité d’Etat) à la tête duquel fut placé Mohamed Boudiaf ramené de Kénitra, un changement de régime dénoncé, aussitôt, par le FLN qui entra dans l’opposition, une première dans le système pluraliste qu’il venait d’instaurer.
Pour la cinquième fois, après les clashs de 1950, 1957, 1962 et 1965, les militants civils se dissocièrent des «militants en uniforme» et prirent leur contrepied. Abdelhamid Mehri, militant civil qui chemina, à travers les méandres du PPA-MTLD, du CNRA et du GPRA, considéra la nouvelle action des militaires comme une entrave «au passage de la légitimité révolutionnaire à la légitimité constitutionnelle».
Trente-sept ans après sa création, le FLN n’était plus, en ce début des années 90, que l’ombre de lui-même, dépouillé de ce qui lui restait d’identité historique et idéologique, au point que son premier leader, Mohamed Boudiaf, le déclara irrécupérable en prononçant sa faillite.
5- Observations
Trois observations peuvent être notées à ce propos :
a) En dix ans de «libéralisation», la substance même du parti avait changé sous l’effet de l’élargissement de la base du pouvoir d’Etat à plusieurs forces qui ne partageaient ni les référents ni les programmes définis par les textes fondateurs du Front.
Son basculement, à droite, s’effectua suite à la conquête totale de sa base et de sa direction par les représentants des secteurs conservateurs et affairistes de la société aux dépens des militants de gauche chassés de ses structures alors qu’ils avaient constitué, à certaines étapes de son évolution post-indépendance, une part non négligeable de son élite.
La révision de la Charte nationale du président Houari Boumediène légalisa ce revirement qui organisa le parti en réseau d’alliances basées sur le partage d’intérêts économiques, familiaux et religieux, en plus de l’appartenance régionale, tribale et clanique.
Cette rupture des consensus que le parti avait construits, malgré ses contradictions et ses crises, prépara le terrain à plusieurs inflexions idéologiques dont l’une des expressions fut l’invitation adressée par le président Chadli Bendjedid à l’imam Mohamed El-Ghazali de venir enseigner le wahhabisme en Algérie, une caution apportée aux adversaires de l’équilibrisme que le parti cultiva, en particulier, entre 1975 et 1978.
L’intention prêtée, ultérieurement, au président, d’accepter de cohabiter avec le FIS en cas de victoire de ce dernier aux élections, indiqua, clairement, vers quel cap le parti fut orienté.
Abdelhamid Mehri le confirma à Rome où il parapha «la plateforme de Sant Egidio» avec Anwar Haddam, un des dirigeants du parti islamiste qui avait revendiqué, auparavant, l’attentat du boulevard Amirouche.
b) Le statut de parti-Etat taillé au FLN, au lendemain du congrès de 1979, l’avait rendu «invulnérable», pourvoyeur de fonctions de pouvoirs et, aussi, machine électorale qui garantira au président deux réélections de suite. Il avait, cependant, suffi que l’armée soit amenée à le quitter, pour qu’il perde, coup sur coup, deux consultations capitales, les communales, en 1990, et les législatives, en 1991.
Dans ces deux épreuves probatoires libres qui changeaient de la double candidature sur les listes uniques, procédé utilisé à l’époque de la coordination (cf. l’élection législative partielle qui opposa Ali Amar à Abdelaziz Ziari dans la circonscription de Bab-El-Oued), le FLN échoua, désavoué par un vote de rejet dont il ne se relèvera difficilement que 10 ans plus tard, sauvé, in-extremis, par le président Abdelaziz Bouteflika qu’il utilisa à des desseins analogues à ceux du président Chadli Bendjedid : renverser le rapport de force, en sa faveur, contre les militaires – principalement ceux du DRS — sous le couvert du projet d’Etat civil.
c) L’entrée du FLN dans l’opposition, après 1992, remit à l’ordre du jour la rivalité récurrente entre les militants civils et «les militants en uniforme» — qui avaient, en principe, cessé d’être des militants pour devenir des militaires professionnels — un énième conflit déclenché, cette fois-ci, par un officier de carrière devenu président, révolté contre la lourde tutelle d’une hiérarchie qu’il avait tenté de diviser, en restructurant la direction des services de renseignements et en limogeant, l’un après l’autre, ses principaux chefs, Kasdi Merbah, Mohamed Betchine, Abdelghani Lakhal Ayat…
L’analyse, sous ce rapport, des principales décisions prises par le président Chadli Bendjedid, sous ses différents mandats, permet de faire ressortir deux périodes : au cours de la première, le président reconduisit, telle quelle, la résolution du CNRA du Caire, de 1957, en impliquant, directement, «les militants en uniforme» dans la gestion du parti, au moment où sa position à la tête de l’Etat était, encore, mal assurée.Une fois son pouvoir consolidé, lors de la seconde période, il décida de s’autonomiser et de mener la course, seul en tête, en jouant le parti contre l’armée.
Il en fit sortir les militaires en remettant la direction entre les mains des militants civils menés par un ancien responsable du PPA/MTLD, en l’occurrence Abdelhamid Mehri, rappelant des épisodes anciens du mouvement national indépendantiste, la goutte qui fit déborder le vase.
Les «janviéristes» passés à l’action pour «sauver la République», à la place d’un parti «failli», consommèrent le divorce de l’ANP avec le FLN qui sera remis dans «le droit chemin» par le renversement anti-statutaire de son secrétaire général, et puni, en 1997, par la scission suscitée en son sein, d’où sortira l’alternative qui portera le nom de Rassemblement national démocratique.
B. E. M.
Prochainement : Les partis dirigeants algériens (6e partie) le rassemblement national démocratique : le parti de l’aternative néo-nationaliste
LES PARTIS DIRIGEANTS ALGÉRIENS
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL DEMOCRATIQUE (RND) : Le parti de «l’alternative néo-nationaliste» ? (6e partie)
par Badr’Eddine Mili
le 27.02.2019
Le Rassemblement national démocratique fut l’un des derniers partis à recevoir son agrément, à l’antépénultième phase de l’ouverture politique de 1989. A peine entré en activité, il remporte les élections législatives, organisées, en juin de la même année, par Liamine Zeroual, confortablement élu à la présidence de la République deux ans auparavant.
La rapidité avec laquelle le montage du parti fut finalisé et le caractère miraculeux de la victoire qui lui remit les clefs de l’Exécutif alors que ses militants finissaient, tout juste, de quitter le FLN jetèrent le trouble au sein de l’opinion et de la classe politique et firent douter de la régularité du scrutin.
Cette suspicion, qui n’en finit pas de coller à la réputation du RND, fit passer au second plan la question de sa genèse, dans le temps où il était aussi important de chercher à savoir où il a pris racine, pourquoi il a été constitué et en quoi il aurait été «le parti de l’alternative néo-nationaliste», l’égide sous laquelle ses premiers copromoteurs l’étrennèrent.
1- Les antécédents historiques
L’évènement en soi n’aurait pas prêté à conséquence, s’il n’avait pas concerné le parti artisan de l’indépendance nationale, victime, d’après ses militants restés fidèles, d’un parricide punitif, une des causes du profond ressentiment nourri, à ce jour, à l’égard des auteurs de ce «coup de force».
Plusieurs antécédents analogues enregistrés par l’Histoire des partis algériens pré et post-indépendance et, également, de partis maghrébins s’étant soldés, pour les uns, par la disparition de la souche-mère et, pour d’autres, par la cohabitation entre l’ancienne et ses dérivées confirment qu’effectivement de tels «accidents» survenus dans la vie organique de formations partisanes ne devraient être pris que pour ce qu’ils sont et signifient dans le contexte politico-social qui les fit surgir.
* De l’éclatement, par exemple, du MTLD, aux congrès d’Hornu et d’Alger, en 1954, aucun résidu de la formation génitrice ne subsista et personne n’en entendit parler autrement que comme d’un fait d’Histoire.
* Après l’indépendance, le Parti communiste algérien, interdit, se disloqua, remplacé par plusieurs branches successives (PAGS, Ettahadi, MDS, PLD et PLDS) qui déclarèrent, toutes, être les légataires exclusives de son patrimoine historique.
* L’interdiction du FIS s’accompagna de la mise en service d’une demi-douzaine de fausses répliques formatées pour ne pas pouvoir en reconstituer le génome et celles qui s’y essayèrent furent sanctionnées par des redressements, en chaîne, dont elles traînent, encore, les effets.
* Au Maghreb, plusieurs partis eurent à vivre, avant et après l’indépendance, des expériences de divorce ou de transmutations aussi dures et imprévisibles.
• En Tunisie, le Néo-Destour prit, en 1934, la relève du Destour de Abdelaziz Thaâlbi, sous l’impulsion de Habib Bourguiba décidé à recourir à la violence armée pour libérer le pays, puis à ouvrir le dialogue avec l’Administration du Protectorat que la bourgeoisie tunisienne recommandait dans sa recherche d’un compromis sur une indépendance par étapes.
Le Néo-Destour qui embrassa le socialisme, en 1964, sous le nom de Parti socialiste destourien s’effaça, à son tour, en 1988, devant le Rassemblement constitutionnel démocratique du président Zine El-Abidine Ben Ali, lequel fut dissous par la Révolution de 2011, laissant le champ libre à Nidaâ Tounès du président Béji Caïd Essebsi, lui-même en passe de s’émonder d’une de ses tendances qui projette de s’organiser en parti indépendant, sous l’égide de Youcef Chahed, l’actuel chef du gouvernement.
• Au Maroc, l’Union nationale des forces populaires (UNFP) quitte, en 1959, le Parti de l’Istiqlal de Allal El-Fassi, à l’initiative de Mehdi Ben Barka, leader de son aile gauche, une aile qui ne tardera pas à muter au nom du socialisme et de la démocratie en Union socialiste des forces populaires (USFP) prise en mains par Abderahim Bouabid, un de ses chefs historiques anti-Makhzen. On voit, à ces quelques exemples, illustratifs des convulsions qui peuvent affecter la vie organique des partis arrivés à la croisée des itinéraires des forces qui les composent, du fait de mutations sociologiques, de conflits idéologiques et de stratégies de pouvoir, que l’apparition du RND dans le champ politique algérien n’avait rien d’exceptionnel.
Il n’entre naturellement pas dans la préoccupation de cette analyse d’en établir ou non le bien fondé car le seul objectif qu’elle vise est de tenter d’expliquer comment cela fut rendu possible et de chercher à isoler les fils conducteurs qui y mènent afin de reconstituer le processus qui structura le parti et le rendit différent du FLN.
2- Les causes génériques
L’idée de créer un parti du pouvoir autre que le FLN avait vraisemblablement été envisagée, au moins théoriquement, après les évènements du 5 Octobre 1988 qui mirent à nu l’impuissance du parti à offrir à la révolte des jeunes un exutoire salutaire.
L’ANP, sortie des casernes sur ordre du Président, ministre de la Défense, pour mettre fin à un mouvement dont personne n’a pu cerner les véritables tenants, tant le cafouillage au sommet de l’Etat était grand, comprit, à ce moment-là, qu’elle ne pouvait plus compter sur un parti que la population n’arrivait pas à suivre ni à percevoir à travers le faste de ses cérémoniaux en porte-à-faux avec les réalités de la société et du pays. L’idée a dû faire son chemin et s’affiner lorsque le FLN se rebella contre le Haut Commandement de l’armée en faisant bloc avec le FIS et le FFS qui réclamaient le retour aux urnes.
Entre ces deux dates – 1988 et 1992 – un évènement important vint modifier une des règles du partage des pouvoirs entre l’institution présidentielle et l’institution militaire. Le Président Chadli Bendjedid voulant, coûte que coûte, passer outre les réserves des officiers supérieurs sur la question du traitement de la menace islamiste fut amené, après une rude empoignade, et dans un climat alourdi par les menaces de la guerre du Golfe, à renoncer, le 25 juillet 1990, au poste de ministre de la Défense auquel fut nommé Khaled Nezzar, le premier désaccouplement entre les deux charges depuis le président Houari Boumediène qui les avait cumulées, sans discontinuer, jusqu’à sa mort ; et, aussi, le signal fort de la prochaine reprise en main par l’ANP de la direction de l’Etat dans sa totalité.
3- L’intermède du Rassemblement populaire national
Après le 12 janvier 1992, le Haut Commandement militaire, de retour, donc, aux affaires, travailla, dans un premier temps, à recomposer le paysage politique, en mobilisant les forces dont il avait besoin pour faire face à la crise. A cette opération, il associa, à contrecœur, le FLN qui était, entre-temps, rentré, dans «la Maison de l’Obéissance» avec Boualem Benhamouda, son nouveau secrétaire général désigné.
Mais la défiance était encore là et pas un seul responsable du nouveau pouvoir d’Etat n’était enclin à absoudre de sa «trahison» un parti devenu infréquentable.
Aussi, quand Mohamed Boudiaf mit sur la table, dès son investiture à la tête du HCE, le projet de créer un nouveau parti — le RPN —, aucune objection ne lui fut opposée par les décideurs. L’implantation de la formation fut confiée à des proches : Ahmed Bouchaïb, ancien membre du groupe des 22, Akli Benyounès, ancien dirigeant de l’ex-Fédération FLN de France, Ahmed Djebbar, ministre de l’Education, et Krim, conseiller à la Présidence.
La thèse soutenue par son fondateur était que le RPN répondait à une demande politique pressante qui excluait le maintien en fonction du FLN et requerrait son extinction et sa restitution à l’Histoire selon le vœu qu’il émit dès 1962.
A moins d’une dissolution judiciaire motivée, nul ne voyait comment cela pouvait, concrètement, se réaliser, bien que l’avis de certains inclinait vers une solution plus politique : vider le FLN de ses militants et le couper de son socle social et électoral. Sans militants et sans électeurs, le parti évoluerait vers une mise hors service qui l’obligerait à déclarer lui- même sa faillite.
L’assassinat de Mohamed Boudiaf le 29 juin 1992 ajourna, momentanément, le projet, mais l’idée ne fut pas abandonnée puisqu’elle sera remise à l’ordre du jour cinq ans plus tard.
4- La première inspiration
Le premier inspirateur et ordonnateur du RND est, sans conteste, le général Mohamed Betchine, ministre conseiller du président, qui mit dans la confidence Bachir Boumaza, le futur président du Conseil de la nation puis approcha Abdelhak Benhamouda, secrétaire général de l’UGTA et président du Conseil national de sauvegarde de l’Algérie, auquel il demanda de contribuer, en tant que leader de la société civile, à la formulation d’une alternative au FLN. Il faut revenir à la Conférence du dialogue national dite de «l’Entente» pour mettre la main sur le fil conducteur du projet. Pas très en cour et décrié par les manifestations anti-Sant’ Egidio, le FLN avait adopté, même après la destitution de Abdelhamid Mehri, un profil bas à cette conférence boycottée par le FFS, le RCD et le MDA mais où le rôle vedette avait été campé par le millier de délégués représentant les partis comme Hamas, les organisations de «la famille révolutionnaire», les associations de la société civile, les membres du Conseil national de transition et les ministres des 1er et 2e gouvernements Sifi (1994-1995) qu’on retrouvera dans le gouvernement Ouyahia (1995) puis, en 1997, dans l’encadrement du RND.
La Conférence put, ainsi, réunir les deux conditions requises, en général, par la constitution d’un parti : une composante de base et une plateforme-programme qui contenait les objectifs phares — la concorde civile et le rétablissement de l’ordre institutionnel légal — que la Présidence de l’Etat comptait réaliser.
Toutefois, après cette Conférence suivie de l’élection présidentielle, il apparut, d’après plusieurs recoupements, quasi certain, qu’il n’entrait, nullement, dans les intentions du président Liamine Zeroual de se doter d’un parti qui lui servirait de machine électorale ou de caisse de résonnance, au moins, pour deux raisons :
* Se mêler de politique politicienne aurait fait du Président élu par le peuple qu’il était un homme de parti, une éventualité qui ne cadrait pas avec sa conception de la fonction présidentielle.
En revanche, il avait préféré jeter des ponts en direction de la société par le biais de Hauts Conseils, et surtout, d’une institution «indépendante» — la Médiature — présidée par Abdeslam Habachi, un autre ancien membre du groupe des 22 qui en fit une administration parallèle à l’Etat, une des raisons de son échec.
* Le Président ne pensait pas, non plus, avoir besoin d’une machine électorale qui travaillerait à pérenniser son pouvoir, tout simplement parce qu’il avait limité le nombre des mandats présidentiels à deux.
Il avait, d’ailleurs, exhorté la Cnisel, à son installation officielle avant les élections de juin 1997, à traiter les partis en lice avec équité et à n’en favoriser aucun, «surtout pas celui que certains apparentent à ma personne».
Cette réserve ne découragea pas le général Mohamed Betchine qui agissait sur un registre plus prospectiviste, engagé dans la gestion d’un enjeu de pouvoir qu’il tenait pour vital pour la poursuite de l’accomplissement de l’œuvre de «redressement national» du président.
Revenu à la charge, à plusieurs reprises, il arracha, quand-même, le feu vert du chef de l’Etat donné du bout des lèvres. L’ancien directeur central de la sécurité de l’armée (DCSA), en froid avec l’état-major qui voyait d’un œil soupçonneux la position influente qu’il occupait au Palais d’El-Mouradia, pressentait que le président devait, quoi qu’il eut pensé, être protégé contre le pouvoir envahissant des généraux qui risquait de le ligoter, voire de l’isoler complètement, notamment, sur le chapitre des négociations parallèles entamées par certains d’entre eux avec Madani Mezrag, le chef de l’AIS.
En plus du discrédit consommé du FLN auquel il fallait pallier, il lui sembla nécessaire, dans cette logique, de mettre sur pied un garde-fou politique appelé à neutraliser le parasitage de ses pairs et à parer à des évènements intercurrents susceptibles d’advenir. Toujours à la manœuvre, servi par son groupe de presse, mais ne voulant pas apparaître, sous les feux de la rampe, comme «le commanditaire», il sollicita Abdelhak Benhamouda qui en appelait, de son côté, au renouvellement du socle politique et doctrinal de la République en association avec d’autres forces de la société branchées sur une perspective plus large que celle du ministre conseiller du Président.
5- La part de la société civile
Abdelhak Benhamouda endossa l’idée en l’embrayant sur une vitesse supérieure qui dépassait les limites d’un simple enjeu de pouvoir interne à un cercle restreint de dirigeants. Il avança deux considérations qui étayaient la particularité de sa vision :
* Le désaveu électoral essuyé par le FLN aux législatives de 1991 et son alignement sur la position des «ennemis de la République» lui interdisaient de prétendre rejouer un rôle d’influence dans les rouages de l’Etat.
* Le RND n’avait pas vocation de continuer le FLN sous la couverture d’un nouveau sigle qui actionnerait une improbable réactivation de son ADN révolutionnaire ainsi que Mohamed Boudiaf l’avait espéré.
Pour le secrétaire général de l’UGTA, il était question, plus fondamentalement, que le RND incarne «l’alternative néo-nationaliste» attendue par une société qui avait hissé ses exigences au niveau de l’acquisition d’un Etat de droit constructeur d’une citoyenneté libérée. L’introduction dans son discours d’un verbatim référencé au patriotisme scella, plus étroitement, sa convergence avec le pôle de la gauche démocratique intéressée à construire un rempart anti-intégriste et anti-autoritariste avec les néo-nationalistes progressistes.
Personnalité charismatique très forte portée par une vague médiatique particulièrement favorable, Abdelhak Benhamouda ne se cacha plus de vouloir faire valoir tous ces atouts et participer à apprêter à la société civile et politique qu’il pensait représenter, le tremplin qui la porterait au pouvoir et consoliderait la victoire que la résistance populaire anti-terroriste était en train de remporter. A tort ou à raison, ses appuis politiques et syndicaux n’étaient pas loin de le voir prétendre, légitimement, à un destin national.
Son assassinat, le 27 janvier 1997, sur le parvis de la Maison du peuple referma la parenthèse sur une partie de la première variante, en gestation, du RND.
Seulement, personne ne put répondre à la question de savoir si le leader syndicaliste avait ou non péché par précipitation et s’il avait été ou non politiquement naïf, au point de manquer de saisir la véritable mesure du rapport de forces entre la présidence de la République et le Haut Commandement de l’ANP.
6- Le RND, parti de la nouvelle nomenklatura
A son premier congrès, minutieusement préparé par le général Mohamed Betchine, en l’absence de représentants de l’état-major, le RND se présenta en ordre de bataille, prêt à se débarrasser de l’emprise du pôle d’en face et à conquérir une place dans le premier carré du pouvoir.
La liste des congressistes comprenait les corps constitués, les commis de l’Administration, les dirigeants des secteurs de l’économie, les staffs des organisations de masse du FLN – moins l’UNEA de Abdelaziz Belaïd, l’un des rares syndicats, avec l’UNPA, à être resté dans le giron de l’ex-parti unique – auxquels s’ajoutèrent les Patriotes, les GLD, les maires et des hommes et femmes de médias publics.
Avec le ministre conseiller Mohamed Betchine et Amar Zegrar, secrétaire général de la présidence de la République, les participants qui se verront désignés membres des instances du parti sont le chef du gouvernement Ahmed Ouyahia, les ministres Adami, Benbouzid, Attaf, Harchaoui, Guidoum, Belaïb, Yousfi, Ghoulamallah, Rahmani, Aïssaoui, Moussaoui, Meghlaoui, Bahbouh, Salaouandji…, les dirigeants des organisations de «la famille révolutionnaire» et des syndicats Abadou, Abbas, Bouzghoub (ONM), Benbaïbèche, Khaldi (Onec), Khalfa (Onem), Sidi Saïd, Malki (UGTA), Hafsi (UNFA), Benbraham (SMA), Flici (Association des familles victimes du terrorisme), les maires Seddik Chihab, Tayeb Zitouni, les chefs d’entreprises privées comme Bouchouareb et les journalistes Hamraoui, Mihoubi, Benarous, Djaâfar… La réaction de l’état-major et, en particulier, du DRS qui entendait récupérer le contrôle de ce cheval de Troie dans une course de vitesse éperdue et riche en rebondissements fut prompte. Après quelques péripéties, le bras de force se conclua, une année après, par la «normalisation» de la situation obtenue avec la démission du général Mohamed Betchine de son poste à la Présidence, en octobre 1998, précédée par une virulente campagne de presse orchestrée par ses adversaires des services de renseignements.
L’homogénéité du parti fut établie, pour une longue durée, après le départ de Mohamed Tahar Benbaïbèche, le très éphémère premier secrétaire et l’élection de Abdelkader Bensalah au secrétariat général qu’il échangera, deux fois, avec Ahmed Ouyahia.
La route était désormais déblayée devant la version définitive du parti promue par une nouvelle alliance placée sous les auspices des vainqueurs et portant sur sa carte génétique les deux éléments de sa nouvelle identité : le centrisme et le néolibéralisme.
7- Le RND, parti du centre néolibéral
Par son ancrage et son orientation, le RND peut être défini par ce qu’il n’est pas.
Il n’est pas, comme le FLN, un parti au spectre social large : il est absent au sein de la paysannerie, de la jeunesse et des milieux intellectuels ; sa principale force, il la recruta dans les corps de l’administration centrale et locale, de la bourgeoisie privée et des entreprises stratégiques de l’Etat et annonce, tout de suite, la couleur en adhérant à l’Internationale démocrate centriste.
Avec des effectifs incrustés dans les rouages de l’administration, il se pose, d’entrée de jeu, en parti de la nouvelle nomenklatura de l’Etat qui avait pris ses distances avec le vieux nationalisme entretenu par les anciennes générations aux manettes du Front depuis 1962.
Il professe un nationalisme «moderne et républicain», libéré de ses aspérités rugueuses et surnommé «novembriste» qui convenait mieux aux intérêts d’une bourgeoisie d’affaires alliée au capitalisme international et concurrente de l’informel fondamentaliste.
Au fronton de son programme économique, il inscrivit, en priorité, la privatisation des entreprises publiques en intégrant, dans sa stratégie, quelques recettes des politiques de réformes expérimentées par les gouvernements Brahimi et Hamrouche, et s’assura du concours d’anciens «réformateurs», comme Bakhti Belaïb, invités à l’aider à les relooker.
La forte présence, au début, dans ses rangs, de moudjahidine et de patriotes qui s’étaient, puissamment, investis dans la lutte contre le terrorisme, le contraignit, néanmoins, à compenser ses propositions libérales très dures pour les classes populaires par la proclamation d’un «patriotisme économique» destiné à masquer son véritable programme de droite.
Le gouvernement Ouyahia que le président Liamine Zeroual laissa diriger, sans interférence, par respect aux prérogatives reconnues à l’Exécutif par la Constitution, mena, dans la pratique, une politique à l’opposé de ses affirmations, une ligne qui sera systématisée jusqu’à faire prendre au parti des décisions antinomiques allant de l’éradication de l’islamisme à la réconciliation avec lui et du «patriotisme économique» au néolibéralisme.
Avec l’arrivée du président Abdelaziz Bouteflika aux commandes de l’Etat, il abandonna son programme pour s’aligner sur celui du président de la République, président du FLN…
Entre autres conclusions provisoires qu’elle suggère, l’analyse qui précède à ceci d’intéressant qu’elle souligne la singularité des conditions et des conséquences de la création du RND.
1- C’est la première fois, dans l’Histoire des crises entre civils et militaires, que ces derniers redressèrent le FLN, en créant, à partir de sa substance organique, un clone qui le supplantera dans la représentation virtuelle du pouvoir réel.
2- C’est également la première fois dans l’Histoire de l’institution militaire, que l’inféodation d’un parti au cercle des décideurs donna lieu à une opposition entre pôles rivaux autour d’un enjeu de pouvoir lié à la succession du président Liamine Zeroual qui ne faisait plus mystère de son intention d’écourter, très précocement, son mandat.
3- La survivance du FLN, surtout après «son retour gagnant», dans les années 2000, instaura une sorte de bicéphalisme posant un problème constitutionnel irrésolu à ce jour : comment un parti vainqueur aux élections, donc majoritaire, peut-il être lésé de «son droit de gouverner» au profit d’un autre battu et, donc, minoritaire ?… Mise en scène convenue en haut lieu ou non, le fait demeure que cette entorse à la règle constitue un problème supplémentaire qui complique la saisie des logiques du fonctionnement du système politique algérien…
B. M.
Prochainement : «Les partis dirigeants algériens : RND : de l’éradication à la réconciliation et du «patriotisme économique» au néolibéralisme. (7e partie).
Les partis dirigeants algériens face à la révolution (7e partie)
par Badr’Eddine Mili
le 28.03.2019

Au fur et à mesure qu’il prend de l’ampleur et s’installe dans la durée avec une mobilisation et une effervescence politiques et culturelles jamais enregistrées depuis l’indépendance, le mouvement populaire du 22 février réunit tous les éléments constitutifs d’une révolution, dans l’acception, communément admise, qui la définit comme une rupture totale avec l’ordre établi.
Les revendications qu’il met en avant et qu’il précise à chacune de ses démonstrations de masse sont claires. Politiques et non idéologiques, elles ont, déjà, dessiné, à grands traits, la vision que le peuple a de l’Algérie future, à travers les mots d’ordre, d’une pertinence et d’un talent remarquables, brandis par une jeunesse d’élite bardée d’une culture, d’une poésie et d’un sens de la dérision qui ont révélé la richesse et le potentiel d’une personnalité, hier encore, insoupçonnés.
Au cœur de cette bataille de la rédemption du peuple se trouve l’expression de la ferme volonté de bouleverser toutes les constructions politiques et institutionnelles sur lesquelles l’ordre ancien a assis son hégémonie sur la société depuis 1962.
La demande ne souffre aucune ambiguïté : tout en demeurant attaché à l’ Etat national, conquête inaliénable et imprescriptible de la Nation libérée du colonialisme, le mouvement déclare vouloir abolir tous les dispositifs, modes, instruments et procédures d’organisation, de fonctionnement, de transmission et de contrôle du pouvoir d’Etat actuel appelé à être remplacé par un autre dont la source sera le peuple souverain, à l’exclusion de toute autre entité.
Cela signifie qu’à l’avenir plus aucun texte, plus aucun acte de gouvernement, plus aucune conduite intérieure ou extérieure de l’action publique de l’Etat algérien ne portera d’autre signature que celle du peuple qui décidera, en toute liberté, du sens et des valeurs à donner au nouvel Etat aussi bien qu’aux codes et aux lois dont il compte se doter.
Après avoir fait connaître, de la façon la plus manifeste qui soit, sa demande générale de principe, à l’unanimité de ses composantes transgénérationnelles, transpartisanes et transclasses, il passe à une seconde étape, plus complexe et plus délicate que la première, confronté au défi de se structurer et de rédiger un programme politique, autrement plus élaboré et plus détaillé que des slogans d’une portée limitée et éphémère.
C’est là une des conditions de son enracinement dans la société profonde. Il possède plusieurs atouts pour l’assurer : il dispose d’une grande autonomie acquise, depuis longtemps, en marge de l’Algérie officielle, qui le met en position de continuer à détenir l’initiative, à maintenir la pression sur le gouvernement et à se préserver de toute récupération ou soudoiement.
Maîtriser le temps de la réflexion après avoir contrôlé celui de l’action est, maintenant, tributaire de son pouvoir d’investir le chantier colossal de la conceptualisation et de l’écriture de ce que sera le système de l’Algérie nouvelle issue du soulèvement qu’il a déclenché.
Sous peine d’être récupérée et domestiquée, sa victoire résidera, également, dans sa capacité à faire échec aux complots fomentés par les forces contre-révolutionnaires : la bourgeoisie compradore, le cabinet parallèle et le club fermé de l’opposition professionnelle qui n’a pas renoncé à un dialogue par la bande, loin de l’espace public populaire, toujours tenté de partager, sur le dos de la société, les dépouilles promises par le régime finissant.
Ne pas rater ce rendez-vous avec le destin, rester vigilant et veiller à ne pas se le faire confisquer par les réseaux des anciens services de renseignements, par le capitalisme de la mamelle quelles que soient les protections politico-sécuritaires derrière lesquelles il s’abrite, par les partis extrémistes, par les exploiteurs des rancunes du passé et par les démiurges démoniaques, experts en divisions, renvoyer sur les bancs des classes de l’Histoire tous ceux qui avaient douté du génie du peuple et croyaient en avoir euthanasié la grande espérance, continuer à rattacher le combat du mouvement à celui de Novembre, voilà des raisons suffisantes pour y croire et avancer vers l’acquisition d’un Etat de droit, le dénominateur commun des revendications unanimes du peuple.
Les chantiers de rupture ouverts par le mouvement sont, on le voit, nombreux et vont l’occuper, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Parmi eux, il y en a un qui est nodal parce qu’il pose la question de l’avenir des partis dirigeants qui ont servi d’instruments au pouvoir.
Connaîtront-ils le sort du Rassemblement constitutionnel démocratique de Zine El-Abidine Ben Ali dissous par la Révolution tunisienne de 2011 ou bien seront-ils sauvés par le gong d’un thermidor qui sacrifiera l’espoir de tout un peuple sur l’autel des intérêts de classe internes et étrangers ?
Si le mouvement populaire l’emporte, le 28 avril prochain, il serait plus que surprenant que ces partis survivent, dans les formes actuelles, à la contestation générale dont ils sont l’objet.
Le FLN, en premier, sera, en principe, poussé à restituer son sigle au peuple car il serait inimaginable qu’il reçoive un autre sauf-conduit l’autorisant, sous ce parrainage, à activer, de nouveau, dans un système démocratique. Le PPA (Parti du peuple algérien fondé, en 1947, par Messali Hadj) – un sigle tout aussi historique — a vu sa demande d’agrément rejetée au début des années 90.
Le RND sera, également, conduit, logiquement, à s’effacer parce qu’il symbolise le détournement du vote des Algériens et les programmes de répression sociale qui ont paupérisé les classes laborieuses livrées aux oligopoles du capitalisme maffieux. Pour ces motifs que le Mouvement du 22 février estime être, absolument, fondés, ces deux partis échapperont, difficilement, au sas des nouvelles lois de la République et seront obligés de disparaître ou de changer de dénomination.
De toute manière, il appartiendra à la Constitution et à la loi sur les partis de mettre de l’ordre dans une classe politique qui part dans tous les sens.
Le processus, qui devrait débuter le 28 avril prochain, date de l’expiration du 4e mandat du président Bouteflika, dépendra de l’issue de la confrontation, en cours, entre la Révolution et le régime. Des milliers de propositions et même des projets entiers de Constitution circulent sur la Toile et les médias — un signe de vitalité du Mouvement — qui préfigurent la trame du programme à venir. A mon sens, trois scénarios sont envisageables :
1- La Révolution ira jusqu’au bout de sa dynamique et provoquera la chute du régime en gagnant à sa cause le soutien clair et net de l’ANP. La période de transition qui s’ouvrira, alors, pourrait être administrée par une autorité populaire habilitée par un congrès national représentatif des communes, des wilayas, des universités, des associations de femmes, des intellectuels et des syndicats, le recours à la stricte application de la Constitution devenant difficile car présentant le danger de voir le noyau du système perdurer.
2- Si la Constitution est appliquée, stricto sensu, on s’acheminerait vers des élections présidentielles qui reconduiront, automatiquement, les institutions, actuellement, décriées par le peuple. L’option, pour l’une ou l’autre voie, sera, par conséquent, fonction du rapport de forces entre les partisans du changement et les défenseurs du statu quo.
3- Si le rapport de forces ne penche ni d’un côté ni de l’autre, il existerait une solution à mi-chemin entre la Révolution et la Constitution qui combinera, d’autorité, les exigences de l’une et de l’autre. La solution serait mi-constitutionnelle, mi-politique. On ignore de quelle éprouvette sortira cette potion magique ; une éventualité qui risquerait de ne pas satisfaire le Mouvement qui verrait mal se faire voler sa victoire par les arbitres de l’ombre, alias «l’Etat profond». Il n’aura, à ce moment-là, d’autre alternative que de poursuivre son action jusqu’à son terme.
Les prochains jours nous diront, certainement, vers quel scénario l’Algérie s’orientera. Le plus probable —tous «les milieux légalistes» y convergent — sera le recours à l’application de l’article 102 de la Constitution.
Le RND : de l’éradication à la réconciliation nationale et du «patriotisme économique» au néolibéralisme
1- Rappel
Dans les six chapitres publiés, dans ces colonnes, de septembre 2018 à février 2019, l’étude sur les partis dirigeants algériens a reconstitué l’histoire contrastée et controversée du FLN et du RND en s’attardant sur les crises qui les frappèrent ainsi que sur les enjeux qui divisèrent leurs leaders, les déficiences et les échecs des stratégies et des politiques qu’ils ont endossés ou signés, séparément ou ensemble, par délégation du pouvoir d’Etat.
Les lecteurs en auront retenu que la place et le rôle que chacun d’eux tint et joua dans le système pouvoir militaire réel et pouvoir civil virtuel, furent surdimensionnés, en fonction des besoins exprimés par les centres de commandement et, à l’inverse, rabotés et ramenés à une position subalterne, dans des intervalles incidents, quand ils se retrouvèrent désavoués pour déviation ou défaillance dans le contrôle de la société.
Recalés, ils pouvaient espérer, grâce aux mêmes tuteurs, se replacer dans les circuits de la gouvernance avec la prétention, sans cesse renouvelée, de regagner leur statut de partis gouvernant par procuration.
Alors que de 1997 à 2000, ils se différenciaient, en apparence, par leurs bases et leurs programmes, ils mutèrent, au bout de quelques années, et, dans une égale mesure, en un cartel politico-financier support et exécuteur de politiques anti-sociales et anti-nationales ouvertement agressives.
Sous les 4 mandats du président Bouteflika, ils imposèrent une «représentation nationale exclusive» aux institutions législatives et exécutives, et plus rien ne les sépara à part le zèle d’être le premier de cordée à exceller dans l’art de valider et de servir les décisions prises, particulièrement, ces dernières années, par le cabinet parallèle qui joua de leur supposée «concurrence» jusqu’à les inciter à désactiver les défenses immunitaires de l’Etat en attentant à ses organes, ainsi que l’illustra le scandaleux épisode du cadenassage des portes de l’Assemblée populaire nationale.
Jamais dans l’Histoire de l’Algérie indépendante des formations politiques dirigeantes n’ont personnifié et couvert, avec autant d’audace et de perversité, la lente et insidieuse érosion du caractère national, populaire et social de l’Etat.
Ce ne fut pas par hasard que Abdelhak Benhamouda dénonça, avant son assassinat, l’infiltration du gouvernement par des «harkis». Le RND prit une part prépondérante dans cette régression incarnée par tous les gouvernements quil présida.
A sa première nomination par le président Liamine Zeroual, son chef, Ahmed Ouyahia, se fixa un cap d’une rare inflexibilité dans sa tentative de «dénouer» la crise politique et économique qui avait mis le pays à genoux, en 1986, avec l’effondrement des prix du baril de pétrole et, en 1992, du fait de la folie destructrice du terrorisme.
L’orientation qu’il avait retenue différait de celle des gouvernements de Belaïd Abdesselam et Redha Malek qui s’étaient, directement, attaqué aux causes de la banqueroute du pays, l’un par un programme «d’économie de guerre» avorté par les lobbies profrançais, l’autre par la négociation avec les créanciers de l’Algérie, saboté par la violence intégriste et les holdings financiers internationaux.
Le président Liamine Zeroual était, pourtant, venu à la tête de l’Etat avec deux promesses fermes : vaincre le terrorisme et faire redémarrer l’économie dévastée. Il s’attela à réduire, militairement, l’islamisme armé, en s’appuyant sur l’ANP et la résistance populaire et à ramener la paix, en en définissant, sans concessions, les principes et les modalités dans la loi sur la Rahma qui exclut tout compromis avec «les mercenaires, les traîtres et les criminels aux mains tachées de sang». Il comptait, parallèlement, redresser, rapidement, l’économie considérée comme la condition sine qua non du tarissement des sources du terrorisme et de la reconstruction de la cohésion sociale.
Le RND, dont on sait à quelles visées sa création avait obéi, s’appropria ces deux objectifs soumis à la lecture manichéiste des cercles éradicateurs.
Il en assortit l’application, entre 1995 et 1999, de justifications politico-sécuritaires qui s’efforcèrent d’en faire accepter la fatalité puis, brusquement, en prit le contrepied après l’adoption de la loi sur la réconciliation nationale du président Bouteflika à laquelle il apporta son appui et ses suffrages, revirement que le parti transforma en constante qui le fit surfer, à partir de là et, selon les circonstances, d’une vague à l’autre, à propos de plusieurs autres questions.
2- De l’éradication à la réconciliation nationale
Dès sa naissance, le RND bâtit sa personnalité sur l’intransigeance nationale vis-à-vis du terrorisme à l’éradication duquel il invita, à son tour, l’ensemble de ses troupes, moudjahidine, enfants de chouhada, GLD, Patriotes, DEC et familles des victimes du terrorisme.
Le contexte – massacres de Bentalha, Raïs et Had Echakala – était favorable à la soutenance de cette ligne par laquelle il s’employa à apparaître aux yeux de l’opinion comme le défenseur du «novembrisme» contre le FLN «compromis» avec le FIS.
«La famille révolutionnaire» apporta à cette auto-proclamation une caution de poids qui encouragea le parti à briguer le titre de «porte-parole» du courant nationaliste, mis au goût du jour, en plus de celui de poste avancé de l’Etat républicain, des titres contestés par le FLN, inquiet de voir son fonds de commerce usurpé par son «rival».
La composition du premier gouvernement d’Ahmed Ouyahia refléta, fidèlement, cette ligne.
Toutes les figures traînant des carrières compromettantes dans l’encadrement du FIS — Sassi Lamouri, Abdelkader Guechi… — présents dans les gouvernements de Sid-Ahmed Ghozali et Mokdad Sifi, en furent écartées. Ahmed Merani, un des fondateurs, «retourné», du parti dissous et, plus tard, converti aux affaires comme Rabah Kébir, échappa à la purge, une survivance tolérée au ministère des Affaires religieuses pour des raisons tactiques obscures.
Les déclarations du président Bouteflika sur les responsabilités partagées du FIS et de l’ANP dans «la tragédie nationale» refréna les ardeurs éradicatrices du parti et le fit reculer aux législatives de 2002 où il n’obtint que 47 sièges contre les 156 de 1997, un score qui l’obligea à abandonner une ligne qui ne cadrait plus avec l’air du temps.
Evincé de la chefferie du gouvernement à la démission du président Zeroual, en 1999, Ahmed Ouyahia resta six longues années, en réserve, jusqu’à cette élection présidentielle de 2004 qu’il évita, prudemment, attendant de se saisir d’une éventuelle chance de revenir, prêt à servir.
Le RND changea, aussitôt, de braquet et monta dans le train de la réconciliation adoptée au référendum de 2005.
Ahmed Ouyahia, entré dans les grâces d’un président «trahi» par Ali Benflis, son ancien bras droit, reprit du service au gouvernement, en cette année-là, à la tête de la coalition de «l’Alliance présidentielle» aux côtés du MSP et du FLN récupérés par le Palais.
Firent alors leur entrée au gouvernement les principaux dirigeants du MSP – Bouguerra Soltani, El-Hachemi Djaâboub, Amar Ghoul, Mustapha Benbada, Smaïl Mimoun – aux côtés de Abbas, Ghoulamallah, Rahmani, Maghlaoui, Benbouzid, Guidoum, Djaâfar du RND, de Belkhadem, Barkat, Tou, Harroubia, Haïchour, Ziari, Khaldi, Louh, Hmimid, Khoudri, Ould Abbès, Messahel, Benaïssa, Boukerzaza du FLN et des extra-partis Guenaïzia, Zerhouni, Bedjaoui, Ould Kablia, Temmar, Khelil, Belaïz, Medelci, Sellal, Toumi et Djoudi. Econduit et rappelé, plusieurs fois, à la direction du cabinet de la Présidence de la République et au désormais Premier ministère, coordinateur du gouvernement après une énième révision constitutionnelle, Ahmed Ouyahia colla au programme présidentiel au point d’accepter, en 2016, de recevoir Madani Mezrag, le chef de l’ex-AIS, et de le consulter sur cette révision. Le fébrile responsable éradicateur n’était plus qu’un lointain souvenir.
3- Du «patriotisme économique» au néolibéralisme
On doit, en vérité, la notion de «patriotisme économique» à Abdelhak Benhamouda qui en fit l’arme de la résistance anti-intégriste par laquelle l’UGTA avait appelé les travailleurs à barrer la route au SIT (Syndicat islamique des travailleurs) et à sauver leur outil de travail de la déferlante terroriste qui causa à l’économie nationale des pertes astronomiques évaluées à plus de 200 milliards de dollars.
Le RND ne l’utilisa que comme un pis-aller commode au passage en force de ses thèses néolibérales et, de façon tout aussi opportuniste, le gouvernement de Abdelmalek Sellal lui donna, au profit du Patronat, une seconde vie avec la complicité de Ali Haddad et de Abdelmadjid Sidi Saïd, chefs d’orchestre de la tripartite, la désormais base élargie du système Bouteflika.
Dans la réalité, le terrain propice à l’adoption de cette option fut préparé par Ahmed Ouyahia, deux années avant la création du RND, comme indiqué plus haut. Il actualisa tous les remèdes de cheval des gouvernements Abdelhamid Brahimi et Mouloud Hamrouche en leur ajoutant une couche de sadisme anti-social qui fit sa réputation de conscience noire du régime.
Tout y passa : démantèlement du secteur public par la mise en faillite et la privatisation de plus de 500 entreprises nationales et locales viables, mise au chômage de 500 000 travailleurs, pénalisation de l’acte de gestion, emprisonnement des cadres, usage de l’arme fatale de la fiscalité illégale sur les salaires, guerre contre le Cnes de Mohamed Salah Mentouri, démis de son poste pour avoir délivré des diagnostics non complaisants.
Sous le mandat du président Bouteflika, entamé par les catastrophes naturelles de Bab El-Oued et de Boumerdès, la répression des aârouch et l’arrivée aux commandes de l’économie, après un stage à la Banque mondiale, de Abdelatif Benachenhou, Abdelhamid Temmar et Chakib Khelil, figures de proue du néolibéralisme, cette politique fut reconduite dans des proportions plus graves édulcorées par les promesses de réformes de l’ Etat confiées à Issad, Benzaghou et Sbih.
Le gouvernement reçut l’ordre d’ouvrir les banques et le Trésor public aux grands groupes de Haddad, Kouninef, Cevital, Condor, Starlight, Biopharm, Tahkout…
Le reste, tous les Algériens le savent : Sider soldé pour une poignée de dollars au groupe indien Arcelor Mittal, la téléphonie mobile, gracieusement offerte à Orascom, exonérée d’impôts et autorisée à exporter ses dividendes sans limites, l’autoroute Est-Ouest ouverte à la grande corruption, les entreprises de Dick Chesney invitées à prendre part à la curée, à partir de BRC, un de ses écrans, et Renault supplié de s’installer dans le pays avec un marché local garanti, prépayé par l’administration algérienne et interdit de concurrencer, à l’exportation, sa succursale du Maroc. Ce train de «réformes» antinationales et antisociales atteindra son pic avec les scandales de Sonatrach I et II et faillit ruiner le pays lorsque le président Bouteflika promulgua la loi de Chakib Khelil cédant, sur un plateau d’argent, tous les gisements de pétrole et de gaz algériens aux majors américains, et pour couronner le tout, le financement non conventionnel désastreux de l’économie. Total de la note : 1 000 milliards de dollars détournés vers les multinationales et leurs sous-traitants locaux. Les gouvernements d’Ahmed Ouyahia et donc du RND ont été les principaux metteurs en musique de cette partition surréaliste qui priva le peuple du bénéfice de ses ressources. L’entreprise de dépeçage de l’économie nationale aurait été pire — mais y a-t-il pire que le pire ? — si le triumvirat gouvernement, syndicat et patronat avait réussi à faire passer le pacte public-privé qui aurait balisé à Ahmed Ouyahia la voie de la présidence de la République, en brûlant la politesse à la fratrie des Bouteflika qui tenait à conserver la haute main sur la gestion de la rente. Et les élites ? Où étaient-elles pendant tout ce temps-là ?
Le président Abdelaziz Bouteflika qui consomma, en vingt ans, huit chefs de gouvernement et Premiers ministres, 600 ministres et dix fois plus de walis, de secrétaires généraux, de diplomates, de responsables des corps de sécurité, lamina, à la suite de l’hécatombe terroriste, des centaines de cadres de grande valeur poussés à l’exil ou morts dans l’oubli, leur préférant les sous-produits de l’encanaillement du capitalisme d’Etat et de l’argent sale, le nouveau compagnonnage sous l’égide duquel devait se réaliser «le grandiose projet de l’Algérie de la Fierté et de la Dignité», un bateau ivre qui finit par se fracasser sur les vagues impétueuses du Mouvement populaire du 22 février…
B. E. M.
Prochainement : «Les partis dirigeants algériens» – Le FLN de 1999 à 2019 : l’échec d’une réhabilitation au forceps. (8e partie).
LES PARTIS DIRIGEANTS ALGÉRIENS
Le FLN de 1999 à 2019 : l’échec d’une réhabilitation au forceps (8e partie)
par Badr’Eddine Mili
le 28.04.2019
A la fin de cette année 1998, le parti du FLN se relevait, péniblement, de la scission qui le frappa, de plein fouet, une année plus tôt. Tous les signaux de son tableau de bord avaient viré au rouge : la plupart de ses cadres et une bonne partie de sa base avaient été aspirés par le RND. Les soutiens dont il bénéficiait auprès du pouvoir réel lui furent retirés et ses réservoirs traditionnels au sein de l’Administration s’étaient taris.
Associée à des scores électoraux défavorables, cette mise en quarantaine l’avait désespéré d’une possible résurrection dont il voyait très mal d’où elle surviendrait.
La démission du Président Liamine Zeroual et l’entrée en lice de Abdelaziz Bouteflika le réveillèrent, brutalement, de sa prostration.
L’occasion était trop belle pour être ratée. Il se souvint avoir été le parti de l’ancien ministre des Affaires étrangères bien qu’il l’ait exclu, en 1980, de son Comité central. Il voulait, malgré tout, y croire en s’accrochant à l’espoir que représentait la nomination, à la direction de campagne du candidat, de Ali Benflis, un de ses rares anciens ministres à lui être resté fidèle. Il lui déclara, aussitôt, son allégeance, en attendant une réaction favorable.
Son retour «gagnant» lui parut dépendre d’une seule probabilité : que s’opère une jonction miraculeuse entre son impatience à prendre sa revanche contre les auteurs de sa descente aux enfers et une meilleure disposition, à son égard, du futur Président dont il connaissait les analyses sur la crise de 1991 et les réserves sur le RND qu’il avait réprouvé en raison de «ses liens» avec les services de renseignements.
1- Les enjeux d’un retour «gagnant»
Malgré son ressentiment, Bouteflika, Président, avait besoin du FLN en prévision d’un face-à-face avec l’armée qu’il savait inéluctable, à une échéance plus ou moins lointaine. Il lui fallait avoir sous la main un appareil politique en mesure, le moment venu, de lui prêter main-forte, à la condition qu’il fut réhabilité et domestiqué.
Le FLN n’était pas au mieux de sa forme et devait être remis en état, au plus vite. Aussi, la première tâche qu’il s’assigna fut de stopper l’hémorragie qui l’avait vidée de sa substance. Il en ouvrit les portes aux membres des comités de soutien qui animèrent sa campagne sous la houlette de Amar Saïdani, un syndicaliste qui fera, bientôt, parler de lui.
Comme il savait bien y faire pour arriver à ses fins, il nomma Mohamed Cherif Messaâdia à la présidence du Conseil de la Nation en remplacement de Bachir Boumaza et porta au secrétariat général du Comité central, son ancien directeur de cabinet à la Présidence, Ali Benflis, après l’avoir nommé en août 2000, suite à la démission d’Ahmed Benbitour, à la charge de la chefferie d’un gouvernement où il fit entrer de nouvelles figures : Karim Younès, Abdelmadjid Attar, Zineddine Youbi, Boutheïna Cheriet, Fatiha Mentouri et Abdelkader Sellat qui siégèrent aux côtés de ses fidèles : Noureddine Yazid Zerhouni, Abdelaziz Belkhadem, Abdelatif Benachenhou, Chakib Khelil, Mourad Medelci, Djamel Ould Abbas, Tayeb Belaïz, Abdelkader Messahel, Tayeb Louh, Dahou Ould Kablia recrutés dans sa région d’origine comme ses conseillers Abdelatif Rahal et Boualem Bessaïeh.
Les choses, ainsi agencées, se présentèrent pour le parti du FLN, sous de meilleures auspices. Mises en phase avec les intentions déclarées du nouveau Président, elles débouchèrent sur la modulation progressive des rapports de force entre le FLN et le RND réinsérés, en compagnie du MSP, dans la même Alliance, en service, du temps de l’ex-Président Zeroual.
Le plan d’attaque sembla avoir été, parfaitement, mis au point. Le Président tenait, enfin, le volant qui allait exécuter une feuille de route réduite à un seul point : entamer, mieux armé, une longue guerre d’usure contre l’institution militaire, le FLN ayant regagné son ancien rang de leader à la faveur des élections législatives de 2002, qui déclassèrent le RND.
Dans cette projection qu’il avait assez habilement étudié, du point de vue tactique, une seule chose lui manqua : une bonne connaissance de la psychologie des hommes qui l’entouraient. A défaut d’avoir fait montre de cette qualité, Bouteflika vit s’écrouler, à ses pieds, le laborieux échafaudage qu’il crut avoir réussi à monter. Le parti lui fit faux bond en présentant contre lui, Ali Benflis, hier encore, son bras droit, à une présidentielle censée avoir été préparée pour déboucher sur un second mandat qui coulait de source.
On sut que le parti avait agi, ainsi, à «l’invitation» du général de corps d’armée, chef d’Etat-major de l’ANP, Mohamed Lamari, opposé à la réélection d’un Président qui ne dut son repêchage de dernière minute qu’à la caution du général Mohamed Mediène et à «la justice de la nuit» qui invalida l’investiture accordée par le parti à son candidat.
Cette première manche qui opposa la Présidence à l’ANP, pour le contrôle d’un parti qui hésitait entre deux tutelles, fut sanctionnée par une égalité parfaite. En dépit de son habilité tactique, le Président n’était pas parvenu à faire admettre totalement son autorité au sein du parti, et l’ANP, divisée au sommet, échoua à remettre sous sa coupe une formation qu’elle avait, pourtant, fait imploser et qui, en principe, était revenue sous les feux de la rampe, pour se venger d’elle avec l’aide intéressée d’un Président ambitieux et retors.
2- De la récupération au virement à droite
L’alerte avait été chaude et les leçons, immédiatement, tirées : il n’était plus question de gérer le FLN, à distance, le Président devait s’y investir, entièrement, et en être le chef, en titre, afin de prévenir toute nouvelle tentative de sédition.
N’étant pas à une violation près, de ses statuts, le parti destitua Ali Benflis, à son congrès de 2005, créa le poste de «président d’honneur» taillé à la mesure de Bouteflika et élit au secrétariat général Abdelaziz Belkhadem — confirmé au 9e congrès de 2010 — avant de sombrer dans une crise, à rebondissements, éclaté en plusieurs factions — redresseurs, frondeurs,… — regroupées autour de Abderrahmane Belayat, Salah Goudjil et Abdelkrim Abada.
L’activisme de ces tendances, l’une fidèle à la défunte ligne qui rêvait de reconstituer le parti monocratique d’avant 1988, et l’autre, restes des «réformateurs» qui couraient, toujours, après «le changement du système de l’intérieur» ne dura que le temps du leurre, submergé par une éruption qui amenait à la surface du parti les meneurs des oligopoles auxquels le Président promit le pouvoir réel sous la bannière de «la réconciliation nationale».
Ce fut en tablant sur l’attraction de ce thème-bateau que Abdelaziz Bouteflika gagna le ralliement des classes compradores mises en ordre de bataille par les gourous du néolibéralisme installés à la Présidence de la République.
Abdelaziz Belkhadem, venu du barbéfélinisme, avait tout du profil idéal du dirigeant capable de greffer à ces classes les informels de l’islamisme et de les hisser, ensemble, à la direction du parti. Il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour envoyer au Comité central, au Bureau politique puis au Parlement – présidé, successivement, par Amar Saïdani et Abdelaziz Ziari — des fournées entières de milliardaires qui ne se firent pas prier pour voter, au profit du cartel, les projets de lois que le gouvernement, majoritairement, FLN, lui soumit entre 2006 et 2008, en attendant de souscrire aux amendements constitutionnels déverrouillant la limitation du nombre des mandats présidentiels.
Aucun des gouvernements nommés par Bouteflika, de Hamdani à Belkhadem, plusieurs fois remaniés et encadrés, durant plus de dix années, par les hommes inamovibles du Président, excepté, peut-être, celui d’Ahmed Ouyahia, ne dérogea à la règle : ils n’avaient rien fait d’autre qu’appliquer, sans réserves ni modifications, les programmes que le cabinet présidentiel leur transmettait.
Seuls le chef de l’Etat et son staff, familiers du G8, du FMI, de la Banque mondiale, de Davos et de Crans-Montana, en étaient l’âme.
Le parti et son pendant, le Parlement, sous signataire, n’étaient là que pour relayer les consignes et mailler la société à travers leurs réseaux centraux et locaux, les rouages de la machine électorale garante de la prolongation indéfinie du pouvoir au nom de «la stabilité et de la sécurité».
Avant d’être limogé, en 2013, puis banni des structures de l’Etat et du parti, surpris en train de louvoyer, en vue de la présidentielle de 2014, Abdelaziz Belkhadem s’acquitta de cette tâche, sans trop de difficultés, face à une opposition anesthésiée et à des frondes internes contenues.
3- La machine de guerre
L’ère Saïdani – le 11e secrétaire général du Front, intronisé, sur ordre, à la 6e session du Comité central de septembre 2013 – pouvait débuter sur les chapeaux de roues, le parti ne se cachant plus d’être un parti de droite, totalement, domestiqué par le cercle présidentiel et acquis à son obstination à en découdre avec une partie de l’Armée.
Dans une atmosphère générale, particulièrement, sulfureuse, le parti passa à l’exécution du second volet de son cahier des charges préparé de longue date : déclencher l’opération de torpillage du DRS et de son chef.
«L’urgente nécessité d’instaurer un Etat civil» fut l’habillage politique donné à cette offensive lancée à la veille de la préparation du 4e mandat.
La hache de guerre entre «militants politiques» et «militants en uniforme» fut, de nouveau, déterrée, cette fois-ci dans le but d’imposer, par la force, la Présidence à vie.
Le chef du DRS écarté, plus aucun obstacle ne subsista sur la voie du «mandat de trop».
De septembre 2013 à octobre 2016, Amar Saïdani s’occupa à faire du FLN «la 1re force politique du pays», avec, dans le viseur, Ahmed Ouyahia le directeur de cabinet à la Présidence, potentiel candidat à la succession, à éliminer au plus tôt de la course avant toute surprise, la santé du Président déclinant à vue d’œil.
4- La descente aux enfers
Le mandat à blanc fut confisqué par le cabinet parallèle sur lequel régna, sans partage, Saïd Bouteflika, l’architecte de la privatisation de l’Etat.
Le FLN obligé, à chaque remaniement, d’intégrer des ministres au Comité central sans y avoir milité, n’était plus qu’un fourre-tout à la merci d’une faune impliquée dans d’innombrables affaires de corruption.
La fin de mission signifiée à Amar Saïdani, en octobre 2016, donna lieu au parachutage de Djamel Ould Abbès instruit de vendre le projet de 5e mandat en le distillant, par doses homéopathiques, sans faire de vagues, un changement d’attelage qui coïncida avec le débarquement de Abdelmalek Sellal éclaboussé par le scandale de Panama Papers que son successeur, Abdelmadjid Tebboune utilisa, pensant son heure venue, comme d’une tête de bélier pour enfoncer la forteresse du cartel.
La contre-attaque du FCE et de l’UGTA qui s’étaient, déjà, projetés dans l’après-Bouteflika, le fit remplacer par Ahmed Ouyahia, le secret allié qui leur consentit le pacte de partenariat public-privé, en contrepartie de leur soutien à sa candidature à la succession.
Forcé par le cabinet parallèle de se rétracter, Ahmed Ouyahia dut battre en retraite et c’est en arrière-plan de ces luttes sourdes que des voix commencèrent à exprimer leurs doutes sur la faisabilité de ce qui apparaissait, de plus en plus, comme une entreprise aventureuse.
Le président de l’Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, comptabilisé dans le camp des démobilisés, en fera les frais, déstabilisé par une opération-commando menée contre lui par les députés du FLN et du RND.
Son bureau cadenassé, il sera chassé du palais Zighoud-Youcef, par Mouad Bouchareb, son successeur illégitime.
Après cette voie de fait, la coalition euphorique des soutiens du 5e mandat se prit à «rêver» que plus aucune force ne pourra contrarier son incroyable défi à la raison, n’ayant inscrit sur aucune de ses tablettes la réaction d’un peuple gagné par une saine colère.
La bataille de la dignité engagée, le 22 février 2019, par la nation tout entière, se transforma en une révolution qui emporta Abdelaziz Bouteflika. Le FLN, un de ses symboles, fut, dès le premier jour de l’insurrection, mis en demeure de restituer son sigle à l’Histoire. Ce verdict signa l’échec, sans appel, de la réhabilitation du parti, entreprise, au forceps, par un Président qui refusa de regarder la réalité en face et de lire, à l’endroit, la véritable Histoire d’une formation qui fut, à l’origine, plus un mouvement national multipartite qu’une organisation politique au sens strict du terme.
5- Quel avenir ?
L’avenir du FLN est, en vérité, en train de s’écrire au passé. Le drame qu’il vit, aujourd’hui, est contenu dans les avatars et les ratés qu’il cumula avant et après l’indépendance.
La présente étude s’en est faite largement l’écho en le rattachant à son péché originel : le conflit qui mit aux prises, dès 1957, son noyau civil fondateur et ses excroissances militaires, prolongé, après l’indépendance, par les divergences sur la question de la construction de l’Etat, à chaque fois, réglée par la force des armes. On a vu comment le FLN évolua de la synthèse de la Soummam au schisme de Tripoli, du gouvernement de l’Etat par le parti au gouvernement du parti par l’Etat, du parti-Etat au multipartisme et, enfin, de la scission à la crise générale dans laquelle il s’est embourbé, sous l’ère Bouteflika, sans espoir d’en sortir. Il est en train de payer, aujourd’hui, au prix fort, le rôle de paravent consentant qu’il a, toujours, tenu, dans une dépendance permanente vis-à-vis de l’autorité «d’en haut».
De l’état de décomposition très avancé dans lequel ses parrainages successifs et ses différentes ailes concurrentes l’ont plongé, aucune force sociale, aucun groupe d’individus, aussi géniaux et aussi sincères soient-ils, ne pourront le tirer parce que :
– il a perdu son identité idéologique ;
– il se coupa de ses racines populaires et des intelligentsias qui lui avaient insufflé son esprit et sa praxis d’antan ;
– il plia face au diktat des forces oligopolistiques anti-nationales et anti-sociales ;
– il viola les règles statutaires les plus élémentaires de son fonctionnement et recourut aux expédients les plus violents et les plus immoraux pour imposer les vues de ses usurpateurs ;
– il couvrit et entretint le culte de la personnalité, sans limites, de l’ex-Président ;
– il se transforma en annexe des centres de blanchiment de la corruption qui sévissait dans ses rangs.
Pour toutes ces raisons, le sort du FLN qui n’est pas disjoint de celui de ses «compagnons de route» TAJ et MPA (*) semble scellé irrémédiablement. Le peuple algérien estime que la décision la plus sensée que ses dirigeants seraient inspirés de prendre est de changer de dénomination et d’explorer de nouvelles voies d’organisation et d’action allant dans le sens de ce que la Révolution, en cours, construira comme nouveau régime.
Il va de soi que celui-ci sera défini par la nouvelle Constitution et les nouvelles lois qui mettront, une bonne fois pour toutes, à l’abri de l’exploitation partisane à des fins politiques, l’ensemble des ancrages idéologiques, religieux et identitaires de la nation.
La classe politique qui émergera du Mouvement du 22 février sera composée de partis qui défendront des programmes d’inspiration politique et économique et non religieuse ou identitaire.
Aujourd’hui, encore monolithique, pour des raisons évidentes, ce mouvement se décantera, forcément, et sera amené à donner naissance à des partis appelés à solliciter les suffrages des citoyens et, par conséquent, à gouverner sur la base de programmes de développement démocratiquement approuvés.
L’Algérie entrera dans une autre Histoire, une Histoire décidée, comme en 1954, par un peuple souverain et libre…
B. E. M.
* Ces deux partis ont été utilisés par le régime comme auxiliaires et non comme formations dirigeantes. Pour plus d’informations à leur sujet, les lecteurs sont invités à se reporter aux passages qui leur furent consacrés dans nos précédents essais.
prochainement : les partis dirigeants algériens : Inconséquences et limites d’une gouvernance sous tutelle. (9e et dernière partie).
LES PARTIS DIRIGEANTS ALGÉRIENS
Les limites historiques d’une gouvernance sous tutelle (9e partie et fin)
par Badr’Eddine Mili
le 30.05.2019

Arrivée, donc, à son terme, la présente étude sur le statut et les fonctions affectés aux partis dirigeants algériens dans la structure du gouvernement de l’Etat s’était, dès son introduction, fixé pour but, d’identifier et de reconstituer les véritables acteurs et processus de production de la décision politique et de cerner la part de réalité et la part de fiction du pouvoir dont ces formations sont supposées avoir été ou être détentrices sous l’autorité de l’institution militaire ou non.
L’analyse des parcours et des relations du FLN avec l’ALN puis avec l’ANP, menée sur une période de 65 années, a montré, en réponse à l’hypothèse de travail posée au départ, que la Révolution et l’Etat se sont, bel et bien, organisés et construits, dans le contexte d’une suite de luttes que «les militants civils» et «les militants en uniforme» de l’un et des autres se sont livrées de façon ininterrompue.
Il a, en même temps, été établi, en remontant le cours des décantations dans le mouvement national indépendantiste, que ces luttes portèrent la marque indélébile de la scission entre les légalistes du MTLD et les révolutionnaires de l’OS sur les voies et les moyens de libérer le pays du colonialisme.
Causes et conséquences de l’ascendant pris par l’armée sur le FLN
Ce n’est qu’après que le FLN se fut constitué en rassemblement des forces acquises à l’engagement militaire que ces luttes s’exacerbèrent sous l’effet de l’élargissement de la base sociale et politique de la Révolution posant le problème de savoir, face à la multiplication des prétendants à sa direction, quelle était la force la plus prédisposée à en assurer le commandement.
La paysannerie, principal réservoir de recrutement de l’ALN, fit, alors, valoir son leadership en arguant de sa position de classe qui a, le plus longtemps, résisté à la conquête coloniale et payé le plus lourd tribut à l’occupation, écartant de toute responsabilité centrale ses « compagnons de route » soumis, à partir de 1959, à un examen probatoire perpétuel.
L’ascendant pris par l’ALN sur les « militants civils » aussi bien fondateurs que ralliés, créera, à l’intérieur du mouvement insurrectionnel, un rapport de forces irréversible qui investira l’Armée dans le rôle de gardien de la Révolution et, après l’indépendance, de tuteur de l’Etat qu’elle dirigera, directement ou par délégation, après en avoir jeté les fondations, le dotant, à chaque étape de son développement, de référents idéologiques et politiques conformes à sa conception messianique du Pouvoir.
Attachées, ainsi qu’on l’a vu, à l’esprit de l’OS plus qu’à celui du FLN, l’ALN et l’ANP ont, constamment, tenu le Front, en suspicion, à cause de la disparité sociale et politique des ajouts agrégés à la souche irrédentiste du PPA-MTLD.
Aussi, le statut et les fonctions qui lui furent assignés dans les régimes post- indépendance ne devaient, en aucun cas, déborder des limites d’un appareil d’approbation et d’ampliation des directives politiques arrêtées par les décideurs de l’Armée.
Trois exceptions à la règle
La subordination totale du FLN à l’Armée ne fut pas facile à obtenir. Avant de devenir la règle du gouvernement de l’Etat, elle transita par plusieurs crises au cours desquelles le parti se révolta contre une tutelle jugée usurpatrice et s’attaqua, frontalement, à elle, à trois reprises, dans le même esprit que la résistance qu’il opposa à l’EMG, à travers le GPRA, avant et pendant le congrès de Tripoli.
• La première :
Après qu’une partie de sa direction eut conclu une alliance avec l’Armée, le FLN travailla, entre 1962 et 1965, à mettre en avant les militants survivants du PPA-MTLD autour du projet d’édification d’un Etat socialiste, en association avec la gauche marxiste, un objectif qui, de son point de vue, lui aurait permis, s’il avait été atteint, de récupérer le pouvoir réel, porté qu’il était par une dynamique internationale favorable.
Mais, organiquement, saigné par les purges et politiquement, miné par les insuccès d’une expérience socialiste qui n’avait pas pris, il échoua à s’émanciper d’un «Pouvoir révolutionnaire» qui n’eut, après le 19 juin 1965, aucune peine à l’évider de ce qui lui restait de substance et à le rabaisser au niveau d’un appendice administré par l’Etat.
• La deuxième :
Trente années, plus tard, en 1992, Abdelhamid Mehri adepte d’une démocratie sans les chars, entreprit, de nouveau, de sortir le FLN de la sphère de contrôle de l’Armée, en scellant à San’t Egidio, avec le FIS et le FFS, un pacte assimilé par les militaires à une trahison.
Redressé par un «coup d’Etat scientifique» le parti subira, en retour, une scission dont il ne se remettra, difficilement, que vingt ans plus tard.
• La troisième :
En prenant le FLN, sous sa protection, pour le réhabiliter, à des fins intéressées, alors qu’il le vouait aux gémonies pour le bannissement qu’il encourut, de son fait, Abdelaziz Bouteflika l’enrôla dans sa guerre contre l’Armée au nom de «l’Etat civil».
Alternant alliances tactiques et divorces fracassants, le Président du FLN parvint à diviser l’institution militaire en dressant, en 2004, le DRS contre l’état-major et, en 2013, le second contre le premier. La tentative d’instaurer un «Etat civil» avorta, comme les précédentes, au moment où tout était prêt pour entériner le 5e mandat monté par le cabinet parallèle.
La machine des tenants jusqu’aux-boutistes d’une option des plus improbables s’emballa et s’écrasa contre un mur que nul ne vit venir. Le peuple, acteur, longtemps ignoré, fit irruption sur la scène, le 22 février 2019, et rebattit toutes les cartes.
En cherchant à faire la part des déterminants qui dévaluèrent le FLN et privilégièrent l’Armée dans la course à la conquête et à la conservation du pouvoir, dans les deux périodes pré et postindépendance, il est apparu que plusieurs facteurs ont convergé pour favoriser la tendance à la disqualification du parti et, concurremment, à la consécration des militaires à la tête du pays avec, toutefois, faut-il le relever, l’émergence, en des conjonctures particulières, d’un équilibre fragile et inconstant entre les deux.
La disqualification du FLN
Le FLN s’est rendu à la fatalité de son déclassement au sein de la hiérarchie dirigeante, avant et après 1962, sous le coup d’une série d’évènements et de décisions, les uns indépendants de sa volonté, les autres relevant de sa responsabilité propre.
1- La distanciation qu’il observa par rapport à l’action militaire, aux premières années de la lutte armée, en se confinant dans l’exécution de tâches doctrinales, administratives et diplomatiques, le priva des moyens d’influer sur le terrain opérationnel où se gagnaient les dividendes politiques les plus qualifiants.
La décision prise par le CCE de quitter le pays, en pleine bataille d’Alger, eut, à cet égard, des conséquences négatives, en ce sens qu’elle rompit la chaîne du commandement et accéléra l’insubordination latente des wilayas vis-à-vis de la Direction civile.
2- L’intégration, lors du congrès de la Soummam, des centralistes, des udmistes et des ulémistes, au CCE et au CNRA, sur des positions surclassant celles attribuées aux pionniers de Novembre, provoqua des réactions de frustration à l’origine de la remise en cause des mesures adoptées, même si, dans l’absolu, elle procédait de l’intérêt qu’il y avait à fédérer, institutionnellement, les forces de la Nation autour de l’objectif prioritaire de l’indépendance.
3- Sa désertion, en 1962, par ses «alliés» qui, poussés vers la sortie, choisirent de réactiver leurs partis d’avant 1954, le déposséda de militants de valeur qui auraient pu, s’ils avaient continué à y émarger, contribuer à le maintenir en condition, grâce à leur compétence et à leur aptitude à mobiliser.
Ce manque à gagner qui prolongea les pratiques réductrices dont furent victimes les élites, avant l’indépendance, fut aggravé lorsqu’il leur appliqua, dans les années 80, l’article 120 interdisant aux non- militants l’accès aux fonctions supérieures de l’Etat.
4- Cependant, les deux coups mortels qui le mirent hors course, il se les porta, lui-même :
– d’abord, en sabordant, en 1962, ce qui restait de sa Direction historique emportée par la spirale des ambitions personnelles, le sectarisme politique et les réflexes régionalistes supposés, pourtant, avoir été abolis par la Révolution ;
– ensuite, en virant de bord, détourné de ses fondamentaux par l’invasion des clientèles corrompues secrétées par plusieurs règnes dont celui du Président Bouteflika qui le métamorphosèrent en une masse informe utilisée par les têtes de ponts de l’affairisme pour s’engouffrer dans les centres de commandement de l’Etat.
La consécration de l’armée
L’armée algérienne a, souvent, été présentée par certains partis et médias locaux ainsi que par des puissances étrangères et les propagandistes du « qui tue qui ? » sous les traits « d’une armée putschiste, faiseuse de Présidents et répressive ».
L’Armée ne saurait, naturellement, être réduite à ces clichés, quelle qu’aient pu être son comportement et ses erreurs passés.
Elle peut être tenue pour responsable de certains tournants pris par l’Histoire de l’Algérie sur laquelle elle laissa de profondes empreintes mais il serait très difficile de nier qu’elle fut et reste une Armée patriotique d’extraction populaire, la colonne vertébrale de l’Etat national républicain sans laquelle le pays aurait été livré à toutes sortes d’aventures et de convoitises intérieures et extérieures.
Elle surclassa le FLN parce que :
1- Pendant la Révolution armée, elle avait été, contrairement à lui, au contact direct avec le terrain qu’elle apprit à maîtriser, ce qu’elle démontra lors de l’offensive du Nord Constantinois d’août 1955.
La guerre de guerilla qu’elle y mena s’est avérée, néanmoins, insuffisante à forcer la décision, faute d’armement et d’expériences d’un niveau égal à celui des troupes françaises.
La levée, aux frontières, d’une Armée puissamment équipée et formée aux techniques de la guerre moderne, rectifia le déséquilibre et dota la Révolution d’une institution qui voulait avoir son mot à dire sur l’avenir de l’Algérie indépendante.
2- Soudée autour d’un état-major commandé par le colonel Houari Boumediène, elle mit, rapidement, un terme au développement du wilayisme accusé de «congoliser» l’Algérie et fit exploser le FLN au congrès de Tripoli.
3-La parenthèse benbelliste du «parti d’avant-garde» fermée, le Conseil de la Révolution s’attela à bâtir, au pas de charge, un Etat central fort.
Le pari fut gagné avec, à l’intérieur, l’obtention d’une relative cohésion sociale et, à l’extérieur, la reconnaissance internationale, entaché, cependant, par la série de crises politiques et économiques qui précédèrent et suivirent le décès du Président Boumediène.
4- Le rapport dominant entretenu par l’Armée avec le pouvoir n’a cependant pas été linéaire, car bien qu’elle ait joué un rôle prépondérant dans la désignation des Directions politiques de l’Etat, elle n’en a pas moins été obligée, en des périodes sensibles, d’y associer le FLN, puis le RND, en leur déléguant des prérogatives exécutives.
Les équilibres entre le FLN, le RND et l’armée dans la répartition des pouvoirs
Un décompte statistique, valable pour la période 1962-2019, rappelle que les Présidents issus directement de l’armée furent au nombre de trois : Houari Boumediène, Chadli Bendjedid et Liamine Zeroual et que ceux choisis parmi les civils furent d’un nombre égal : Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf et Abdelaziz Bouteflika.
Les militaires nommés, à partir de 1979, à la chefferie du gouvernement furent : Mohamed Benahmed Abdelghani, Abdelhamid Brahimi, Kasdi Merbah et Mouloud Hamrouche, les trois premiers, membres du Bureau politique du FLN, après 1979, et le quatrième, du Comité central, tandis que les civils désignés à ce poste furent : Redha Malek, Belaïd Abdeslam, Mokdad Sifi, Sid Ahmed Ghozali, Ahmed Ouyahia, Smaïl Hamdani, Ahmed Benbitour, Ali Benflis, Abdelaziz Belkhadem, Abdelmalek Sellal, Abdelmadjid Tebboune et Noureddine Bedoui, deux, membres du FLN historique, deux, Secrétaires généraux du parti, un, du RND et le reste sans étiquette.
Ces chiffres renseignent sur l’existence de ces équilibres que l’Armée concéda, en certaines périodes, sans que l’on sache, avec exactitude, les mobiles réels qui l’y poussèrent.
Il convient, à cet égard, de souligner que :
1- Ce furent «les militants civils» qui négocièrent les Accords d’Evian et gérèrent, en 1962, de concert avec «les militants en uniforme» les opérations de résorption des séquelles de la guerre et la reconstruction. Ils furent, néanmoins, les seuls à avoir rédigé la Plateforme de la Soummam, le Programme de Tripoli, la Charte d’Alger et la Charte nationale.
2- Sous le mandat du Président Chadli Bendjedid ce fut le FLN qui dirigea l’Exécutif et le Parlement tandis que sous celui du Président Houari Boumediène ce fut une task-force composée de technocrates non apparentés qui supporta la charge de la conception et de la mise en œuvre de la stratégie de développement économique de l’Algérie avant que le Président ne se ravise, à l’apparition d’une opposition à sa droite, et ne responsabilise le FLN en appelant à sa tête Mohamed Salah Yahiaoui et Mohamed Chérif Messaâdia.
Avec le Président Zeroual, c’est le RND qui trusta la direction des institutions à l’échelon national et local, une carte de distribution des rôles révisée par le Président Bouteflika qui donna une seconde vie au FLN en contrepartie d’un embrigadement au service d’une politique à l’opposé des orientations qu’on lui connaissait auparavant.
Par un jeu de bascule, entré dans les mœurs politiques après la scission de l’ex-parti unique , il se trouva, donc, que même nanti d’une majorité électorale, le FLN se verra, pendant plusieurs mandatures, supplanté par le RND et les sans-étiquette, à la tête du gouvernement.
La règle respectée à l’Assemblée populaire nationale était, par contre, de réserver la Présidence, uniquement, au Front, quand celle du Senat devait revenir au RND sauf, une seule fois, en 1997, lorsque le Président Zeroual y nomma Bachir Boumaza, démis, peu après, par le Président Bouteflika.
3- Fonctionnant sur la base des quotas claniques et régionaux, le propre de ce système, parfois monopolisateur, parfois délégataire, est réglé par des codes immuables.
Plusieurs générations de dirigeants se succédèrent à son sommet sans que, pour autant, ces codes aient changé d’un iota …
C’est ainsi, par exemple, que ceux qui ont sacré Chadli Bendjedid Président ne sont pas ceux qui le poussèrent à la démission pas plus que ceux qui firent appel à Abdelaziz Bouteflika n’ont été à l’origine de son départ, les chefs passaient mais les procédés utilisés demeuraient .
La Révolution du 22 février a enrayé ce logiciel qui ne servira, probablement, plus à délivrer les visas du pouvoir dans les conditions qui ont été décrites tout au long de cette étude, laquelle a, finalement, montré que les partis dirigeants ont fonctionné selon les règles d’une gouvernance sous tutelle qu’ils ont accepté d’appliquer, à la lettre, sauf lorsqu’ils ont tenté, sans succès, d’y déroger dans les circonstances spéciales analysées ci-dessus. Ce mode de gouvernement a atteint ses limites historiques et doit, maintenant, laisser place à un autre fondé sur le respect de la liberté de choisir et l’alternance au pouvoir.
La révolution du 22 février : le peuple, l’armée et la nouvelle république
La Révolution du 22 février née de l’élan vital d’un peuple lancé à la reconquête de sa dignité et de son Histoire confisquées, a, en quelques semaines, complètement, bouleversé l’équation du pouvoir d’Etat en défaisant la coalition politico-financière qui l’avait asservi, occupant la scène accompagné par l’Armée nationale populaire, le seul partenaire possible avec lequel il pourrait, à l’exclusion de toute autre partie, nouer une alliance historique qui donnerait naissance à une nouvelle République fidèle à Novembre et à l’Etat national.
Devant une situation extrêmement difficile, l’un et l’autre sont, aujourd’hui, mis dans l’obligation de relever le défi de trouver, ensemble, une solution à la crise constitutionnelle et politique qui secoue le pays en conjuguant leurs forces et en dépassant leurs faiblesses, l’objectif étant de réunir toutes les conditions indispensables au passage vers un régime démocratique qui répondrait aux aspirations de toute la Nation.
Le peuple
Grâce à son pacifisme c’est, désormais, le peuple qui occupe le sommet de la pyramide politique. Il a cessé d’être cette quantité négligeable soumis à la gouvernance sous tutelle où n’étaient concernés que les institutions et les partis du pouvoir d’Etat et, accessoirement, l’opposition. En l’espace de trois mois, sa révolution qui a refusé d’être baptisée des noms de couleurs et des fleurs des «Printemps» arabes et européens, a abattu plusieurs pans de la forteresse du régime finissant, déchu son chef, déclaré ses partis hors-la-loi et envoyé en prison ses intouchables.
Inattendu par ses adversaires qui pensaient l’avoir chloroformé, pour longtemps, le peuple est revenu à la politique avec une force d’une amplitude qui dépasse, de loin, celle de ses précédentes irruptions dans l’Histoire.
L’idée qui voulait que le pouvoir fut conçu, organisé et réparti selon le bon vouloir des forces qui le concentraient entre leurs mains est en train de reculer. C’en est fini de la pièce jouée dans les coulisses d’un théâtre d’ombres où les rôles des personnages s’écrivaient et se distribuaient au gré des caprices du prince régnant et de son cabinet fantôme.
Parallèlement à ces points forts , le mouvement charrie plusieurs faiblesses qui menacent de le handicaper et de réduire sa marge du manœuvre.
Il ne dispose ni d’une organisation ni d’une direction qui le représenteraient auprès de ses interlocuteurs.
Les mots d’ordre qu’il décline, chaque semaine, dans ses marches ne peuvent tenir lieu de programme. Le mouvement est arrivé à un niveau de maturation qui exige la rédaction d’un texte d’orientation qui balise son action. En se dotant d’une structure et d’une charte, il se prémunirait du risque d’infiltration et de détournement par les partis qui tentent de le canaliser en lui faisant endosser leurs programmes..
Un prompt rappel à l’ordre à tous ceux-là lui assureront l’indépendance requise, condition de sa continuité et de son aboutissement.
L’armée
L’armée qui détient, toujours, le pouvoir réel, tout en se déclarant éloignée de la politique, n’est plus ce qu’elle était.
Elle n’a plus rien à voir avec l’armée des années 80 dirigée par les DAF ni avec celle dont la hiérarchie était, outrageusement, dominée par le DRS.
Bien que travaillée, encore, par l’esprit messianique, elle ne compte plus de «militants en uniforme» et ne s’identifie à aucun chef au profil césariste du type de celui incarné, dans le passé, par Houari Boumediène.
Tout en restant un haut lieu de brassage des jeunes Algériens de toutes les conditions et de toutes les régions, à travers le Service national et les Ecoles des cadets de la Nation, elle a fait un grand bond en avant en devenant un corps hautement performant, internationalement apprécié pour sa lutte efficace contre le terrorisme.
A côté de ce titre reconnu par ses homologues étrangères, elle est en train d’en briguer un autre, celui d’entrepreneur actif dans les industries de l’armement, de l’automobile et de l’aéronautique où elle produit une valeur ajoutée qui profite à l’économie nationale.Avec un potentiel aussi riche en compétences scientifiques, techniques et entrepreneuriales, elle a, en principe, de quoi opérer, en son sein, une Révolution culturelle qui la libérerait de sa principale faiblesse, l’autoritarisme, qui la fait encore hésiter et tarder à faciliter l’instauration dans le pays d’une démocratie réelle.
Le peuple est conscient de cette faiblesse mais sait, en même temps, qu’il lui est impossible de s’aliéner l’accompagnement de l’armée dans la réalisation de cette ambition tracée par la proclamation du 1er Novembre 1954, ce pourquoi, il fait tout – par son pacifisme et ses appels au dialogue – pour l’aider à être plus réceptive et à muter ainsi que beaucoup d’autres institutions militaires l’ont fait, avant elles, en Europe, en Asie et en Amérique Latine.
Il contribuera, peut-être, de cette manière, à l’amener à lever cette hypothèque qui l’empêche, jusqu’à aujourd’hui, d’admettre que le pouvoir d’Etat puisse, ultérieurement, prendre de la distance avec elle, une perspective qui lui paraît difficilement envisageable, habité qu’elle est par cette hantise de voir l’Etat, cédé au gouvernement de ses adversaires de toujours, les extrémistes et les minorités agissantes de droite et de gauche qu’elle accuse, régulièrement, de collusion avec les puissance étrangères.
La nouvelle République
La nouvelle République – et non la Seconde ainsi que les «admirateurs» de l’Histoire de France essayent de le suggérer – est une œuvre de longue haleine. Ce n’est pas en quelques mois ni en quelques années qu’elle prendra une forme et revêtira un contenu achevés et satisfaisants. De nombreux préalables politiques, juridiques, institutionnels et culturels nécessaires à sa mise en route doivent être réunis.
Dans l’immédiat, il est indispensable que le mouvement populaire et l’armée rapprochent leurs points de vue et arrivent à donner corps à un compromis qui économiserait au pays des épisodes tragiques dont l’issue prévisible ne serait rien d’autre que l’internationalisation de la crise comme en 1997 où l’ONU avait dépêché à Alger le panel de Mario Soarès venu enquêter sur les massacres de Bentalha et de Raïs.
L’idéal serait que l’un et l’autre acceptent de dégager une formule qui emprunterait, à la fois, à la Constitution ainsi que l’Armée le veut et au dialogue politique ainsi que le souhaite le mouvement.
S’ils s’entendent sur le principe, les choses iront très vite : Dans une transition de courte durée – l’armée en a bien instauré trois par le passé — il sera procédé à la convocation d’une conférence nationale regroupant les délégués élus du mouvement, les représentants des partis de l’opposition, ceux de l’Etat et des élites qui statueront sur le dispositif, les modalités et le calendrier de la transition, en fonction desquels sera installée une commission d’organisation et de surveillance des élections présidentielles qui, de l’assainissement des listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats, sera présente à toutes les stations du processus en l’absence du ministère de l’Intérieur et de toute autre représentation gouvernementale exclus d’office.
La vacance de la présidence de la République comblée, il reviendra au nouveau chef de l’Etat légitimé par le suffrage démocratique d’ouvrir les chantiers de la construction de la nouvelle République qui passent, évidemment, par la révision de la Constitution et de la loi sur les partis, la dissolution du Parlement et l’organisation des élections législatives et locales : un premier pas sur une route qui sera longue mais tellement enthousiasmante pour la jeunesse algérienne qui, sans jeunisme ni complexe d’Œdipe, montrera à la Nation et au monde ce dont elle est capable…
B. E. M.