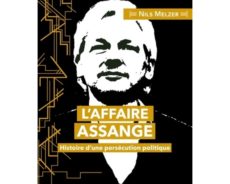Colloque du 6 mai 2019
Source : Res-Publica,
Introduction
Intervention de Jean-Pierre Chevènement, président de la Fondation Res Publica, lors du colloque “L’euro vingt ans après, bilan et perspectives ” du lundi 6 mai 2019.
Mesdames,
Messieurs,
Chers amis,
Je vous souhaite à tous la bienvenue, et d’abord à nos intervenants que nous allons écouter avec beaucoup d’intérêt sur le sujet qui nous réunit : « L’euro, vingt ans après : bilan et perspectives ».
Nous entendrons d’abord M. Jean-Michel Naulot, membre du Conseil scientifique de la Fondation Res Publica, qui a présidé la commission des marchés au sein de l’AMF (Autorité des marchés financiers) de 2003 à 2013.
Il sera suivi de M. Patrick Artus. Nous connaissons ses analyses, nous suivons leur évolution, si tant est qu’on puisse parler d’évolution car elles témoignent d’une certaine constance. Directeur de la Recherche et des Études chez Natixis, M. Patrick Artus a écrit, avec Mme Marie-Paule Virard, Euro, par ici la sortie ? (Fayard, 2017).
Le débat se poursuivra avec M. Jean Pisani-Ferry, professeur associé à Sciences Po, Senior Professor à la Hertie School of Governance de Berlin. On se souvient que M. Pisani-Ferry a été Commissaire général de France Stratégie de 2013 à 2017. Il a écrit Le réveil des démons (Fayard, 2011). La question est de savoir si ces démons vont ressurgir de la boîte…
Sur ce point, l’intervenant suivant ne manquera pas de susciter notre intérêt vigilant. Directeur d’Études à l’EHESS, M. Jacques Sapir est l’auteur d’un livre intitulé Faut-il sortir de l’euro ? (Seuil, 2012).
Enfin nous conclurons avec M. Christian Noyer, Gouverneur honoraire de la Banque de France.
Je rappelle que nous avions consacré plusieurs études [1] et colloques à l’euro et aux questions monétaires : Dès 2009 « L’impact de la crise sur la stabilité de l’Euro » et « Quel système monétaire international pour un monde multipolaire ? ». En 2011 « Quelles solutions pour le système monétaire international ? ». En 2012 « Approches théorique et pratique d’une monnaie commune » et « L’euro monnaie unique peut-il survivre ? » (une question qui se posait en ce début de la crise de la zone euro). En 2014 « La guerre des monnaies ? » et, en 2015, « L’euro est-il soutenable ? Le nouveau test de la Grèce ».
Je donne la parole à Jean-Michel Naulot qui va camper une histoire de la monnaie unique.
Histoire de la monnaie unique
Intervention de Jean-Michel Naulot, membre du collège de l’Autorité des Marchés financiers de 2003 à 2013, auteur de Eviter l’effondrement (Seuil ; 2017), membre du Conseil scientifique de la Fondation Res Publica, lors du colloque “L’euro vingt ans après, bilan et perspectives ” du lundi 6 mai 2019.
Nous pouvons remercier Jean-Pierre Chevènement d’avoir organisé cette rencontre sur l’euro dont le vingtième anniversaire, au début de cette année, n’a pas suscité beaucoup de célébrations. Pas plus que dans cette campagne pour les élections européennes : on ne parle pas de l’euro ! On en parlait beaucoup plus en 2014. C’est à croire que tout le monde a peur de s’approcher de l’euro depuis le fameux débat de 2017…
Je rappellerai brièvement le parcours de l’euro depuis les premières réflexions sur la monnaie unique.
La monnaie unique a deux origines : La première s’ancre dans une théorie économique, la théorie monétariste.
Il est difficile de ne pas évoquer le nom de Robert Mundell, économiste monétariste canadien, très libéral (il le montrera dans les années 1980), qui a été considéré comme le père de l’euro, à la fois parce qu’il a été très proche de la Commission européenne, dont il a même été conseiller pendant des années, et ensuite parce qu’il a reçu le Prix Nobel en 1999 au moment même où la monnaie unique a pris naissance.
Son analyse s’appuyait sur deux piliers :
Le premier était la nécessité affirmée de la flexibilité des facteurs de production, flexibilité des salaires, mobilité de la main d’œuvre et liberté complète de circulation des capitaux.
Le deuxième pilier était l’indépendance absolue de la Banque centrale. Mundell avait le sentiment que cette Banque centrale, du fait même de sa constitution fédérale, pouvait contribuer à faire basculer très vite l’ensemble du système politique vers le fédéralisme.
Avec le recul des années, on peut dire que Robert Mundell a certainement surestimé la flexibilité des facteurs de production, des salaires, de la mobilité de la main d’œuvre, ne serait-ce que pour des questions de langue, de culture. Il a sous-estimé ce qu’on appelle les chocs asymétriques. La flexibilité des salaires devait remédier, dans sa théorie, aux chocs asymétriques. Or les chocs asymétriques, avec des pays aussi différents, sont très nombreux. Et il a surestimé le rôle que pouvait jouer la Banque centrale dans l’aspect institutionnel et politique.
La deuxième origine de la monnaie unique doit être cherchée du côté de la politique.
Au cours de l’été 1969, Georges Pompidou dévalue le franc. Cette dévaluation fait suite aux événements de 1968. Le salaire minimum, dans l’industrie et dans l’agriculture, avait en effet été augmenté de 35 %, ce qui avait contribué à déstabiliser l’économie, alors que les années 1960, en France comme en Allemagne et en Italie, avaient été marquées par une très grande stabilité sur le plan monétaire. Georges Pompidou craignait le retour à l’instabilité monétaire. Dans les travaux de la Conférence de La Haye (sommet de 1969 provoqué à la demande du Président Pompidou) et le rapport Werner qui suivra (8 octobre 1970), il n’est absolument pas question d’un fédéralisme politique ou financier. On n’y voit que la préoccupation de maintenir la stabilité des monnaies, de faciliter les échanges commerciaux et l’idée qu’on pourrait accroître le rôle de l’Europe sur la scène internationale. Mais, à aucun moment, on n’envisage de basculer vers le fédéralisme politique.
Vont suivre une trentaine d’années pendant lesquelles on va essayer de stabiliser les monnaies avec le serpent monétaire puis le Système Monétaire Européen (SME) qui impose, en principe, de ne pas s’éloigner de 2,25 % du cours pivot. Mais pendant qu’en Europe on se préoccupe de stabiliser les monnaies, on adopte sur le plan international le système de flexibilité des changes, avec la décision de Richard Nixon de couper le lien entre le dollar et l’or, le 15 août 1971, et la Conférence de la Jamaïque en 1976.
Donc l’Europe s’attache à stabiliser les monnaies. Mais le bilan de cette expérience est assez controversé. Certains considèrent que c’est un demi-succès. Je serais plutôt de ceux qui considèrent que c’est un demi-échec, si ce n’est un échec. En effet, on observe – et on le mesure mieux avec le recul des années – qu’à chaque fois les modifications de parité se font dans des circonstances dramatiques. Quand apparaissent les premières turbulences, les gouvernements et les gouverneurs de banques centrales interviennent pour essayer de calmer cette tension. Les remaniements monétaires ont donc lieu dans des circonstances souvent assez dramatiques sur le plan financier, avec des hausses de taux d’intérêts qui viennent abîmer la croissance. Cela se termine très mal : en 1992 le système implose. Le Royaume-Uni et l’Italie sortent et on élargit les marges de fluctuation à 15 % (soit au total 30 %), ceci à quelques années de la monnaie unique.
Dans le même temps, sur le plan politique, les années 1983-1992 marquent un tournant majeur.
1983, c’est le tournant de la rigueur en France. 1986, c’est l’Acte unique avec la promesse de la liberté complète de circulation des capitaux. 1988, c’est le comité Delors, constitué de trois experts économiques et des gouverneurs de banques centrales, sous la présidence de Jacques Delors dont on connaît la fibre fédérale et qui avait eu l’habileté de mettre Karl Otto Pöhl dans son groupe de réflexion car la Bundesbank était très réticente sur la monnaie unique.
Ensuite, les choses s’accélèrent. C’est d’abord la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989. Quinze jours après, la décision de réunification de l’Allemagne est prise par le chancelier Kohl sans consultation de ses partenaires. Arrive le fameux sommet européen de Strasbourg, le 9 décembre 1989 au cours duquel il est décidé de convoquer la Conférence inter-gouvernementale (CIG) pour la future monnaie unique. On dira à cette occasion que la France considère qu’elle aura de bonnes chances d’arrimer l’Allemagne à l’Europe de l’Ouest, si ce n’est à elle-même…
Du Comité Delors sont sortis quatre éléments encore très présents aujourd’hui :
– l’indépendance de la Banque centrale, avec l’interdiction stricte de financer les États.
– des règles budgétaires contraignantes.
– la flexibilité des salaires, la mobilité de la main d’œuvre, donc les règles de l’ordolibéralisme allemand. La monnaie allait se faire mais aux conditions de l’Allemagne.
– quatrième élément : le rapport des banquiers centraux recommandait très explicitement de ne pas fixer de date butoir. Malheureusement, au sommet de Maastricht, en 1991, le Président Mitterrand arrivera à convaincre ses partenaires qu’il faut une date butoir et cette date sera janvier 1999.
Une phrase du rapport Delors me paraît être encore d’une grande actualité : « Une union monétaire qui ne s’accompagnerait pas d’une convergence suffisante des politiques économiques aurait peu de chances de s’inscrire dans la durée et pourrait nuire à la communauté ».
Nous entrons ensuite dans les vingt années d’existence de la monnaie unique.
Je découperai cette période en deux sous-périodes séparées par le printemps 2010 qui marque un tournant.
Je mentionne au passage – c’est mon témoignage de banquier qui travaillait à l’époque avec les sociétés du CAC 40 – que pendant trois années, de 1999 à 2002, nous avons vécu avec deux monnaies dans chacun des États de la zone euro : une monnaie pour les transactions financières, les transactions des grandes entreprises, des banques, des institutions financières, avec l’euro, et une monnaie pour les opérations domestiques, avec le franc. Je n’ai pas souvenir qu’un seul instant ceci ait posé problème dans le monde bancaire. Mais peut-être la Banque de France et la Banque centrale européenne veillaient-elles à ce que tout se passe très bien…
Dans cette période qui va jusqu’au printemps 2010, je relèverai trois éléments qui me paraissent très importants :
– appliquant la flexibilité des salaires, l’Allemagne décide en 2003-2004 une dévaluation interne avec les réformes Hartz-Schröder, qui seront suivies des années plus tard par un autre type de dévaluations internes, « imposées » cette fois, comme en Grèce ou en Espagne.
– le deuxième élément, très important, est la fin de la fragmentation des marchés financiers. À partir du moment où il n’y a plus qu’un seul taux d’intérêt de refinancement fixé par la Banque centrale européenne, les investisseurs et même les autorités monétaires – qui s’en félicitent d’ailleurs – considèrent qu’il n’y a plus qu’un marché de la dette publique. Et on a vite fait de considérer qu’une dette publique allemande, italienne, grecque… c’est à peu près la même chose. Le réveil sera brutal en 2009-2010 !
– troisième élément, dès lors qu’il n’y a plus qu’un seul taux, celui-ci ne convient pas forcément à tous les pays de la zone euro. Aujourd’hui encore Mario Draghi répète que sa préoccupation dans la fixation des taux n’est pas tel ou tel pays mais la zone euro. Si, dans les années 2000, le taux d’intérêt bas a bien convenu à la réunification de l’Allemagne, il convenait beaucoup moins bien à l’Espagne qui a vu se développer une énorme bulle financière.
On arrive au printemps 2010, très exactement aux week-ends du 2 et du 9 mai 2010 qui marquent un tournant. Les financiers ont en mémoire ce qui s’est passé pendant ces quelques jours. Alors que tout l’hiver Mme Merkel s’était formellement opposée à toute aide à la Grèce, le 2 mai on décide d’une aide de 110 milliards. Les marchés, au lieu de se calmer, se déchaînent. Arrive le week-end des 8 et 9 mai où, à Bruxelles, les dirigeants européens travaillent sur un pare-feu. Le samedi après-midi on évoque 70 milliards. Mais, le lundi matin à l’aube on annonce que 750 milliards sont mis sur la table, dont le tiers par le FMI ! Ce montant comporte des garanties, de la trésorerie etc. mais le fait que le FMI s’engage pour le tiers n’est pas du meilleur effet pour la zone euro !
Que s’est-il passé ? On a craint un effet de dominos parce que, du fait de la fin de la fragmentation des marchés financiers, les banques françaises, allemandes et beaucoup d’autres avaient acheté de la dette de pays de la zone euro qui n’était pas de la dette domestique. Il fallait vraiment tout faire pour sauver l’euro car le système bancaire européen menaçait d’imploser. On risquait d’assister à des faillites de banques, à l’effondrement du système financier européen.
Je vais résumer la période qui suit en six points qui me paraissent les plus notables :
– d’abord le rôle décisif de la BCE pendant cette période.
La BCE va commencer par acheter un peu de dettes des pays périphériques, sous la mandature de Jean-Claude Trichet puis avec Mario Draghi. Celui-ci aura un discours extrêmement offensif, se disant prêt à tout pour sauver l’euro, « whatever it takes », quels que soient les traités, a-t-on envie d’ajouter. Une politique de prêts sur des durées longues, à taux zéro, permet aux banques d’avoir de la liquidité mais également, ce que l’on dit moins, de pouvoir l’utiliser pour acheter de la dette de leur propre pays. Les banques n’achètent plus de la dette d’autres pays mais de la dette de leur propre pays, ce qui permet de faire baisser les taux en Italie et en Espagne. Cela explique les montants de dettes importants détenus aujourd’hui par les banques commerciales de ces pays.
Dans un deuxième temps, en 2015, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales achètent elles-mêmes de la dette avec une politique absolument inédite de quantitative easing. Patrick Artus compare souvent la situation en zone euro à celle du Japon. Effectivement, on observe une courbe des taux complètement plate autour de zéro % dans un pays comme l’Allemagne par exemple. Tout le monde s’en satisfait.
– les règles budgétaires ont par ailleurs été très fortement renforcées pendant la période 2010-2013. Ces règles permettent une intrusion forte des autorités de Bruxelles dans la politique budgétaire des États, comme le soulignent d’ailleurs de temps en temps les experts de Bercy. Puis le traité budgétaire européen [1] consacre la fameuse règle allemande qui figurait dans la loi fondamentale de 1949 sur l’équilibre budgétaire.
– le troisième élément, qui me paraît très important, n’est jamais signalé. C’est l’existence de clauses d’action collective dans les contrats obligataires. En 2010, à la demande de Mme Merkel, des clauses ont été prévues dans les émissions obligataires de la zone euro qui disposent qu’en cas de risque de faillite d’un pays, on peut réunir les porteurs d’obligations en assemblée générale et décider d’une restructuration de la dette. L’idée est que les épargnants du pays qui a péché doivent payer. Mais comme aujourd’hui, dans tous les pays de la zone euro, la moitié de la dette publique est détenue par les banques commerciales et les banques centrales qui refinancent les banques commerciales, on voit bien par qui serait prise la décision de restructuration de la dette.
– il faut bien entendu signaler la crise des pays périphériques que nous avons vécue, notamment celle de la Grèce qui s’est en principe terminée à l’aube le 13 juillet 2015 dans des conditions dramatiques et qui en réalité n’est pas terminée. En effet, la dette publique grecque est aujourd’hui à 182 % du PIB. On n’a fait que rallonger la dette sur des périodes très longues. Cela évite de dire que les autres pays de la zone euro ont perdu de l’argent.
– autre élément important, les banques commerciales, extrêmement méfiantes, n’achètent toujours pas de dette publique (ou marginalement) d’autres pays de la zone euro. L’autre signe de cette méfiance est le fait que ces banques commerciales, à la différence de ce qui se passait jusqu’en 2010, passent par leur banque centrale pour leurs transactions avec des banques commerciales d’autres pays de la zone euro. En d’autres termes, lors d’une exportation de sidérurgie du Luxembourg vers l’Italie, la transaction passera par la Banque centrale du Luxembourg et par la Banque centrale italienne. Il en résulte des déséquilibres spectaculaires dans le système des paiements européens (Target2). Cela concerne des montants considérables.
Aujourd’hui la Bundesbank a une créance vis-à-vis des pays périphériques de l’ordre de 900 milliards alors que jusqu’en 2008-2010, les soldes quotidiens étaient techniques, de l’ordre de quelques milliards le soir. Une phrase de Jean Pisani-Ferry, dans Le Monde, en 2012, me paraît garder toute son actualité : « L’écheveau d’interdépendances financières au sein de la zone euro se défait à grande vitesse. La menace est proprement existentielle. Quel sens y aurait-il à conserver une monnaie commune dans un contexte de désintégration financière ? ». Il me semble que Patrick Artus ne dit pas des choses très différentes.
– le dernier point, probablement le plus important pour l’avenir, concerne les divergences croissantes que l’on observe au sein de la zone euro et qui sont tout à fait spectaculaires quels que soient les indices que l’on retient, le PIB, le revenu par habitant, la production industrielle, les excédents budgétaires extérieurs etc. Les déséquilibres se creusent. Je n’en citerai qu’un : l’Allemagne, qui a des excédents extrêmement importants depuis des années, rembourse sa dette de manière accélérée. Les derniers chiffres d’Eurostat mentionnent que la dette publique allemande représente 61 % du PIB. En France on est à 99 %. Au début des années 2000 nous étions à égalité, autour de 60 %. Cela a des conséquences sociales très importantes et cela donne à l’Allemagne une position dominante au sein de la zone euro. Il est évident qu’on est plus à l’aise avec 60 % qu’avec 100 % de dette.
En conclusion je mentionnerai trois constats :
– l’euro est aujourd’hui une monnaie très incomplète. Il n’y a pas d’État européen, il n’y a même pas l’amorce d’un gouvernement européen et il n’y a pas de budget européen. Le montant évoqué pour le budget, qui sera discuté après les élections européennes, est de quelques dizaines de milliards, peut-être même 10 ou 20 milliards. J’ai relevé qu’il ne s’agissait pas d’un budget européen mais du budget de l’Union européenne, ce qui en dit long.
– le dialogue franco-allemand est difficile. Mme Kramp-Karrenbauer, qui a succédé à Mme Merkel à la tête de la CDU et qui la remplacera peut-être un jour, a écrit récemment : « Le centralisme européen, l’étatisme européen, la communautarisation des dettes, l’européisation des systèmes de protection sociale et du salaire minimum seraient la mauvaise voie. Le fonctionnement des institutions européennes ne peut revendiquer aucune supériorité morale par rapport avec la coopération avec les gouvernements nationaux. Refonder l’Europe ne se fera pas sans les États-nations. Ce sont eux qui fondent la légitimité démocratique et l’identification dans les peuples ». Nous pouvons partager ce point de vue mais la question est de savoir s’il est vraiment compatible avec la monnaie unique compte tenu du retard qui a déjà été pris.
– troisième constat, le rôle de l’euro sur le plan international est généralement considéré comme un peu décevant. La part de l’euro dans les réserves mondiales est passée de 26 % à 20 % en vingt ans. Des analyses très intéressantes de Patrick Artus sur la manière dont se constituent les réserves mondiales montrent que la marge d’action est assez limitée. La part de l’euro dans les transactions internationales, dans les opérations de change, est passée de 19 % à 15 % (c’est la place qu’occupait le Deutsche Mark à la fin des années 1990).
Tout cela nous renvoie aux questions qui étaient posées en termes d’avertissement dans le rapport Delors. La monnaie unique est-elle durable dans ces conditions ? N’allons-nous pas vers de nouvelles crises ?
Et, surtout, les inégalités qui ont tendance à se creuser ne finiront-elles pas par nuire au « vivre ensemble » au sein de la zone euro ? à moins que ce ne soit déjà commencé.
Je vous remercie.
Jean-Pierre Chevènement
Merci Jean-Michel Naulot.
Après cet exposé remarquablement clair et détaillé, je poserai néanmoins une question concernant le passage à la monnaie unique, qui aurait pu être monnaie commune. Évoquant le comité Delors en 1988-1989, composé des gouverneurs des banques centrales, vous parlez d’une réticence de l’Allemagne vis-à-vis de la monnaie unique. Mais je crois savoir que c’est sous la pression de l’Allemagne que l’hypothèse de la monnaie commune a été écartée. Je me souviens que Pierre Bérégovoy était assez réservé vis-à-vis de l’idée de monnaie unique et prônait la monnaie commune. Je me demande même si les Britanniques n’avaient pas émis à un moment l’idée qu’une monnaie commune serait peut-être plus réaliste que la monnaie unique qui a paru plus simple, « plus élégante », ai-je lu. Mais en définitive c’est elle qui l’a emporté. À la faveur de quelles discussions entre Jacques Delors, Helmut Kohl, François Mitterrand ? Je l’ignore. Ce que je sais, c’est que Pierre Bérégovoy s’est vu imposer la solution et que, à partir du moment où il a été « arbitré », il n’a plus contesté l’arbitrage qui venait du Président et du Chancelier. Comment se fait-il qu’on ait choisi la monnaie unique qui était peut-être plus « élégante » mais infiniment plus difficile parce qu’elle suppose un manque de flexibilité, par conséquent une véritable unité politique qui, nous le savons, ne s’est pas encore produite ? Comment ce glissement s’est-il opéré en 1988-1989 ?
Jean-Michel Naulot
Le Gouverneur aura peut-être l’occasion de préciser les souvenirs. Je crois qu’à l’époque les gouverneurs de banques centrales ont réfléchi à l’idée d’une monnaie commune. Cela rejoignait l’idée qu’il ne fallait surtout pas de date butoir, qu’il fallait une période de transition. Éric Roussel, dans son livre sur François Mitterrand [2], raconte beaucoup de choses intéressantes à ces sujets. Au sommet de Maastricht en 1991, Karl Otto Pöhl était absolument furieux de la position prise par le Chancelier Kohl d’accepter une date butoir. Il me semble que les gouverneurs de banques centrales avaient réfléchi à l’époque à de telles solutions. C’est le passé…
Jean-Pierre Chevènement
C’est une décision capitale car la monnaie commune aurait laissé subsister une certaine plasticité. C’est sous la pression de l’unification allemande et pour obtenir le blanc-seing européen que les Allemands avaient accepté une date butoir fixée à au plus tard 1999.
Jean Pisani-Ferry
J’ai le souvenir des propositions britanniques en faveur de la monnaie commune. C’était à l’époque un contre-feu au projet de monnaie unique. À quels problèmes la monnaie commune était-elle une solution ? Cela n’a jamais été vraiment défini si ce n’est le fait que les Britanniques ne voulaient pas participer à une union monétaire.
La position française a toujours été de vouloir siéger au Conseil de la Bundesbank et de ne pas rester sous la domination monétaire de l’Allemagne. Nous étions en régime de change fixe, l’autonomie de la Banque de France se comptait à l’époque en nanosecondes. Lorsqu’à la Bundesbank il était décidé de changer le taux d’intérêt, la Banque de France suivait dans l’espace d’un instant.
Ce qui a conduit à la monnaie unique, c’est l’attachement aux changes fixes, qui ne faisait pas débat mais est parfaitement discutable. Aurions-nous mieux fait d’aller vers un régime de change flottant ? C’était un vrai choix. Mais à partir du moment où nous étions dans un régime de change fixe, la question était : voulez-vous ou non participer à la décision ? Participer à la décision supposait une institution commune dans laquelle nous pesions autant que les autres grands pays. Dans ce débat historique il est important de rappeler qu’il s’agissait d’un projet français. Vous l’avez dit : il avait été arraché à Karl Otto Pöhl et à tout un courant allemand très critique de l’unification monétaire. En Italie il y avait aussi des courants très critiques. À l’époque j’étais à Bruxelles et je me souviens que le seul débat français portait sur la date butoir : parviendrons-nous à arracher la date butoir, à créer l’irréversibilité ? Nous voulions avoir l’assurance qu’à une certaine date nous aurions voix au chapitre.
Jean-Pierre Chevènement
Il me paraît très important de marquer que le choix de la monnaie unique résulte d’une volonté française. Car la monnaie commune était d’une certaine manière un système qui laissait subsister la flexibilité entre les monnaies nationales. Mais elle ne répondait pas à la question que Jean Pisani-Ferry a posée.
Nous allons maintenant écouter Patrick Artus qui va dresser un bilan de l’euro et en dessiner les perspectives.
L’euro, bilan et perspectives
Intervention de Patrick Artus, directeur de la Recherche et des Etudes chez Natixis, auteur de Euro, par ici la sortie ? avec Marie-Paule Virard (Fayard, 2017), lors du colloque “L’euro vingt ans après, bilan et perspectives ” du lundi 6 mai 2019.
Je commencerai par une remarque à propos de ce qui vient d’être dit. Il faut quand même réfléchir à ce que signifierait la coexistence de deux monnaies, une monnaie commune et les monnaies nationales. Pendant la période où l’on a connu ce type d’organisation, le sport national consistait à passer en fraude de l’une à l’autre de ces monnaies dont les perspectives de taux de change et les taux d’intérêt étaient différents. Ce système n’a jamais fonctionné nulle part et a créé une instabilité épouvantable. Je crois donc qu’il était quand même très raisonnable de ne pas se lancer dans ce système.
Je reprendrai, un peu différemment, les questions importantes abordées par Jean-Michel Naulot.
Quand on réfléchit à la situation et aux problèmes de fonctionnement les plus sérieux de la zone euro, il importe de se rendre compte que le débat intéressant n’est pas macro-économique. Il y a eu un débat macro-économique sur l’euro, on a débattu de l’austérité budgétaire, de l’austérité monétaire. Ces débats sont de peu d’intérêt et relativement périmés. Aujourd’hui nous pratiquons une politique monétaire ultra-expansionniste à peu près partout, sauf en Allemagne et aux Pays-Bas. Il me semble que le débat sur les conséquences macro-économiques de l’unification n’est ni très intéressant ni d’actualité.
Je ferai une seconde remarque en introduction avant d’entrer dans le vif du sujet. Jean-Michel Naulot rappelait les travaux de Robert Mundell qui datent de presque soixante ans. Quand des pays font le choix d’une monnaie unique, le fait de passer d’autant de politiques monétaires que de pays à une seule politique monétaire a un coût macro-économique que l’on peut tenter d’alléger, par exemple avec du macro-prudentiel spécifique au pays, ce qu’on fait très peu dans la zone euro (et qu’on pourrait faire beaucoup plus). Enfin, fondamentalement, des pays qui, ayant des économies différentes, pratiquent la même politique monétaire subissent forcément un coût macro-économique.
Ce n’est donc pas dans la macro-économie qu’il faut chercher un intérêt à la constitution d’une monnaie unique mais dans la micro-économie. Le problème de la zone euro c’est que nous avons encore énormément de choses à corriger avant de voir des bénéfices micro-économiques de l’unification.
Ce que je dis va à l’encontre de l’argument friedmanien des années 1960-1970 sur l’intérêt des changes flexibles qu’a évoqué Jean-Michel Naulot. Nous acceptons de subir le coût macro-économique des taux de change fixes en espérant que ce coût sera dominé par les avantages micro-économiques que l’on attend de la fin des risques de change entre les pays d’une union monétaire.
Or, pour plusieurs raisons, nous ne bénéficions pas aujourd’hui du profit micro-économique que nous devrions tirer de la constitution de l’euro.
La première raison, extrêmement importante, a déjà été évoquée par Jean-Michel Naulot. Depuis la crise de 2010-2012, il n’y a pratiquement plus de mobilité des capitaux entre les pays de la zone euro, alors qu’avant la crise, dans les dix premières années de l’euro, énormément de capitaux circulaient d’un pays à l’autre, provoquant l’accumulation de dettes et actifs extérieurs entre les pays de la zone euro. Assez brutalement, en 2010, survint ce que les économistes appelaient pour les émergents un sudden stop (arrêt brutal), les flux de capitaux cessèrent de circuler entre les pays de la zone euro.
La zone euro était (est toujours) dans une situation assez particulière où deux pays avaient un excédent d’épargne alors que tous les autres avaient des déficits d’épargne. C’est donc assez naturellement que, dans un premier temps, l’Allemagne et les Pays-Bas ont prêté leur excédent d’épargne aux autres pays. Ceci s’arrête extrêmement brutalement en 2010. Cette brutalité est corrigée par les actions de la BCE, par Target2 (la seule allusion à ce système de transferts fait frémir tout Allemand !). Sans Target2, par lequel on a remplacé les lignes de crédit interbancaire entre les pays par des crédits qui transitent via les banques centrales, la crise eût été bien plus épouvantable et nous n’aurions déjà plus d’euro.
Depuis cet arrêt extrêmement brutal de la circulation des capitaux, les pays autres que l’Allemagne et les Pays-Bas ont dû réduire leurs déficits extérieurs et rééquilibrer leur balance commerciale. Aujourd’hui la plupart d’entre eux ont des excédents. L’Allemagne et les Pays-Bas prêtent désormais leur énorme excédent d’épargne au reste du monde. Ceci est souvent débattu. On souhaiterait que les Allemands (et les Hollandais) fassent des déficits publics et consomment davantage. On ne les y forcera pas. L’Allemagne est un pays où l’envie d’épargner est grande. Mais le problème n’est pas que les Allemands aient des excédents budgétaires ou que les ménages allemands épargnent beaucoup, c’est que cette épargne ne soit pas prêtée aux autres Européens. Si cette épargne finançait des investissements dans la zone euro, il n’y aurait aucun coût au fait que les Allemands épargnent énormément. Or depuis 2010, l’épargne des Allemands finance des investissements dans le reste du monde, privant la zone euro des investissements correspondants et déprimant durablement la croissance de la zone euro. La zone euro a 4 points de PIB d’excédents courants, c’est-à-dire que 4 % de notre PIB sont investis dans le reste du monde. C’est un problème absolument majeur.
C’est un double problème majeur. On débat souvent entre économistes du « risk sharing » du partage des risques entre les pays : les pays ont des situations cycliques ou structurelles différentes et il faut un mécanisme pour redistribuer les revenus des pays qui vont bien vers les pays qui vont plus mal. On dit en général que le mécanisme le plus efficace de partage des risques serait un budget de la zone euro de taille suffisamment grande pour que les pays qui vont mal y contribuent moins.
Or l’exemple américain montre que l’essentiel du partage des risques ne se fait pas par le budget fédéral mais par les diversifications des portefeuilles. Un épargnant louisianais possède des actions de l’État de New York ou de la Californie. Si la Louisiane va mal il reçoit des dividendes sur ses actions des États qui vont bien. Quantitativement, ce partage des risques par la diversification des portefeuilles est plus important que le partage des risques par le budget fédéral.
Nous n’aurions donc pas besoin d’avoir un budget fédéral si nous avions des portefeuilles diversifiés, si nos actifs financiers étaient répartis dans l’ensemble de la zone. Or, comme l’a rappelé Jean-Michel Naulot, depuis 2010, chaque pays a un biais domestique extrêmement important. Les épargnants, les banques, les investisseurs investissent essentiellement dans les actifs financiers de leur pays. Il n’y a donc aucune diversification des risques. Si je ne détiens que des actions françaises et si la France va mal, non seulement je vais mal mais mes actions ne me rapportent plus rien, alors que si j’avais des actions allemandes j’aurais au moins cette compensation.
La raison essentielle pour laquelle on fabrique une union monétaire est de permettre que l’épargne s’investisse là où les investissements sont les plus efficaces, c’est-à-dire, normalement, dans les pays périphériques où le revenu par habitant est le plus bas. Or cette circulation des capitaux a complètement disparu et les pays périphériques sont réduits à financer leurs investissements avec leur propre épargne. D’autre part l’absence de mobilité des capitaux fait disparaître tout partage des risques privés, par opposition au partage des risques public qui passerait par un budget fédéral.
Alors que fait-on ? Je crois que la seule solution est le rétablissement de la confiance.
Cela plaide pour une certaine rigueur budgétaire afin que personne ne craigne qu’un pays de la zone euro ne rembourse pas sa dette publique. Il s’agit, par exemple, de permettre à un assureur-vie allemand d’acheter de la dette italienne. Ce n’est pas gagné mais c’est l’objectif.
Il faut aussi nettoyer extrêmement rapidement les bilans des banques, ce qui est en train d’être fait. La BCE a demandé une accélération du provisionnement des mauvaises créances (ce qu’on appelle les Non Performing Loans), des banques. L’arrêt des prêts interbancaires a constitué une part importante de l’arrêt de la circulation des capitaux. Il faut donc rétablir une circulation des prêts entre banques des différents pays. L’épargne des Allemands doit pouvoir financer des travaux dans un autre pays au travers des prêts interbancaires. Dans une situation où il n’y a pas de mobilité des capitaux entre les pays, l’euro ne sert à rien. En effet, l’usage essentiel d’une monnaie unique est bien de permettre cette libre circulation de l’épargne à l’intérieur de la zone, ce qui n’est pas possible dans un système de changes flexibles en raison du risque de change.
Le deuxième sujet sur lequel il faut évidemment progresser est la question des externalités.
De nombreux ouvrages expliquent que quand on rentre dans une monnaie unique il apparaît de nouvelles externalités, c’est-à-dire que les politiques économiques d’un pays se mettent à avoir des effets sur les autres pays, ce qui n’était pas le cas en taux de change flexibles. Par exemple, si un pays décide de baisser le coût du travail, en taux de change flexibles sa monnaie va vraisemblablement s’apprécier et il ne va pas gagner de compétitivité. À l’intérieur de la zone euro il va gagner de la compétitivité aux dépens des autres pays de la zone euro puisque le taux de change ne peut pas ajuster.
Quand on crée une monnaie unique, il faut logiquement coordonner l’ensemble des politiques économiques dont on pense qu’elles vont générer des externalités négatives sur les autres pays. Or on ne l’a pas fait. Aujourd’hui un pays peut librement déréglementer son marché du travail, baisser la taxation des produits de ses entreprises, baisser les cotisations sociales des entreprises. C’est ce que les Allemands ont fait avec Gerhard Schröder au début des années 2000, ce que les Espagnols ont fait depuis 2009 et ce que la France fait depuis deux ans. Tout ceci crée des externalités très fortes sur les autres pays. Il faut prendre conscience que si les réformes d’Emmanuel Macron aboutissent, elles se feront essentiellement au détriment des autres pays de la zone euro. C’est pourquoi, en théorie, nous devrions avoir une pratique de coordination de ce type de politique. Par exemple un pays ne devrait pas pouvoir baisser son coût du travail sans l’accord des autres (c’est une pratique de type Bretton Woods où on ne peut dévaluer de façon unilatérale sans l’accord du FMI). Assez bizarrement, dans la zone euro, on peut faire des dévaluations internes unilatérales. On peut, sans coordination, gagner de la compétitivité au détriment des autres.
Symétriquement, il ne sert à rien de coordonner des politiques qui n’exercent pas d’externalités. Assez curieusement, dans la constitution des règles, on a décidé que les déficits publics généraient une externalité négative sur les autres pays : si la France, par exemple, fait un gros déficit public, le taux d’intérêt commun de la zone euro va monter, ce qui n’est pas bon pour les autres, il faut donc empêcher la France de faire un gros déficit public. C’est complètement faux. En effet, si la France fait un gros déficit public, seul le taux d’intérêt de la France va monter, la prime de risque de la France va monter. Depuis un an, la politique budgétaire expansionniste de l’Italie a fait monter le taux de l’Italie et nullement le taux de l’Allemagne.
Il n’y a donc aucune raison de coordonner les politiques budgétaires que pourtant on coordonne. Il n’y a aucune raison de coordonner les taux de TVA que pourtant on coordonne. Et il y a beaucoup de raisons de coordonner les cotisations sociales, les règles du marché du travail, la fiscalité des profits des entreprises qu’on ne coordonne pas ! C’est-à-dire qu’il n’y a aucun lien aujourd’hui en Europe entre l’existence ou non d’externalités des politiques économiques et le fait qu’elles soient ou non coordonnées. En fait on coordonne celles qu’il ne faudrait pas coordonner et on ne coordonne pas celles qu’il faudrait coordonner ! Un papier d’Agnès Bénassy-Quéré il y a quelques années, empirique, montrait que les externalités des déficits publics étaient positives jusqu’à un certain point.
Le troisième sujet a aussi été évoqué par Jean-Michel Naulot. L’un des grands absents de la zone euro est ce que certains économistes ont décidé d’appeler « l’union des marchés du travail ».
Quand on a la même monnaie il faudrait avoir à peu près les mêmes institutions du marché du travail. Ce n’est pas du tout le cas aujourd’hui. Les négociations salariales, en France et en Allemagne, sont sans rapport. L’Allemagne a des syndicats de branches, la France des syndicats nationaux. Nous n’avons pas les mêmes règles de salaire minimum, de licenciement, d’indemnisation du chômage. Les institutions des marchés du travail sont extrêmement différentes d’un pays à l’autre. Il en résulte une divergence des coûts salariaux entre les pays de la zone euro, sans politique correctrice. Depuis le début de l’euro les coûts salariaux augmentent beaucoup plus vite en Espagne, en Italie, en France qu’en Allemagne. Ils divergent. Une des raisons de la divergence réside dans les différences profondes entre les modes de fonctionnement des marchés du travail. En théorie, ce n’est pas très grave : un pays qui subit une perte de compétitivité-coûts parce que ses coûts salariaux ont augmenté plus vite que ceux des autres pourrait la corriger par une dévaluation interne, en baissant ses salaires, et rétablir sa compétitivité. La dévaluation interne serait l’équivalent de la dévaluation monétaire d’autrefois. Mais ce n’est pas le cas car une dévaluation interne déprime la demande intérieure en raison de la baisse des salaires alors qu’une dévaluation monétaire stimule la demande en facilitant des exportations. Ces deux types de dévaluation ne sont donc pas du tout équivalentes. En revanche, une dévaluation fiscale, par exemple en baissant les cotisations sociales des entreprises et en montant la TVA, équivaut à une dévaluation normale. Mais une baisse des salaires, n’a pas du tout les mêmes effets redistributifs. Deux dévaluations internes ont eu lieu dans la zone euro : celle de l’Allemagne à partir de 2000 (Schröder-Hartz) et celle de l’Espagne à partir de 1999. Certes, après quatre ou cinq ans, ces deux pays ont gagné de la compétitivité, reconquis des parts de marché à l’export. Ils ont donc investi davantage et recréé des emplois. Mais le coût des quatre ou cinq premières années a été extrêmement important en termes de perte d’emplois et de demande. Je pense que les Espagnols aujourd’hui ne le referaient pas. On va voir ce que fera l’Allemagne dont la compétitivité est aujourd’hui aussi mauvaise qu’en 2000. Les Allemands sont à nouveau confrontés à un gros problème industriel en partie dû à une très grande perte de compétitivité-coût. La nouvelle chancelière fera-t-elle une dévaluation interne ? J’ai d’énormes doutes. Ni les Français ni les Italiens ne le feront jamais.
En réalité, nous n’avons pas dans la zone euro de technologie qui soit raisonnablement utilisable pour corriger les écarts de compétitivité qui vont donc continuer à s’amplifier. Des pays vont durablement gagner des parts de marché par rapport aux autres. La seule façon d’éviter cela serait l’harmonisation du fonctionnement et des règles des marchés du travail de manière à ce que les coûts augmentent de manière relativement parallèle.
Dernier point, lui aussi de nature micro-économique : L’Union européenne a très peu tiré profit du marché unique. En particulier nous n’avons pas de grandes entreprises de l’internet. Nous n’avons pas non plus de grandes entreprises dans le domaine des énergies renouvelables. Nous ne fabriquons pas de cellules solaires, pas de batteries électriques. Nous commençons à peine à nous intéresser à la technologie des batteries électriques alors que les Chinois les fabriquent depuis quinze ans. Et nous n’avons ni Ali Baba, ni Amazon, ni Microsoft, ni Apple… or la taille du marché européen est à peu près la même que celle du marché américain ou du marché chinois.
Pourquoi n’avons-nous pas su profiter du marché unique pour développer ces grandes entreprises dans les industries d’avenir ? Et pourquoi avons-nous persisté, surtout l’Allemagne, dans une spécialisation très forte dans les industries du passé ? Le coût va être terrible pour l’Allemagne. L’avenir de l’économie n’est pas forcément très rose pour qui fabrique des voitures diesel, de la chimie et des biens d’équipement industriel, d’autant que ces industries ont des rendements d’échelle croissants.
Le fait de pouvoir se développer sur un grand marché domestique est extrêmement important, ce qu’ont d’ailleurs bien compris les Chinois et les Américains dont les entreprises exploitent d’abord les rendements d’échelle croissants sur le marché intérieur, s’assurant sur le marché intérieur des rentes très fortes d’oligopoles ou de monopoles qu’elles peuvent ensuite utiliser pour faire de la croissance internationale.
Or l’Europe n’a pas fait les mêmes choix. Il y a de nombreuses explications à cela. Il y a une explication par les règles de la concurrence qui, en Europe, auraient empêché la constitution d’entreprises puissantes. Il y a une explication par le nationalisme économique : chacun veut avoir sa boîte de télécoms, sa boîte d’énergie, sa boîte de transports et ne veut surtout pas fusionner avec les voisins. On voit aujourd’hui une résistance aux acquisitions (Air France – KLM, Bolloré en Italie etc.) et une très grande résistance à la constitution de groupes paneuropéens. En tout cas nous n’avons pas exploité les rendements d’échelle croissants sur le marché unique. C’est assez étonnant.
Ces quatre problèmes micro-économiques sont les plus sérieux : mobilité des capitaux, coordination de tout ce qui génère des externalités, unification des règles du marché du travail et les institutions des marchés du travail, exploitation des rendements croissants sur un marché interne unifié.
Aujourd’hui le bilan de l’euro est qu’il n’y a pas d’avantages micro-économiques suffisants pour compenser le coût macro. Le solde net est donc négatif puisque le négatif macro-économique n’est pas compensé par un positif micro-économique suffisamment grand. Donc ces quatre problèmes sont réglés.
Je ne suis pas sûr du tout que le budget de la zone euro soit le bon débat. Si nous faisions ce que je viens de préconiser (coordination des politiques fiscales qui créent des externalités, investissements en commun dans des grands projets industriels européens et mobilité des capitaux qui assure le partage des risques) nous n’aurions pas besoin d’un budget de la zone euro. C’est sur ces points que devrait porter le combat. C’est pourquoi je pense que le combat pour le budget de la zone euro n’est pas le combat le plus pertinent.
Merci beaucoup.
Jean-Pierre Chevènement
Merci, Monsieur Artus, pour ce brillant exposé.
Je voudrais vous poser deux questions qui se recoupent :
Vous avez parlé de la détérioration de la compétitivité allemande, comparée à ce qu’elle était en 2000. Mais l’excédent commercial allemand atteint quand même encore plus de 200 milliards d’euros et il me semble que la baisse des exportations allemandes tient plus à une certaine dépression au niveau des débouchés.
Vous n’avez pas mis l’accent sur les distorsions internes de la zone euro comme vous le faites à l’habitude, par exemple les distorsions de compétitivité justement. Peut-être n’existent-elles plus ?
Patrick Artus
Au regard des coûts de production de l’industrie allemande par rapport à ceux des autres pays européens, l’Allemagne se retrouve aujourd’hui dans une situation un peu plus mauvaise que celle de 2000. Et depuis deux ans les exportations de l’Allemagne ne suivent plus le commerce mondial. J’attribue cette perte de part de marché relativement importante et inhabituelle de l’Allemagne à une dégradation forte de sa compétitivité-coûts. D’une part les salaires ont accéléré, en raison du plein emploi, d’autre part il n’y a pratiquement plus aucun gain de productivité en Allemagne. En dépit du fait que l’Allemagne a fait un gros effort de robotisation et de modernisation de ses entreprises, il n’y a absolument plus aucun progrès de la productivité dans l’industrie allemande. On constate donc une assez grande dégradation de la compétitivité. Certaines entreprises ont à peu près les mêmes usines en France et en Allemagne et la productivité est beaucoup plus élevée dans les usines françaises que dans les usines allemandes !
Jean-Pierre Chevènement
Mais le coût horaire est légèrement supérieur en France à ce qu’il est en Allemagne.
Patrick Artus
Le coût salarial unitaire chargé (y compris les cotisations sociales) dans l’industrie est plus bas en France de 8 % à 9 % par rapport à l’Allemagne. Mais il n’y a pas que la France. L’Espagne est beaucoup moins chère. Et l’écart s’accroît rapidement, les coûts salariaux augmentent vite en Allemagne (productivité à 0 % et salaires à + 3 %). Si l’on considère l’écart entre l’Allemagne et les autres pays on est à peu près dans la même configuration qu’en 2000. On peut voir de façon positive le problème de compétitivité de l’Allemagne en tablant qu’il va profiter aux autres pays. Mais, du point de vue de l’Allemagne, cela va poser un problème similaire à celui qu’a rencontré Gerhard Schröder.
Quant aux excédents, ils proviennent de l’épargne. Tout le monde épargne en Allemagne. Les profits des entreprises atteignent 115 % de leurs investissements. Les ménages épargnent 18 % de leurs revenus et ce taux continue à augmenter. L’excédent de l’État allemand atteint pratiquement 2 points de PIB. Si on la corrige de l’épargne, les Allemands ont un commerce extérieur qui se dégrade. L’excédent allemand reflète l’énorme niveau d’épargne des Allemands et pas du tout la compétitivité de l’Allemagne. On pense en général que dans un pays l’épargne des uns compense la désépargne des autres. C’est la neutralité ricardienne. Si l’État fait du déficit public, le secteur privé va épargner. Mais en Allemagne tout le monde épargne. Pour dire les choses un peu brutalement, ils ont sans doute très peur de l’avenir, donc ils épargnent. Et ils ne travaillent plus, donc la productivité stagne.
J’ai évoqué la question de la très forte hétérogénéité entre les pays de la zone euro. J’en ai donné un certain nombre d’exemples : l’hétérogénéité du fonctionnement des marchés du travail, l’hétérogénéité des niveaux de compétitivité… Il faut un mécanisme de correction de l’hétérogénéité, du partage des risques. Je cherche à démontrer que, alors que l’on évoque le plus souvent le budget fédéral comme mécanisme de correction de l’hétérogénéité, le mécanisme privé par la diversification des portefeuilles serait beaucoup plus efficace, comme le montre l’exemple américain. Il faudrait vraiment que les assureurs, français par exemple, aient des portefeuilles d’actifs financiers de tous les pays de la zone euro et non une énorme concentration sur les actifs financiers français. Ceci assurerait un partage des risques.
Jean-Michel Naulot
Mais une crise en zone euro entraînerait un effet domino.
Patrick Artus
Cet argument consiste à dire qu’on va contingenter les crises en empêchant toute circulation internationale des capitaux ! Chacun chez soi et celui qui meurt est le seul à mourir. Le coût de cet argument est terrible parce qu’il interdit toute circulation de l’épargne pour aller sur les bons investissements.
Si on pense que c’est une mauvaise idée que l’épargne circule, il ne fallait pas de monnaie unique car sa fonction est justement de faire circuler l’épargne !
Jean-Michel Naulot
Mais les banques gèrent leurs risques.
Patrick Artus
Normalement la diversification des portefeuilles réduit les risques. C’est la base de la finance. Un portefeuille diversifié est moins risqué qu’un portefeuille concentré. Un banquier qui a une activité exclusivement nationale se met en péril. C’est ce qui s’est passé en 2008 lors de la crise de l’immobilier en Espagne. Si les banques espagnoles avaient fait des crédits à tous les pays européens, elles auraient résisté. La diversification de portefeuilles est quand même une assurance contre les risques locaux.
Jean-Pierre Chevènement
Nos actionnaires n’en prennent pas le chemin.
Patrick Artus
Les États n’en prennent pas le chemin. Les États n’aiment pas qu’un banquier utilise la liquidité d’un pays pour faire des crédits dans un autre pays. Mais la raison voudrait qu’on diversifie les portefeuilles afin que les investisseurs et les banques européennes investissent largement dans l’ensemble des pays. Les règles de réserve de liquidité des banques sont appliquées aujourd’hui de telle manière que les banques n’achètent pratiquement que des dettes publiques de leur pays. Clairement, il faudrait que les banques détiennent des dettes publiques de l’ensemble des pays, ce qui assurerait la circulation des capitaux, le financement homogène des budgets etc. J’ai essayé de convaincre mon président [1] d’acheter de la dette italienne… il a failli me tuer : « Vous êtes fou ! Si je fais faillite à cause de la France personne ne m’en voudra, si je fais faillite à cause de l’Italie on va avoir ma peau ! ». Pourtant, une diversification des portefeuilles d’investissement, des investisseurs, des banques, entre les actifs financiers des pays assurerait le partage des risques.
Jean-Pierre Chevènement
Mais peut-on faire une politique avec le conditionnel (« Il faudrait… ») ou l’optatif (« Ce serait mieux si… »), plus conforme à la monnaie unique et aux objectifs auxquels elle est censée répondre ? J’observe que les choses ne se passent pas comme ça.
Patrick Artus
Il suffirait de changer les règles.
Jean-Pierre Chevènement
Après ce débat tout à fait décoiffant, je donne la parole à M. Pisani-Ferry, ancien Commissaire général de ce que je préfère appeler le « Plan » parce que « France Stratégie » est plus difficile à mémoriser.
Les démons se sont-ils assagis depuis 2012 ? Que faire ?
Intervention de Jean Pisani-Ferry, professeur associé à Sciences Po, Senior Professor à la Hertie School of Governance de Berlin, Commissaire général de France Stratégie de 2013 à 2017, auteur de Le réveil des démons (Fayard, 2011), lors du colloque “L’euro vingt ans après, bilan et perspectives ” du lundi 6 mai 2019.
France Stratégie, c’est mieux que « Commissariat général à la stratégie et à la prospective » qui est son nom initial !
Je répondrai d’abord aux remarques de Patrick Artus, avant d’évoquer un point d’histoire puis d’en venir à la question des instruments.
Je voudrais rappeler la première phrase du communiqué des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro, en juin 2012 : « Il est impératif de briser le cercle vicieux entre les banques et les États ». Ce n’était pas « Il serait souhaitable… » mais « Il est impératif… ».
Le diagnostic, à l’époque assez clair, était celui que vient de faire Patrick Artus, avec lequel je suis en plein accord : on ne peut pas gérer un ensemble monétaire intégré avec un marché financier qui se désintègre, une circulation de l’épargne qui ne se fait plus, des banques qui ne prêtent qu’à leurs États, donc une infrastructure financière qui se défait. C’était ce que j’écrivais au printemps 2012 dans l’article que Jean-Michel Naulot a cité. Ce diagnostic s’imposait.
C’est sur cette base qu’a été lancé le chantier de ce qu’on a appelé l’Union bancaire qui consiste à transférer la responsabilité de supervision des banques à la Banque centrale européenne (ce que l’on a fait) et à transférer la responsabilité de la gestion des crises bancaires, ce qu’on appelle la résolution, à une instance européenne (ce que l’on a fait partiellement). Il s’agissait, au fond, de sortir de l’intimité perverse entre banques et souverains. Et puis aussi de faire en sorte que les banques diversifient le risque, comme le préconisait Patrick Artus. La meilleure manière, pour les banques, de diversifier le risque serait qu’une large partie d’entre elles deviennent paneuropéennes. Les petites banques régionales ne posent pas de problème sérieux, mais avoir de grandes banques nationales est la mauvaise manière de gérer le risque. Ce qui s’est passé sur le marché immobilier en Espagne ou en Irlande est strictement équivalent de ce qui s’est passé en Floride ou au Nevada. Si on n’a pas beaucoup entendu parler de ces derniers cas, c’est parce qu’il n’y pas eu de corrélation entre les crises régionales et les crises bancaires.
Il est contradictoire de vouloir construire une zone monétaire intégrée sans créer un espace financier intégré. Cela a été reconnu mais on n’est pas allé jusqu’au bout de la démarche parce que l’on s’est heurté à du refus en matière de consolidation bancaire transfrontière. Des régulateurs se sont opposés à ce que la liquidité aille d’un pays à un autre. J’en donnerai un exemple : la banque italienne UniCredit, qui avait acheté la banque allemande HVB (HypoVereinsbank), avait des clients de part et d’autre de la frontière italo-autrichienne et le prix du crédit pour deux hôtels situés dans la même zone touristique, mais de part et d’autre de la frontière, n’était pas du tout le même, parce que le régulateur empêchait la banque de transférer la liquidité qu’elle détenait d’un côté de la frontière de l’autre côté ! On n’est pas vraiment sorti de cette situation. On a fait des choses considérables en termes de supervision, mais les régulateurs nationaux continuent à exercer une pression sur les systèmes bancaires.
Comme le disait Patrick Artus, à partir du moment où on avait adopté cette monnaie unique, il fallait en tirer les leçons et en exploiter au maximum les avantages micro-économiques. La circulation de l’épargne est très importante, pour les banques comme pour les marchés des capitaux. La crise a été grave en 2010-2011 parce que c’était une crise du crédit bancaire. Quand on a financé les déficits espagnols par de l’épargne allemande, cela s’est fait par du crédit bancaire, largement intermédié par les banques françaises, et non par de l’investissement direct en actions de l’Allemagne en Espagne, ce qui aurait posé beaucoup moins de problèmes parce que si les Allemands avaient financé directement le boom immobilier en Espagne ils auraient pris leurs pertes. Cela n’aurait affecté que les épargnants qui auraient subi ces pertes, mais cela n’aurait pas été un problème financier global.
Nous sommes donc devant cette contradiction.
Comme Patrick Artus, je pense qu’il faut aller jusqu’au bout de l’intégration micro-économique. Les aspects bancaires et l’épargne poseront des problèmes compliqués en raison de l’hétérogénéité des modèles de fiscalité, des réglementations, des systèmes de retraites etc. Évidemment on ne va pas unifier tout cela pour avoir une seule fiscalité de l’épargne, un seul type de système de retraite etc. Ces hétérogénéités subsisteront.
En revanche, j’ai un désaccord avec Patrick Artus sur la question du coût des dévaluations internes. Je ne dirai pas que celles-ci sont inefficaces. Certes ces dévaluations internes, telles qu’elles ont été pratiquées en Irlande, en Espagne etc., ont été très coûteuses. Elles se sont néanmoins produites. Ces pays ont restauré une situation de compétitivité et, pour certains d’entre eux, de croissance rapide. C’est le cas de l’’Espagne, de l’Irlande et même du Portugal qui, à la surprise générale, s’en sort de mieux en mieux, même avec un gouvernement qui, jugeant que le temps était venu de tirer parti des efforts faits, a décidé de mettre un terme à l’austérité. Cela se passe plutôt bien.
Si on peut souhaiter que le mécanisme d’ajustement fonctionne de manière moins douloureuse, on ne peut pas dire qu’il ne fonctionne pas. Quand l’Allemagne fait des augmentations de salaires, cela participe de ce mécanisme d’ajustement qui ne doit pas être simplement asymétrique. Il doit fonctionner dans le sens de l’augmentation des salaires chez certains et dans le sens de la modération des salaires chez d’autres de manière à surveiller ces positions de compétitivité. C’est un pilotage délicat mais qui n’impose pas l’unification des marchés du travail. C’est une illusion de penser qu’on pourra unifier le marché du travail. Les institutions du marché du travail sont extrêmement différentes. Dans certains pays, la négociation est très centralisée : un syndicat et un patronat, face à face et avec le gouvernement, se mettent d’accord sur la négociation salariale au niveau de l’ensemble du pays. Dans d’autres pays, à l’inverse, la négociation est extrêmement décentralisée. Il y a des situations intermédiaires, telle la situation française où les syndicats sont organisés par branches. On ne va pas, parce qu’on est dans un espace monétaire commun, unifier des institutions fondamentales du fonctionnement de nos économies. On peut les faire fonctionner ensemble, les coordonner en tenant compte des positions relatives. Il faut accepter de reconnaître, dans certaines situations, que l’évolution des salaires est trop forte dans tel pays, insuffisante dans tel autre. C’est ensuite à chaque pays d’utiliser les mécanismes de négociation collective, à travers l’influence que le gouvernement peut avoir sur ces mécanismes, avec tel ou tel instrument qui est à sa disposition, directement sur la négociation collective ou sur le salaire minimum dans les systèmes très centralisés, ou plus indirectement en portant un diagnostic et en le partageant avec les partenaires sociaux. Pour des raisons assez profondes, notre intégration restera malgré tout inférieure à celle des marchés américain ou chinois.
Pourquoi n’avons-nous pas tiré parti de l’échelle du marché pour le numérique ? demandait Patrick Artus. En partie pour de mauvaises raisons, auxquelles on peut répondre, notamment ce qui touche au marché des capitaux ou à la reconnaissance d’un certain nombre de produits.
Mais les raisons fiscales, les raisons de droit de la concurrence, les raisons de protection des consommateurs (le droit de la donnée par exemple, pour tout ce qui est numérique) comportent des éléments qui resteront forcément plus hétérogènes que sous un régime absolument fédéral.
Mais nous devons éviter de créer des barrières artificielles, comme cela a été fait par exemple pour la régulation des télécoms. La même technologie est arrivée à peu près dans tous les pays et nous avions de bonnes raisons de gérer le marché des télécoms au niveau de l’ensemble de l’Union européenne. Nous avons d’ailleurs fini par le faire partiellement en imposant la fin des charges d’itinérance. Mais dans l’intervalle chacun a cultivé son marché, avec un régulateur de télécoms par pays, donc une segmentation du marché telle qu’il n’y a pas vraiment de grands opérateurs européens et que le marché est extraordinairement fragmenté. Lorsqu’il est possible, dans des domaines nouveaux, de passer à un régime de régulateur unique cela vaut vraiment la peine de le faire. C’est vrai dans les télécoms, c’est vrai dans un certain nombre de domaines qui touchent au numérique.
J’y insiste : le modèle qu’on a commencé d’appliquer en matière bancaire, et qu’il faut appliquer complètement, ne doit pas se généraliser à l’ensemble des secteurs. Il ne s’agit pas d’aller systématiquement vers un modèle d’unification complète du marché. Mais dans un certain nombre de domaines dans lesquels on crée pour l’avenir des formes nouvelles d’intégration, on aurait intérêt à le faire beaucoup plus qu’on ne le fait. Si on ne le fait pas, c’est pour des mauvaises raisons qui tiennent au fait que chacun veut protéger tel ou tel champion national et limiter la concurrence dans des domaines où la concurrence est pourtant créatrice d’effets d’échelle, de richesses collectives, de puissance internationale.
Je souhaite maintenant revenir sur un point historique.
J’ai rappelé qu’une de nos fortes motivations était de participer à la décision. C’était aussi d’en finir avec la contrainte extérieure qui, à l’époque, était notre grande obsession. La possibilité du financement des déficits extérieurs et de la circulation de l’épargne répondait donc étroitement à nos vœux. Une troisième dimension d’importance était le rôle international de la monnaie. C’était une idée très française (les autres Européens partageaient assez peu cette idée et doutaient des avantages d’une monnaie internationale). Nous y étions attachés car elle s’inscrivait dans la lignée des critiques gaullistes sur le privilège exorbitant du dollar, inspirées par Jacques Rueff, et le refus d’être dans un monde dominé par une seule monnaie internationale. Tout cela pouvait paraître un peu désuet, un peu inutile. Toutefois nous venons d’avoir confirmation du fait que le dollar n’est pas un bien public international que, généreusement et sans conditions, les États-Unis mettent à la disposition du reste du monde. Le dollar est aussi le véhicule de l’extraterritorialité d’un certain nombre de décisions américaines parfaitement contestables, en l’espèce les sanctions à l’égard de l’Iran. On peut en dire autant du système financier américain, de l’accès au marché américain de manière générale. Nous avons appris dans les derniers mois à quel point ce que nous considérions comme un système géré largement dans l’intérêt collectif, avec certes quelques privilèges pour les États-Unis – qu’ils utilisaient avec une certaine auto-restriction – est en réalité autre chose. Nous nous trouvons face à une situation dans laquelle les États-Unis utilisent cette monnaie comme véhicule de puissance. Et nous savons que la Chine promeut activement le renminbi qui, pour l’instant, n’a pas les attributs d’une monnaie internationale mais dont, à l’évidence, les Chinois cherchent à faire de plus en plus un véhicule international d’influence et de puissance.
La vieille idée française est que si l’euro n’est pas un rival du dollar au sens où il ne prétend pas à le remplacer comme monnaie mondiale, il peut néanmoins être utile dans les relations avec des pays partenaires, et que nous avons quelque intérêt à le développer. Cette idée revient très fortement dans l’actualité. En effet, une zone constituée de pays avancés comme nous le sommes, avec des systèmes juridiques sophistiqués et impartiaux, une tradition de stabilité macro-économique, des marchés financiers qui, en dépit de tout ce qu’on vient de dire, restent liquides et profonds, fait partie des rares entités qui peuvent offrir une monnaie au reste du monde. Aujourd’hui il y a les États-Unis. La Chine n’en est pas encore là. Les autres pays ne peuvent y prétendre. Ce peut donc être un aspect important de l’existence européenne sur la scène internationale.
Cela suppose de remplir quelques conditions, notamment de pouvoir offrir des garanties à des pays dont les systèmes financiers auraient besoin d’un accès à la liquidité en euro en cas de crise. Cela suppose des lignes de swap qui permettent de fournir cette liquidité aux banques centrales des pays partenaires, afin que celles-ci les prêtent à leurs propres banques. Mettre en place une ligne de swap, c’est une décision discrétionnaire et, pour être clair, c’est une décision politique. Aujourd’hui, dans le cas européen, nous n’avons pas mis en place cet instrument pour des raisons complexes qui tiennent aux relations entre la Banque centrale européenne et les autorités budgétaires. Je vois là aussi une dimension à ne pas négliger.
Dans cet historique, je voudrais faire une dernière remarque sur la Banque centrale européenne. Le contrat qui a été passé au moment de la création de l’euro montre que celle-ci a été obtenue aux conditions allemandes d’un point de vue institutionnel : primauté de l’objectif de stabilité des prix, indépendance de la Banque centrale, surveillance des politiques budgétaires. Contrairement à ce que nous avions cru, la crise nous a appris que la BCE n’est pas du tout un clone de la Bundesbank. La BCE s’est instaurée comme institution internationale avec une vision, des politiques, qui ne sont ni dans l’intérêt de l’Allemagne spécifiquement, ni philosophiquement conformes à la conception allemande. Tant et si bien que le Président de la Bundesbank est allé à la Cour constitutionnelle allemande pour témoigner contre la Banque centrale européenne. Celle-ci avait en effet annoncé qu’elle pourrait mettre en place des « opérations monétaires sur titres » (OMT, la traduction française de « Outright monetary transaction » est de Christian Noyer, ni l’un ni l’autre ne veulent rien dire mais c’est le même acronyme) pour permettre à la BCE d’intervenir sur les marchés de la dette publique d’États en difficulté à condition qu’ils satisfassent à un certain nombre de prescriptions de politique économique. Le but était d’éviter les scénarios d’éclatement qui nous menaçaient dans les années 2010-2011. L’annonce des OMT a participé de ce coup d’arrêt à la désintégration financière. Le Président de la Bundesbank a plaidé que c’était contre les traités, la Cour constitutionnelle en a référé à la Cour de justice de l’Union européenne qui a jugé que ce n’était pas contre les traités…
C’est un des multiples exemples de ce qu’on a vu au cours de ces dernières années : une politique de préservation de la zone euro audacieuse qui va jusqu’aux limites de ce qui est possible dans le cadre juridique des traités, qui ne s’embarrasse pas de tabous et qui n’est certainement pas prisonnière d’une certaine tradition monétaire qui provoque aujourd’hui en Allemagne des critiques nombreuses et violentes à l’égard de la politique de la BCE et du risque que cela présente pour l’Allemagne. Je tiens à le rappeler parce qu’en France on l’oublie parfois et on a un peu trop tendance à penser que nous avons accepté des conditions qui, au fond, sont à l’opposé de nos propres traditions et de nos propres intérêts. Dans le cas de la BCE, ce n’est pas vrai.
Que faire ? Cela nous conduit à la question des instruments budgétaires.
Nous partageons tous le constat qu’il y a des éléments assez profondément insatisfaisants dans la manière dont a fonctionné la zone euro. Elle devait créer de la prospérité sur une base micro-économique et avec une bonne gestion des tensions macro-économiques. Cette prospérité n’a pas été au rendez-vous. Nous avons laissé se créer des déséquilibres très importants avant la crise et nous avons mal géré les désordres qui ont suivi. Nous avons subi une double récession, d’abord en 2008 puis en 2011, et la reprise s’est finalement manifestée dans les années 2014-2015, nettement plus tard qu’ailleurs, avec des déséquilibres internes importants. Nous ne pouvons pas en être satisfaits.
Face à cette situation il y a des réponses systémiques, qui ont été dites. Les réponses de politique monétaire ont été fortes et utiles. Les réponses de politique budgétaire ont été assez désordonnées. Nous avons fait collectivement des erreurs importantes de politique budgétaire en croyant que le temps était venu de la consolidation budgétaire en 2011-2012-2013 alors qu’elle était prématurée compte tenu de l’état de notre système financier. Il y a des erreurs dont il faut apprendre et qu’il faut corriger.
Sur la question spécifique du budget de la zone euro, j’accorde à Patrick Artus que dans un monde où la zone euro fonctionnerait très bien, on aurait probablement assez peu besoin d’un budget de l’ensemble de la zone euro. Cela supposerait d’abord une stabilisation privée qui vienne de l’intégration financière, qui vienne du fait que les agents privés n’ont aucune difficulté à accéder au crédit lorsqu’ils en ont besoin, que leurs portefeuilles sont diversifiés et que les États eux-mêmes, lorsqu’il faut mener des politiques de stabilisation, n’ont pas de difficulté à le faire et peuvent emprunter sans trop de crainte. Aujourd’hui ces conditions ne sont réunies ni du point de vue de la diversification des portefeuilles, ni du point de vue de l’accès au crédit en situation de besoin de liquidités, ni du point de vue de la capacité de s’endetter des États qui est assez inégale. Lors de la prochaine récession (qui viendra, bien sûr), la crainte de voir se répéter les conditions de tensions très fortes que nous avons connues au moment de la crise de la zone euro pourrait entraîner un excès de prudence qui, en période de récession, accentuerait la récession. C’est pourquoi il faut réfléchir à un outil de stabilisation. En tant qu’outil de stabilisation, le budget de la zone euro pouvait, me semble-t-il, présenter de l’utilité par rapport à des chocs atteignant certains États pris individuellement, voire – mais c’est plus exigeant et ce n’était pas dans les propositions qui ont été formulées – offrir une capacité d’endettement commune pour mener une politique budgétaire commune face à des difficultés.
Nous sommes passés d’une période (celle de la création de l’euro) où l’on pensait que la politique budgétaire ne servait pas à grand-chose et que la politique monétaire pouvait tout faire à une situation dans laquelle on réévalue le rôle de la politique budgétaire, y compris aux États-Unis. Or nous avons construit le système de la zone euro avec une vision très restrictive de ce que peut faire la politique budgétaire, parce que nous l’avons construit essentiellement sur la base de l’expérience des années 1980, avec des modèles d’externalités fondés sur une épargne insuffisante. On pensait donc qu’un pays qui faisait du déficit tirait sur l’épargne commune, faisant monter les taux d’intérêt. Aujourd’hui l’épargne est surabondante dans le monde, les taux d’intérêt sont extrêmement bas partout. Notre problème n’est donc sûrement pas l’insuffisance collective de l’épargne mais le risque que les politiques monétaires ne touchent rapidement leurs limites. Il faut donc avoir une capacité d’action par la politique budgétaire.
Pour toutes ces raisons, je pense qu’il est utile de continuer à mettre en avant l’objectif de doter la zone euro d’instruments budgétaires.
Jean-Pierre Chevènement
Merci, M. Pisani-Ferry.
Je vous rends un point : la Banque centrale européenne ne s’est pas comportée comme la Bundesbank, mais avec M. Draghi, et parce qu’il s’agissait de sauver l’euro. Mais pour le reste… On nous avait dit que l’euro allait devenir une monnaie internationale de réserve. Or les Allemands ne sont pas du tout prêts à pourvoir les marchés en liquidités. Ils ne veulent pas s’adosser à un marché de bons du Trésor analogue aux bons du Trésor américains. Ils ne veulent pas des eurobonds (euro-obligations). Par conséquent cette perspective qui avait été esquissée au moment où on a approuvé le traité de Maastricht s’est révélée un leurre. En réalité l’euro n’est pas une monnaie internationale de réserve, en tout cas pas de nature à rivaliser avec le dollar.
Jean Pisani-Ferry
En effet, aujourd’hui les conditions ne sont pas réunies.
Pour qu’une monnaie accède au statut de monnaie de réserve internationale, à part la confiance dans l’entité, dans les politiques suivies, dans le système juridique etc., il faut deux conditions qui ne sont pas présentes :
Il faut un actif de référence. Certains disent que ce pourrait être le Bund allemand, ce qui est quantitativement grotesque. Si on regarde la taille du marché allemand par rapport à la zone euro et la taille du marché américain par rapport au marché des obligations du Trésor américain, par rapport au PIB américain, on a une disproportion totale, un facteur qui est de l’ordre de 1 à 10. Il est donc totalement déraisonnable de penser que le Bund allemand pourrait servir d’actif de réserve pour le reste du monde, sauf si l’Allemagne voulait alimenter massivement le marché en obligations d’État, c’est-à-dire changer profondément sa politique budgétaire. Il faut donc bien se poser la question de savoir si on peut constituer un actif de référence à partir des actifs des différents pays participants. Ce ne peut pas être un eurobond au sens d’un actif bénéficiant d’une garantie mutuelle des États participants. Cela reviendrait à échanger des cartes de crédit, ce n’est pas possible. En revanche un certain nombre de réflexions sont conduites sur les autres manières possibles de constituer un actif commun de référence. Donc je ne l’exclurai pas a priori.
Il faut ensuite, comme je l’ai évoqué, que la banque centrale soit disposée, en situation de stress, à fournir de la liquidité à telle ou telle banque centrale partenaire… Supposons que demain la Banque centrale du Brésil (un pays assez intégré économiquement avec l’Europe) décide de faire travailler ses banques en euro. Le jour où ces banques ne peuvent plus se fournir directement sur le marché monétaire de la zone euro et ont besoin d’accéder à la liquidité, n’ayant pas assez de collatéral en euro, il faut qu’elles puissent aller à leur banque centrale pour obtenir de la liquidité en euro contre du collatéral dans la monnaie brésilienne afin de faire face à leurs échéances. C’est exactement ce qui s’est passé dans un certain nombre de pays au moment de la crise, d’où les lignes de swap de la Réserve fédérale à l’égard de certaines banques partenaires. Il faut que nous soyons capables de faire cela, ce qui revient à prendre un risque budgétaire car il y a toujours le risque que le remboursement n’intervienne pas. Or prendre un risque budgétaire n’est pas dans le mandat de la BCE. Il faut donc trouver un arrangement qui permette de couvrir la BCE contre ce risque budgétaire. C’est une innovation par rapport à la manière dont on a conçu la zone euro mais ce n’est pas du tout impossible.
Si on remplit ces deux conditions, on peut renverser les choses par rapport à l’évolution qui a été décrite dans laquelle le rôle international de l’euro s’est affaibli. Tout cela veut dire que nous devons sortir de la philosophie qui a été la nôtre depuis vingt ans – et peut-être à juste titre pour les vingt premières années – qui était : on ne décourage pas. Maintenant on a changé de monde. Il faut peut-être se poser la question de savoir si on encourage.
Jean-Pierre Chevènement
Nous allons poursuivre le débat avec Jacques Sapir
Peut-on et doit-on sortir de l’euro ?
Intervention de Jacques Sapir, directeur d’Etudes à l’EHESS, auteur de Faut-il sortir de l’euro ? (Seuil, 2012), lors du colloque “L’euro vingt ans après, bilan et perspectives ” du lundi 6 mai 2019.
Je remercie la Fondation Res Publica de m’avoir invité.
Sans empiéter sur ce que va dire Christian Noyer, je ferai une série de remarques.
On voit très bien comment l’euro a distordu la compétitivité des pays de l’Union économique et monétaire qui sont obligés de gérer des gains de productivité différents suivant les économies sans la ressource de possibles ajustements des taux de change. On le voit en particulier quand on regarde les différents travaux faits par le Fonds monétaire international, tel l’« External Sector Report » publié en juillet 2017 et juin 2018. On constate aujourd’hui une différence extrêmement importante en termes de taux de change réels, évidemment virtuels, entre l’Allemagne et les pays du Sud (France, Italie, Espagne). L’écart du taux de change réel (REER dans l’acronyme en anglais), est de l’ordre de 25 % à 40 %. Concrètement, cela implique que les produits allemands bénéficient d’une sous-évaluation de plus de 25 % contre les produits français et italiens, et de 10 % à 15 % par rapport aux Etats-Unis et à la zone dollar. Ceci est tout à fait considérable et explique largement l’excédent commercial allemand, que ce soit au détriment des autres pays de la zone euro ou au détriment des puissances hors zone euro. On comprend que les pays qui se trouvent défavorisés par l’euro ne peuvent arriver à stabiliser leur balance commerciale qu’au prix de politiques extrêmement contraignantes au niveau du marché intérieur. Ceci n’est même plus un objet de discussion, c’est un fait établi et extrêmement important.
On constate aussi l’ampleur des divergences entre les différentes stratégies des pays membres de l’Union économique et monétaire. Alors que l’on prévoyait, au début des années 2000, un mouvement de convergence, c’est un mouvement de divergence, et même de divergence accélérée, auquel on a assisté. Dès 2008, il était évident qu’en dehors des taux d’intérêts, il y avait un mécanisme d’euro-divergence entre les pays de la zone euro.
Comme cela a été rappelé à cette tribune, selon le discours dominant à la fin des années 1990, l’euro allait provoquer une énorme zone de croissance en Europe. Cela avait été dit par toute une série de responsables politiques et même par des économistes qui avaient utilisé des travaux économétriques quelque peu controuvés pour chercher à démontrer leur point de vue et qui ont été obligés de faire machine arrière. Je rappelle ainsi que la différence de gains commerciaux dus à l’euro qui existe entre les premiers travaux d’Andrew Rose, publiés en 1997, comme par hasard deux ans avant la mise en place de l’euro, et les travaux qu’il a publiés en 2005-2006 est de l’ordre de 1 à 10. Autrement dit il avait grosso modo exagéré à une échelle de dix les gains potentiels que l’on pouvait tirer de l’euro. Ce qui était commode pour rendre l’euro acceptable, il faut bien en convenir. Ce sont quand même des choses dont il faudrait aussi tirer le bilan. De même, l’euro, loin de nous protéger lors de la crise de 2007-2009, a en fait accéléré le processus d’interconnexion entre les systèmes bancaires de la zone euro et ceux des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. L’exposition des grandes banques européennes au « risque » induit par les titres américains s’est avérée élevée, alors même que le discours officiel prétendait que la zone euro nous protégeait de tels risques. L’écart entre le discours « officiel » et la réalité s’est fortement ouvert de 1997 à 2007, au point que l’on peut considérer que les responsables de l’Union européenne ont vendu du rêve aux peuples, parfois ignorant ce qu’il en était, et parfois le sachant fort bien.
À l’horizon d’une vie humaine, l’Union économique et monétaire, la zone euro, ne sera jamais une nation. En effet, une nation se définit par les institutions politiques, sociales, économiques, sur lesquelles elle est bâtie. Ces institutions sont produites par les conflits politiques, sociaux et économiques dans chaque pays. Tant que le territoire d’un pays sera le cadre privilégié des conflits, et l’on vient encore de le constater avec le mouvement des Gilets Jaunes, il ne pourra pas y avoir d’aboutissement ni même d’émergence d’une nation européenne. Cela a des conséquences parce que l’euro fonctionne moins comme une monnaie que comme un système de gouvernance. Certains de mes collègues italiens, comme le philosophe Diégo Fusaro ou l’économiste Alberto Bagnai, l’ont dit ; je l’avais moi-même dit au début des années 2010. Le fait que l’euro fonctionne comme un système de gouvernance est en réalité un obstacle à des coopérations internationales. Il ne faut pas s’étonner que l’on n’ait pas aujourd’hui des projets comme Airbus ou Ariane, dans différents domaines, comme, par exemple, celui des batteries, ou celui de la transition énergétique. En fait, ces projets ont été portés par des stratégies d’État, par des volontés étatiques s’appuyant sur des entreprises nationales qui d’ailleurs ont été sommées de coopérer entre elles et y sont plutôt bien parvenues. C’est en particulier le cas d’Airbus dont il faut toujours rappeler qu’il a été précédé par le projet Transall qui avait commencé à tisser des liens importants entre les industries aéronautiques française et allemande. Airbus est à la base une coopération bilatérale, qui fut élargie progressivement aux Italiens, aux Espagnols et aux Anglais. Ce n’est nullement un projet européen. Il en va de même pour Ariane, qui succédait à la catastrophe industrielle de la fusée Europa. Ariane a été un projet français, constitué sur l’acquis technologique constitué pour la force de frappe, auquel diverses nations sont venues s’agglomérer. Le type de gouvernance par la norme mis en place par l’euro s’oppose frontalement à la réalisation de ce type de projet. Et ceci est bien l’un des effets les plus catastrophiques de l’existence de l’euro.
On se trouve aujourd’hui face à une impossibilité de transferts, directs ou indirects, entre les pays de l’Union économique et monétaire. Les transferts indirects sont plutôt les transferts privés dont Patrick Artus a parlé. Mais il ne faut pas négliger l’importance des transferts directs entre les États, entre les budgets. Ils sont impossibles parce que les conditions de confiance ne sont pas réunies, parce que les cadres institutionnels restent différents, et parce que les politiques restent extrêmement divergentes.
Il faut ici se demander si l’euro ne joue pas contre l’Union européenne en favorisant des attitudes non coopératives au sein de chaque pays, en favorisant aussi des stratégies du chacun pour soi dans un cadre de concurrence accélérée entre les pays, ce qui par ailleurs me fait très fortement douter que la concurrence puisse être créatrice dans ce genre de situation.
Par ailleurs se pose le problème de la « rationalité des agents ». Plutôt que d’employer le concept creux, vide, de « rationalité », je parlerai de la « cohérence des comportements ». En effet, depuis une trentaine d’années, les bases théoriques de l’hypothèse de la rationalité économique ont été remises en cause, tant au niveau de la psychologie expérimentale qu’à celui de la psychologie économique. Cela ne signifie pas que les agents, qu’il s’agisse des gouvernants ou des responsables d’entreprises privées, agissent n’importe comment. Ils agissent avec une cohérence dictée par des conventions qui peuvent être fausses, comme « Il ne peut pas survenir tel événement » ou « Tel événement ne peut que survenir ». C’est une des formes importantes de comportement et cela explique pourquoi aujourd’hui il n’y a pas de comportement des banques qui, dans la réalité, corresponde au modèle théorique décrit par Patrick Artus. Ce modèle est extrêmement séduisant mais il ne se réalise pas parce qu’il fait fi des comportements des agents et surtout du modèle général de comportement. Une question s’impose : l’existence même de l’euro ne participe-t-elle pas à construire le contexte dans lequel ces comportements réels, si éloignés des comportements de coopération souhaitables, se développent ?
Nous devons aussi considérer les effets de la zone euro, non seulement sur les pays qui en font partie mais aussi au niveau international. Celle-ci est une zone de faible croissance, que ce soit en comparaison avec la dynamique des autres pays européens qui, eux, ont conservé leurs monnaies, ou que ce soit en comparaison avec les principales économies mondiales. Jorg Biböw, un collègue allemand, posait la question de savoir si l’euro n’était pas « a global drag », ou en bon français un frein global. Il l’a certainement été pour les pays de la zone euro, mais il est bien possible que l’effet de freinage enregistré sur une zone économique relativement importante ait eu des effets délétères sur l’ensemble de l’économie mondiale. De plus, l’euro, en raison de la sous-évaluation structurelle du taux de change réel de l’Allemagne, a permis à cette dernière de développer une stratégie mercantiliste, c’est à dire une stratégie prédatrice, dont les effets à moyen et à long terme sont et seront désastreux. Si l’on porte son regard sur l’économie réelle, les effets catastrophiques de l’euro à l’échelle internationale sont évidents.
Enfin, il est clair que l’euro n’a pas réussi à être une monnaie internationale, cela pour plusieurs raisons :
Il y a tout d’abord un problème de méfiance généralisée qui fait qu’aujourd’hui, en termes de poids dans les réserves internationales, l’euro, avec 20 %, est en-dessous de ce qu’était le poids cumulé du franc, du deutsche mark, du florin néerlandais et de la lire italienne (24 % en 1995). Il suffit de regarder les statistiques du FMI (COFER) pour s’en rendre compte.
Par ailleurs, dans le même temps que l’euro n’a cessé de baisser, nous avons vu les « petites monnaies » fortement augmenter. Il y a là un véritable enjeu quand on voit qu’aujourd’hui ces « petites monnaies » représentent globalement 16 % des réserves. Ce n’est pas loin de ce que représente l’euro (20 %).
Pourquoi ces « petites monnaies » se développent-elles alors que l’on prétendait que l’euro serait une alternative puissante contre le dollar ? De fait, c’est bien parce que l’euro a échoué que l’on connaît ce développement. Et cela a des conséquences à l’échelle internationale, en particulier pour les pays de la zone Asie-Pacifique ou pour la Russie.
Dans ce cadre, la Chine arrivera-t-elle à mettre sur pied le projet de monnaie de réserve qu’on lui attribue ? Ce n’est pas sûr, et d’ailleurs il est probable que l’on se trompe sur les ambitions de la Chine. Je pense que les Chinois sont plus intéressés par la constitution d’un système de paiement alternatif au système occidental fonctionnant actuellement. De fait, ils veulent créer une alternative à SWIFT bien plus qu’ils n’entendent promouvoir le yuan. Sur ce point, ils ont l’accord de la Russie, qui a réagi aux sanctions en amorçant un changement tant dans la structure de son commerce extérieur que dans celle de ses réserves. De 2013 (dernière année avant les sanctions) à 2018, la part du dollar a chuté de 66 % à 54,8 % dans le commerce extérieur. Cette chute s’est faite mécaniquement au profit de l’euro mais aussi, à égalité, au profit du rouble et des « autres monnaies », soit essentiellement le yuan chinois. Si la Chine arrive dans les prochaines années à mettre en œuvre son alternative au système SWIFT, l’euro sera contourné et sa part comme monnaie de transaction connaîtra une nouvelle chute.
Enfin, de très nombreux opérateurs se disent qu’il vaut mieux diversifier les risques. Ils vont donc avoir tendance à choisir des monnaies différentes dont chacune n’est pas nécessairement moins risquée que l’euro mais qui, parce qu’elles offrent un panel plus large, assurent une meilleure sécurité par rapport au risque. C’est la raison de l’expansion de la ligne « autres monnaies » dans les réserves des banques centrales, essentiellement d’ailleurs dans la zone Asie-Pacifique mais pas uniquement.
Ce que nous disent ces données c’est que si l’euro peut à un moment donné profiter mécaniquement d’une forme de rejet du dollar, il ne capitalise pas sur son intérêt propre. De fait, une grande partie du monde attend autre chose que le dollar et l’euro, et ce fait même indique que l’euro a perdu la partie non seulement face au dollar mais plus généralement comme monnaie pouvant devenir à terme un pivot de l’économie mondiale.
Quel est alors l’impact de l’euro en termes de politique économique ?
On a parlé des dévaluations internes et de leurs effets négatifs. Là encore je suis plutôt d’accord avec ce qu’a dit Patrick Artus, mais ceci n’est pas nouveau. En fait, nous savons que les dévaluations internes sont une chose mauvaise depuis la publication en 1923 par John Maynard Keynes de son ouvrage A tract on Monetary Reform dans lequel il attaque d’abord les politiques d’austérité, dont il montre bien que les effets induits seront tout à fait négatifs, mais aussi la forme prise par le système monétaire international de son époque, c’est-à-dire l’étalon-or. Quand on relit aujourd’hui ce livre on retrouve des choses tout à fait intéressantes par rapport à notre propre situation. La critique de l’étalon-or porte en effet sur sa rigidité et sur le fait que pour de nombreux pays ce système était perçu comme un obstacle à des dépréciations monétaires quand ces dernières devenaient nécessaires. Or, ceci se reproduit dans la zone euro et l’on peut dire que l’existence même de l’euro conduit les gouvernements des différents pays à des réponses tout aussi inappropriées face à la crise que celles qui étaient dictées par l’étalon-or. L’euro serait-il donc devenu, pour reprendre les termes mêmes de John Maynard Keynes, un « fétiche barbare » ?
La zone euro joue bien aujourd’hui le rôle d’un frein général dans l’activité mondiale comme ceci avait été anticipé par des collègues économistes dans leur ouvrage écrit en 2007 et comme ceci avait été décrit par John Maynard Keynes en 1923 à propos de l’étalon-or. Les seuls qui en profitent sont les banquiers et les rentiers et, là encore, il serait utile à nos responsables de relire ce que John Maynard Keynes écrivait en 1923. Ceci est aujourd’hui essentiellement dû à l’accumulation des politiques plutôt contractionnistes qui sont menées par les grands pays de la zone euro et du fait que la zone euro a encouragé ces politiques de cavalier solitaire. La dévaluation interne réalisée par l’Allemagne entre 2002 et 2005, dont on a déjà parlé, n’a pu se faire que parce que la France faisait exactement le contraire ! Paradoxalement, si l’Allemagne a réussi à imposer à sa population cette politique de dévaluation interne, c’est parce qu’à l’époque la France, mais aussi l’Italie, avaient une politique relativement expansionniste. Ce comportement est typique de la logique du « passager clandestin », et elle n’est possible que parce que nous avons le fameux, et nocif, « marché unique » ainsi que l’euro.
On voit donc que la zone euro contribue, que ce soit en termes de production, de croissance, mais que ce soit aussi en termes de l’accumulation d’une zone de risque avec la situation dans laquelle se débattent les banques italiennes mais aussi certaines des banques allemandes, à freiner globalement l’économie mondiale. Surtout, l’euro empêche les pays de réagir de manière efficace et appropriée aux problèmes qu’ils rencontrent, retrouvant ainsi une dynamique de croissance qui leur serait bénéfique, mais qui bénéficierait aussi à leurs voisins et, de proche en proche, à l’ensemble de l’économie internationale. Il faut donc garder en mémoire que l’euro non seulement conduit à des situations économiques qui sont désormais intolérables dans plusieurs pays de la zone euro, mais aussi qu’il empêche la mise en œuvre d’autres politiques économiques qui pourraient être des solutions efficaces. Sur ce point, il se confirme donc que l’euro est bien non pas une monnaie mais une forme de gouvernance, aux effets pervers, tout comme le fut avant lui l’étalon-or.
Nous, Européens, ne pouvons plus raisonner comme si nous vivions sur une île. Nous sommes dans l’économie mondiale, même si nous pouvons souhaiter que soient établies des écluses pour réguler un certain nombre de courants qui viennent ou qui partent de chez nous. Mais d’une manière générale on ne peut plus penser la croissance à partir de la situation de l’Union européenne.
Tout ceci me conduit à la conclusion que la zone euro n’a pas, et de loin, correspondu aux attentes initiales. Elle n’a réussi qu’à survivre… On peut dire que cela constitue une forme de réussite, et en un sens ce n’est pas faux. Mais il faudrait alors se demander à quel coût, pour les populations et pour l’accumulation des risques qui, s’ils sont aujourd’hui contenus, ne sont nullement éradiqués. L’euro a impliqué, pour survivre aux différentes crises qui l’ont touché, des politiques qui en réalité se traduisent par une accumulation aujourd’hui des risques de crises, crises économiques bien sûr, crises sociales naturellement, mais aussi crises politiques qui deviennent à l’heure actuelle une réalité évidente. L’euro porte la responsabilité des tensions politiques qui s’expriment désormais ouvertement entre les différents pays de l’UE. Nous sommes donc aujourd’hui devant une situation extrêmement inquiétante, que ce soit à l’échelle de la zone euro, ou à l’échelle de chaque pays en faisant partie.
Faudra-t-il persévérer dans cette politique de gestion des risques en sachant que la solution n’est pas à portée d’homme ? On a vu en effet qu’il est impossible aujourd’hui de réaliser les transferts directs ou indirects qui sont nécessaires. Faut-il au contraire dissoudre collectivement la zone euro quitte à la remplacer par des mécanismes de co-fluctuation qui peuvent inclure des clauses de sortie ou de sauvegarde permettant à certains pays, quand ils en ont besoin, de dévaluer de manière importante, quitte après à se rattacher à cet accord de coévolution ?
C’est le choix devant lequel nous sommes placés pour les cinq à dix ans à venir.
Je crains qu’en nous obstinant à faire vivre un système qui n’est pas viable dans le long terme (je ne conteste pas qu’il soit viable dans le court terme) nous n’accumulions les facteurs d’explosions et de crises au point que, quand ces facteurs reviendront de manière décisive sur le devant de la scène, nous ne serons plus en mesure de les gérer.
Jean-Pierre Chevènement
Merci, Jacques Sapir.
Pour vous, l’euro n’a pas répondu aux espérances initialement affichées en matière de croissance, en matière d’emploi, en matière de convergence. Il n’est pas non plus une monnaie internationale qui nous permettrait, par exemple, d’échapper aux conséquences de l’extraterritorialité du droit américain. On le voit en Iran, on le voit en Russie où nous sommes obligés de trouver des méthodes de contournement.
Ce réquisitoire est suivi d’un pronostic : si on se place dans le long terme on ne maîtrise pas tous les facteurs. Comme le dit M. Artus, les crises à venir ne ressembleront pas à celles du passé. Par conséquent, il faut se poser la question de savoir ce que peut devenir l’euro. Je ne crois gère à la dissolution concertée, pour la raison très simple qu’il y a des gens qui trouvent avantage à l’euro. Tous ceux qui ont des actifs sont quand même preneurs d’une monnaie relativement forte et stable, il faut le reconnaître. C’est évidemment moins attrayant pour les smicards et pour les chômeurs. On ne peut donc pas répondre simplement à cette question.
Je sais que M. Noyer a, lui aussi, l’art d’aller aux choses essentielles, donc d’être simple. Je vais donc lui demander de répondre au réquisitoire qui vient d’être dressé par M. Sapir.
Où va l’euro ?
Intervention de Christian Noyer, gouverneur honoraire de la Banque de France, lors du colloque “L’euro vingt ans après, bilan et perspectives ” du lundi 6 mai 2019.
Il est très important – Jean Pisani-Ferry l’a fait largement – de se souvenir des raisons pour lesquelles on a fait l’euro. On peut évoquer la théorie de Robert Mundell sur la zone monétaire optimale mais il faut surtout considérer la réalité vécue dans nos pays. Nous avions un marché commun, puis un marché unique qu’il était très compliqué de faire fonctionner avec des monnaies qui divergeaient. Nous sommes donc passés à un régime de taux de change fixes qui impliquait que lorsque les politiques économiques créaient des divergences ou lors de chocs asymétriques voulus ou causés par les politiques économiques il fallait dévaluer. Or les dévaluations sont coûteuses. Ayant travaillé sur un certain nombre d’entre elles je peux dire que, dans le système européen qui était le nôtre, le vainqueur était celui qui réévaluait structurellement. En effet les dévaluations, toujours trop faibles, arrivaient trop tard. Le pays qui dévaluait au mieux se remettait à parité, recommençait très vite à déraper et était toujours en retard de compétitivité. Ce système a constitué une formidable machine pour soutenir la compétitivité allemande au détriment de la situation de la France, de l’Italie, des pays qui essayaient de suivre. Un tel système ne marche que pour un pays qui impose une discipline de fer et qui est le meilleur ou à l’égal des meilleurs. Les autres sont perdants.
C’est ce qui a amené François Mitterrand à penser qu’il valait beaucoup mieux, non seulement que nous partagions la décision, comme l’a relevé Jean Pisani-Ferry, mais que nous entrions dans un système où nous n’aurions plus ce problème de dévaluation, grâce à une politique monétaire unique dont nous tirerions les bénéfices. À l’origine de la monnaie unique, il y avait donc la difficulté de faire fonctionner un marché unique totalement intégré avec des monnaies qui fluctuent sans arrêt. Alors que j’étais Gouverneur de la Banque de France, j’étais allé présenter mon rapport annuel au Président de la République, qui était alors Jacques Chirac. « J’aimerais quand même savoir à quoi sert l’euro ! » me dit-il dans la conversation. Je lui répondis : « Monsieur le Président, souvenez-vous du veau italien… ». « Ah oui ! Qu’est-ce que les Italiens nous ont em… avec leur veau ! ». En effet, en cas de dévaluation, des distorsions se créaient sur les marchés et le pays qui avait dévalué reperdait très vite sa compétitivité s’il n’avait pas une politique économique adaptée.
Que nous a apporté l’euro ?
D’abord – c’est l’ex-banquier central qui parle – l’euro nous a apporté la stabilité des prix. Il faut se souvenir que nous avons vécu pendant des décennies avec une inflation non négligeable. Tous les travaux sérieux montrent que l’inflation pèse beaucoup plus défavorablement sur les catégories les plus modestes de la population que sur les plus aisées qui arrivent toujours à se protéger avec des investissements diversifiés et des stratégies adaptées. Ceux qui souffrent sont les catégories modestes de la population et les petites entreprises. L’euro nous a évité l’inflation mais aussi la déflation malgré les deux crises successives, mondiale et européenne, les plus fortes qu’on ait connues après la Deuxième Guerre mondiale. Et les anticipations inflationnistes ont disparu. C’est incontestable.
Nous avons aussi bénéficié de l’intégration des marchés. Quand j’étais à la BCE, j’ai connu l’époque bénie où nous avions réussi totalement l’intégration du marché financier et monétaire, cela pendant douze ans. On ne peut donc pas dire que c’est impossible, que l’euro ne peut pas le faire. Les banques se prêtaient entre elles. Les compagnies d’assurance diversifiaient leurs portefeuilles, l’Asset management était un peu en retard mais on commençait quand même à faire des SICAV européennes ou des fonds communs de placement de valeurs européennes que les gens achetaient, qui n’étaient pas seulement en actions mais aussi en obligations. Bref, cette intégration fonctionnait bien et les flux monétaires circulaient.
Cela s’est arrêté avec la crise pour les raisons qui ont été dites. D’abord parce que les opérateurs ont pris peur. L’exemple typique est celui des compagnies d’assurance allemandes. Elles détenaient beaucoup de dette publique de l’ensemble des pays de la zone euro, notamment de l’Italie parce que c’est un grand marché. Au moment où les bonnes feuilles de chou et un certain nombre de gens sur les ondes expliquaient que l’Italie allait sortir de la zone euro elles ont tout vendu, même à perte, et se sont repliées sur des Bund allemands. Aujourd’hui, ces compagnies d’assurance qui, dans le cadre de contrats équivalant aux contrats en euro que l’on connaît, ont des engagements de rémunération minimum de 1 %, 2 %, 3 % (nous en avons très peu en France aujourd’hui mais ils ont perduré en Allemagne) ont investi massivement dans les obligations allemandes qui rapportent 0 %, voire ont un rendement légèrement négatif. Ces compagnies d’assurance risquent toutes la faillite ou d’être dans l’incapacité d’honorer les contrats qu’elles ont signés avec leurs clients, cela parce qu’elles ont arrêté d’acheter des titres italiens. Cette situation ne peut pas continuer. Il est évident qu’il faut revenir à la diversification. Mais ne disons pas qu’il faut créer quelque chose qu’on n’a jamais connu. Il faut arriver à recréer ce qu’on a eu assez bien pendant douze ans et qui a été détruit par la crise.
L’euro est quand même un formidable outil de sécurité et de liberté pour les citoyens. Dirons-nous aux jeunes générations qui ont pris l’habitude de circuler partout en Europe avec une monnaie unique sans se poser de questions et avec des coûts de transactions très faibles ou d’envoyer de l’argent avec des coûts qui ont considérablement baissé que l’on va repasser à des monnaies différentes et qu’elles vont perdre cette liberté ? Dirons-nous aux tout petits entrepreneurs qui arrivent à exporter ou à faire du commerce frontalier sans aucun problème de change qu’ils vont perdre ces facilités ? L’euro est d’ailleurs très populaire, à tel point qu’un certain nombre de mouvements ont renoncé à inscrire sa disparition dans leur programme par crainte de perdre le soutien de leurs électeurs.
J’entends que l’euro n’a pas été une grande réussite économique. Il y a sûrement eu des exagérations ou des emballements, comme si l’euro allait nous apporter une croissance formidable sans faire aucun effort !
Depuis la création de l’euro, l’évolution du PIB par habitant en zone euro est comparable à celle des États-Unis et ou du Japon. Or c’est le PIB par habitant qui mesure la richesse de chacun.
Les divergences d’inflation existent mais elles sont sans commune mesure avec ce qu’elles étaient dans la période précédente et elles ne sont guère supérieures aux différences d’inflation entre les douze grandes régions économiques des États-Unis.
Les différences de croissance et de richesse sont importantes. Elles se réduisaient fortement pendant la période de convergence, avant l’adoption de l’euro dans chaque pays, puis elles ont été assez stables pendant une douzaine d’années avant de recommencer à diverger depuis peu. Mais, même en prenant deux cas extrêmes, on voit que la différence de richesse et de croissance entre la Grèce et l’Allemagne est inférieure aujourd’hui à ce qu’elle est entre le Mississipi et le Massachusetts. Ce n’est donc pas un échec total. Je ne dis pas que la situation est satisfaisante, certes on aimerait que la Grèce converge avec l’Allemagne, mais on ne peut pas prétendre que les États-Unis sont le nirvana et la zone euro l’enfer !
La devise ne s’est pas internationalisée, c’est un échec total, nous dit-on. Je suis en total désaccord avec cette affirmation ! Certes l’euro n’est pas l’égal du dollar… Mais est-il si important d’avoir une devise internationale ?
Quand j’étais à la BCE, la doctrine de la BCE et des gouvernements était la neutralité, le laisser-faire, on laissait les marchés décider. Quand on voit aujourd’hui l’utilisation impérialiste du dollar comme substrat à l’imposition des normes juridiques américaines en extraterritorialité et ses conséquences dans de nombreux domaines, on se dit qu’on ne peut plus continuer à laisser faire la domination du dollar dans le monde. Les Chinois sont absolument sur cette ligne. Il s’agit de savoir si on veut avoir le choix dans vingt ans entre le dollar et le renminbi ou si on veut avoir une monnaie européenne. Or si l’euro est aujourd’hui beaucoup moins important que le dollar, il est de très loin la deuxième devise et la seule autre grande devise internationale. [J’entends parler de la diversification des réserves de change dans les « petites monnaies » … Il y a quand même le yen, le sterling, le dollar canadien, le dollar australien et un peu le renminbi depuis peu mais c’est quand même très restreint.]
La part relativement faible de l’euro dans les réserves de change s’explique assez bien :
Avant l’euro, par définition, tout le monde avait des réserves de change dans les autres devises de ce qui deviendrait la zone euro, notamment en mark. La Banque de France avait du mark dans ses réserves de change. Faute de mark, pour avoir des réserves de change, elle a dû acheter du dollar. Il en est de même pour l’Italie et les autres États. La BCE elle-même a des réserves en dollar et un peu en yen, essentiellement. La part du dollar a donc augmenté considérablement dans les réserves européennes.
On ne peut pas comparer ce qu’étaient les réserves de change il y a vingt ans et ce qu’elles sont aujourd’hui. Entre temps il y a eu la croissance des marchés émergents qui sont devenus les grands détenteurs des réserves de change. Les marchés émergents ont essayé jusqu’à maintenant de contrôler l’évolution de leurs devises par rapport au dollar. La Chine a d’abord constitué ses réserves de change essentiellement en dollar (maintenant elle diversifie et elle a acheté pas mal d’euro) parce que c’était le moyen de contrôler étroitement l’évolution de sa devise par rapport au dollar. Il en est de même pour les pays d’Amérique latine et un certain nombre de pays d’Asie, sans compter ceux qui sont dans un taux de change fixe avec le dollar et ont des réserves importantes, comme Hongkong ou d’autres.
Dans ces circonstances, le fait que l’euro fasse 20 % des réserves de change mondiales aujourd’hui, c’est-à-dire beaucoup plus en montant que les 25 % ou 30 % qu’on avait cumulés il y a quinze ou vingt ans, prouve que l’euro est une monnaie très crédible, très respectée et très utilisée.
Dans les émissions internationales faites par le secteur privé (entreprises, banques etc.), l’euro est à peu près l’équivalent du dollar. Ce sont les deux seules grandes monnaies qui sont utilisées pour les financements. Quand on regarde les monnaies d’investissement, le dollar est plus important, dans des proportions de 1 à 2, rien qu’on ne puisse renverser ou améliorer. Et cela dépend en partie des taux d’intérêt. Il se trouve qu’en ce moment les taux d’intérêt à long terme sur le dollar américain sont plus intéressants que les taux européens, ce qui génère un certain nombre de flux d’investissements. Au moment où la relation des taux d’intérêt a été dans l’autre sens, la part de l’euro était beaucoup plus élevée, la part du dollar plus faible.
Au regard de tous ces éléments, l’euro est aujourd’hui (en dehors du dollar) la seule autre monnaie crédible dans le monde. Nous pouvons parfaitement en faire une monnaie internationale. C’est une question de volonté politique.
Je partage néanmoins en partie beaucoup des analyses qui ont été faites. C’est pourquoi je reviendrai sur les faiblesses de l’euro et la possibilité de les corriger.
Un mot sur le pacte de stabilité. Sans contester du tout l’analyse qui a été faite par Patrick Artus et Jean Pisani-Ferry sur les externalités, je dirai qu’elle date un peu. Il faut avoir conscience que si le pacte de stabilité n’existait pas, les marchés feraient la discipline. En effet, les États de la zone euro ne seraient soumis à aucune règle budgétaire et en cas de faillite, personne ne viendrait à leur secours. On devine ce que serait la réaction des marchés après l’épisode grec. On m’objectera que, de toute façon, les marchés font la discipline, ce qui bride les choses. Mais je crois très important de bien avoir en tête que les récriminations contre les règles du pacte de stabilité sont datées par un certain nombre d’aspects. On peut considérer que c’est moins important aujourd’hui mais, si on admet que les États peuvent faire faillite, les marchés vont surveiller. Je ne parle pas des méchants gnomes de Zurich ou de New York mais des gestionnaires de vos contrats d’assurance-vie, de vos caisses de retraite, les gestionnaires de vos investissements d’une façon générale. S’ils perdent une fraction importante de leurs investissements ils devront répercuter ces pertes sur leurs investisseurs (Désolé, vous avez investi 100 dans votre contrat d’assurance-vie, vous espériez sortir avec 110, vous allez sortir avec 60 parce que j’ai perdu 40 sur la dette de l’État X qui a fait faillite et qui n’a rien remboursé !). C’est d’ailleurs là que la diversification se révèle précieuse parce que quand on ne détient qu’une petite fraction de la dette d’un État qui fait faillite ce n’est pas trop grave. De même, si on a pris un risque sur une entreprise qui fait faillite, si toutes les autres entreprises dans lesquelles on a investi dans un portefeuille global sont profitables, l’industrie s’est développée, des emplois ont été créés, l’activité s’est développée et la perte est absorbée par les gains qu’on a faits sur les autres. C’est ainsi que s’applique le principe d’une mise en commun et d’une répartition d’investissements.
À propos de la surveillance macro-économique je suis assez d’accord avec l’analyse qui a été faite. J’aurais pris des termes un peu moins vifs que ceux qu’a utilisés Jacques Sapir mais sur le fond je suis d’accord avec ce qu’ont dit Patrick Artus et Jacques Sapir. Oui, il y a un excédent allemand (un excédent aussi des Pays-Bas, plus complexe à analyser) qui génère un excédent de la zone euro qui freine l’économie mondiale dans un contexte de défaut d’investissement et d’excès d’épargne. C’est contraire aux règles du FMI, parce que si nous étions en taux de change flottants, si l’Allemagne n’était pas dans la monnaie unique, elle serait obligée de réévaluer ou se réapprécierait et son excédent se résorberait par le rééquilibrage des taux de change. Dès lors qu’elle a choisi d’être dans une monnaie unique, elle doit suivre un certain nombre de règles : ne pas accumuler d’excédents trop importants donc faire ce qu’il faut pour recycler les capitaux et réduire son épargne, ce qui n’est pas commode car l’épargne est inhérente à la culture allemande. Au moins l’État pourrait-il éviter de rajouter à l’épargne naturelle que génèrent les autres agents économiques et faciliter le recyclage des capitaux à l’intérieur de l’Europe.
Nous avions un marché très intégré qui a disparu en partie, en tout cas en ce qui concerne le marché monétaire. Les restrictions imposées par les États et les régulateurs juste après la crise n’ont pas encore été levées. UniCredit ne peut toujours pas transférer de liquidités d’Allemagne en Italie. Cela crée une situation absurde : des épargnants italiens méfiants vont déposer leurs fonds dans la filiale allemande de leur banque UniCredit. Mais UniCredit ne peut pas ramener les fonds en Italie parce qu’il lui est interdit par les autorités allemandes de refinancer les crédits des Italiens. Nous sommes dans une situation profondément anormale que je dénoncerais publiquement si j’étais encore à la BCE.
On justifie souvent cette absurdité par la garantie des dépôts, un volet de l’Union bancaire qui n’est pas encore achevé : comme la garantie des dépôts allemande serait mise en cause en cas de faillite, on est obligé de surveiller les flux etc. Pour moi, c’est une mauvaise raison. Il faut rétablir la possibilité des transferts.
On retrouve les mêmes absurdités dans les règlements bancaires : on considère que l’investissement d’une banque française en Allemagne ou en Italie est aussi risqué que l’investissement d’une banque française au Chili ou en Birmanie, ce qui nécessite des couches de capital de protection supplémentaires. Nous sommes loin d’être arrivés au stade d’une Union bancaire reconnue. Il reste énormément de travaux à faire.
Je terminerai sur l’idée de symétrie des politiques. Nous avons des politiques économiques qui imposent un ajustement très fort. Mais s’il n’y avait pas de monnaie unique, s’il n’y avait pas d’euro et si l’État avait sa propre monnaie, il serait obligé d’aller chercher l’aide du FMI qui lui imposerait une politique du même genre, peut-être même plus dure, pour avoir une chance d’être remboursé, pour que l’économie se rétablisse.
L’euro apparaît-il viable dans le futur et à quelles conditions ?
Selon la conception anglo-saxonne, une monnaie unique sans souverain ne peut pas fonctionner. Je crois fondamentalement que l’euro peut avoir un avenir, à condition évidemment que l’on corrige tous les défauts cités et que l’on accepte un degré d’intégration un peu plus fort en ciblant bien les domaines.
Beaucoup d’idées ont été émises à cette table. J’approuve la préconisation de cibler une intégration des marchés de capitaux plutôt qu’une intégration budgétaire plus poussée.
Dans une union monétaire les coûts, en moyenne, évoluent à un rythme conforme aux objectifs de la Banque centrale. Si l’inflation moyenne prévue à horizon de temps indéfini est de 2 % par an et si les gains de productivité sont de 1 %, les coûts de l’économie ne doivent pas augmenter de plus de 3 % en moyenne. Quand un pays les laisse galoper, comme ce fut le cas en Grèce, à 6 % ou 8 % par an en augmentant les salaires dans le secteur public (ces augmentations sont suivies par le secteur privé qui perd des emplois, perte compensée par de nouvelles embauches dans la fonction publique etc.), il crée une économie totalement artificielle. Il est refinancé par les fonds européens et par les flux de capitaux qui arrivent. Le jour où les flux de capitaux s’interrompent, il sombre dans une crise grave.
On ne peut pas garder ses emplois, les développer, rester compétitif, développer ses activités si on n’a pas une gestion des politiques de coûts qui soit à peu près en ligne avec l’inflation plus les gains de productivité que l’économie est capable de susciter. Dans une économie en rattrapage, on tente de faire plus de gains de productivité pour que le niveau de vie augmente plus vite. C’est ce qu’obtiennent les pays émergents, c’est ce que devraient obtenir les pays les plus en retard dans la zone euro. Mais cela suppose une gestion très sérieuse.
Risque-t-on d’avoir des pressions politiques très fortes poussant à la sortie de l’euro ?
Je crois vraiment que si l’euro devait échouer, ce serait contre la majorité des populations qui y sont assez attachées. On l’a vu récemment en Italie, les gens ne veulent pas perdre l’euro et les partis qui songent à la sortie de l’euro ne sont en général pas populaires. D’ailleurs beaucoup de partis politiques y renoncent.
D’autre part, une sortie de l’euro aurait un coût considérable. C’est la vraie raison pour laquelle la Grèce est restée dans l’euro. Les dirigeants grecs qui, pendant les campagnes électorales, préconisaient la sortie de l’euro ont réalisé que cela aurait un coût rédhibitoire. En effet, un pays qui sort d’une union monétaire et reprend sa monnaie nationale subit une énorme dépréciation. Dans le cas de la zone euro, le stock de dettes du pays sortant est libellé en euro. S’il décide de relibeller son stock de dettes dans la nouvelle devise au taux de change antérieur, ce sera analysé comme un défaut par les marchés qui cesseront de lui faire confiance donc de lui prêter. De même, s’il décide de renier une partie de sa dette, les marchés cesseront de lui prêter. S’il décide de garder ses dettes en euro, le coût sera insupportable en raison de la dépréciation. C’est donc un piège absolu. Un pays que les marchés cessent de financer doit pour survivre équilibrer du jour au lendemain son compte courant. Il doit d’abord équilibrer son budget car personne ne viendra financer son déficit budgétaire en cas de dévaluation. Pour que son compte courant soit équilibré, les exportations doivent compenser les importations, ce qui impose soit des barrières drastiques contraires à la liberté de circulation des marchandises, des biens, des services etc. soit une politique d’austérité bien plus sévère que celle qui fut infligée à la Grèce pour forcer la consommation à baisser brutalement. Le coût est tellement gigantesque qu’il est dix fois plus doux de faire ce qu’a fait la Grèce, cent fois plus doux de faire ce qu’ont fait l’Espagne et le Portugal, plutôt que de rentrer dans un scénario de sortie de l’euro. En effet, si vous décidez de sortir du jeu, vous payez en une fois la « mauvaise gestion » accumulée pendant plusieurs années. Les marchés vous présentent la facture immédiatement. C’est donc une solution à laquelle je ne crois pas.
Je crois beaucoup plus que nous irons vers une amélioration, la réparation des dysfonctionnements évoqués.
Comment l’union politique va-t-elle évoluer ?
Je me souviens très bien des discussions qui avaient lieu à l’époque du Comité Delors. Le Chancelier Kohl et son entourage, mais également Hans Tietmeyer, alors sous-gouverneur de la Bundesbank, considéraient que, à court terme, on pouvait concéder à François Mitterrand une union économique et monétaire sans union politique mais que, à long terme, si on ne voulait pas ou si on ne pouvait pas aller vers une intégration des fonctions souveraines, il faudrait au moins que dans la politique économique il y ait beaucoup plus d’intégration.
Aujourd’hui les Allemands ont changé d’avis. La population cherche avant tout à éviter le risque de payer pour les Italiens ou je ne sais qui. Cette attitude « petit bourgeois » n’est pas du tout dans la tradition des Allemands qui ont pensé l’union économique et monétaire et qui, dès le départ, auraient voulu beaucoup plus d’intégration et de centralisation, non seulement sur les politiques budgétaires mais sur beaucoup d’autres aspects. Quand on réfléchit avec eux sur des mécanismes de mise en commun qui pourraient provoquer une redistribution automatique de fonds, les discussions portent souvent sur l’assurance-chômage. Tout le monde paye les mêmes cotisations, reçoit les mêmes prestations, les transferts de fonds se font donc des pays qui se portent bien, dont le taux de chômage est faible, vers les pays en difficulté qui connaissent un fort taux de chômage, à charge de revanche quand les choses auront changé. Ce mécanisme automatique, public, ne concerne pas vraiment le budget mais fait sens. Je me suis toujours heurté à la même objection quand je défendais ce genre d’idée, notamment de la part d’amis allemands : si un pays mène une politique économique qui évidemment va dans le mur et crée du chômage et si structurellement on lui envoie des fonds, on lui permet de continuer de payer les chômeurs créés par sa propre mauvaise politique économique… On peut comprendre cette crainte : si un pays augmente massivement les salaires à travers différents mécanismes et devient non compétitif, il détruit un certain nombre d’emplois et bénéficie de l’assurance chômage aux dépens des citoyens des pays qui payent. Cela suppose donc toute une réflexion, un débat, une coordination sur les taux de rémunération, par exemple du SMIC. Cela ne signifie pas que le SMIC doive être le même partout parce que les niveaux de productivité, les niveaux de richesse sont différents, les évolutions démographiques sont différentes, donc les besoins de création d’emplois peuvent être différents. Mais il faut une réflexion coordonnée là-dessus et sur beaucoup d’autres aspects.
C’est pourquoi je pense que nous aurons besoin de plus d’intégration. Mais ceci peut nous entraîner assez loin, même en restant purement dans le domaine économique.
Jean-Pierre Chevènement
Merci, Monsieur le Gouverneur, pour ces observations nourries par l’expérience.
Vous avez dit que la capacité pour l’euro de devenir une monnaie internationale est « une question de volonté politique ». Mais quand on regarde, pour les raisons techniques que j’ai déjà évoquées mais aussi pour des raisons politiques, ce qu’est l’attitude de l’Allemagne par rapport aux États-Unis, on voit bien que l’Allemagne n’est pas du tout en mesure de se frotter à la puissance militaire et monétaire globale. Les Allemands ont très peur, par exemple, de la taxation de leurs excédents automobiles, ce qui limiterait forcément leurs velléités d’indépendance si d’aventure nous souhaitions contourner l’embargo sur l’Iran. C’est pourquoi je ne crois pas beaucoup à cet aspect « volonté politique ».
Christian Noyer
Nous sommes confrontés aujourd’hui au cas extrême d’une extraterritorialité qui a été inscrite dans la loi américaine à la demande du Président et par le Congrès sans même une référence au dollar, alors qu’auparavant nous étions dans une jurisprudence du Département de la Justice (DOJ) qui utilisait l’argument du dollar pour prétendre à l’universalité d’application de l’extraterritorialité des lois américaines, avec d’ailleurs quelques résistances de certains tribunaux fédéraux, voire, dans un cas, de la Cour suprême des États-Unis. Cela paraît clair.
En revanche, l’idée (qui commence à être nourrie par beaucoup d’exemples) que toute relation commerciale, financière, tout usage des données, est susceptible du jour au lendemain de subir les foudres d’une nouvelle législation américaine, d’une nouvelle interprétation judiciaire américaine est quand même quelque chose d’insupportable, ce que même l’Allemagne devrait pouvoir comprendre.
Autant, comme vous, je ne vois pas l’Allemagne partir en guerre contre une loi extraterritoriale et prétendre imposer une loi européenne extraterritoriale interdisant sous des peines criminelles extrêmement sévères l’application de l’extraterritorialité américaine, autant je pense que les Allemands sont maintenant plus ouverts à ce que, de fait, on construise une plus grande internationalisation. Et l’idée que demain, dans un monde qui serait devenu bipolaire (États-Unis / Chine) sur le plan de la domination monétaire, l’Europe pourrait ne pas avoir sa place, est quelque chose qui les interroge beaucoup plus que la simple domination de la monnaie d’un grand allié à l’Ouest.
Débat final
Débat final lors du colloque “L’euro vingt an après, bilan et perspectives” du lundi 6 mai 2019.
Jacques Fournier
Personne n’a parlé de la situation des pays de l’Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro. Le Brexit a peut-être une liaison avec notre sujet.
Comment ces pays ont-ils vécu la coexistence avec la zone euro ?
Quelle comparaison peut-on faire entre leur sort et celui des pays de la zone euro ?
Gérard Lafay
J’ai été surpris que, dans la discussion, personne n’ait évoqué le risque de crise financière mondiale qui ne peut être écarté quand on voit l’explosion des risques spéculatifs et qui affecterait aussi l’euro.
Jean-Pierre Chevènement
Théoriquement, tous les pays qui ont signé le traité de Maastricht devraient avoir adopté l’euro. Mais ce n’est pas le cas, et il y a évidemment des distorsions de concurrence tout à fait frappantes avec les pays de l’Est.
Patrick Artus
En général, et pas seulement dans la zone euro, les petits pays à la marge d’une grande union économique et monétaire (le Canada, la Suède etc.) se portent très bien. En effet ils profitent de l’union économique et monétaire et font, par le taux de change, une politique contracyclique vis-à-vis de cette union. Quand les États-Unis vont mal, les Canadiens déprécient le dollar canadien, ils vont donc moins mal que les États-Unis, et quand les États-Unis vont bien, ils profitent de ce que les États-Unis vont bien. En fait, les petits pays limitrophes d’une grande union monétaire bénéficient d’une situation de passager clandestin assez sympathique. Les Suédois ont donc raison de ne pas rentrer dans la zone euro. Ils profitent de l’existence de l’euro tout en gérant leur taux de change.
Christian Noyer
Nous sommes quand même passés à travers la plus grande crise financière depuis les années 1930 et nous nous sommes assez bien sortis de la crise internationale financière mondiale entre 2008 et 2011.
La première crise a fait prendre conscience à tout le monde qu’il y avait un lien – qu’on avait oublié ou qu’on ne voulait plus voir – entre les États et les banques. Si les États faisaient faillite, et si le bilan des banques comportait une quantité importante de titres d’États, les banques, en difficulté, ne pouvaient être sauvées que par une intervention publique donc des États ! L’attention s’est ainsi portée sur les États qui avaient des finances publiques fragiles et des niveaux de dette trop élevés. C’était, en zone euro, le cas de la Grèce. On a pris conscience que ce risque concernait tous les États qui ont des taux de croissance trop faibles (parce qu’ils ont perdu de la compétitivité faute d’avoir veillé à l’évolution de leurs coûts), des niveaux de dette publique trop élevés ou d’autres types de fragilités. Tous les pays émergents sont peu à peu tombés dans ces difficultés. Nous nous en sommes sortis.
Je ne crois pas au risque d’une nouvelle crise économique et financière du type de celle qu’on a connue en 2008… ou alors la politique économique dans le monde serait vraiment très mal gérée ! D’autre part nous avons quand même réparé énormément de choses depuis cette crise. Si nous sommes passés à travers 2008, je ne vois pas pourquoi l’euro ne passerait pas à travers d’autres crises financières. En revanche nous avons des défauts à corriger qui sont plus importants.
Jean Pisani-Ferry
Je crois qu’il ne faut rien imposer aux pays de l’Union européenne qui ne sont pas membres de la zone euro. En tout cas, il ne faut pas leur imposer de devenir membres. Si on a appris quelque chose dans cette crise, c’est à quel point il est exigeant de participer à la zone euro. Donc je ne pense pas qu’il faille l’imposer à un pays qui considère qu’il n’est pas prêt à le faire, concrètement la Pologne ou la République tchèque. On peut lui imposer de ne pas mener des politiques non coopératives mais pas de participer à la zone euro. D’ailleurs, ceux qui se sont précipités dans la zone euro (les Pays baltes, Chypre…) l’ont fait parce qu’ils avaient le sentiment – sans doute pas complètement infondé – que leur sécurité serait mieux garantie s’ils étaient membres de la zone euro.
Jean-Pierre Chevènement
Je remercie très sincèrement tous nos intervenants, qui ont été très brillants, pour leurs exposés de grande qualité, remarquablement construits. Et je vous donne rendez-vous pour le quarantième anniversaire de l’euro en 2039.
Le cahier imprimé du colloque “L’euro vingt ans après, bilan et perspectives” est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la Fondation.
Source : Res-Publica, 29-07-2019