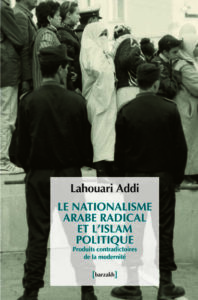ALMANACH-DZ.COM
Essai de Lahouari Addi. Editions Barzakh, Alger 2017.800 dinars,287 pages.
Un ouvrage dont le contenu est le fruit d’ enseignements dispensés et d’ un projet de recherche portant sur les régimes politiques du monde arabe et sur les deux grandes idéologies à forte mobilisation populaire : le nationalisme radical et l’islamisme. Deux idéologies politiques jumelles et rivales, portées toutes deux , à des époques différentes , par la même énergie populaire de contestation de l’ordre politique
Une analyse qui fait appel à l’histoire pour situer les événements fondateurs, mais reposant principalement sur la sociologie politique à travers le concept de représentation qui fonde la légitimité de l’ordre politique rêvé ou désiré.
En quelques décennies, le nationalisme arabe radical (mené généralement par des élites « républicaines », souvent militaires et avec des emprunts -qui remontent aux courants libéraux de la fin du XIXè siècle – ,au niveau de leur grammaire idéologique à l’idéalisme allemand, et au niveau de leur rhétorique du « socialisme arabe » au marxisme révolutionnaire) est passé du triomphe (en Egypte, en Irak, en Algérie, en Syrie, au Yémen, en Libye) au déclin. Tout cela face à des monarchies dont les intérêts politiques convergeaient avec ceux des puissances occidentales ; et monarchies encourageant, déjà à partir des années 70 , l’expansion de l’islamisme utilisé comme une arme idéologique. La hausse des prix des hydrocarbures depuis 1973 allaient vite enrichir et transformer les dites monarchies en véritables puissances régionales…..soutenant les rebellions, prenant ainsi leur revanche sur des régimes qui ,quelques années auparavant, les accusaient de trahir les peuples arabes.
Le « retour de manivelle » est brutal, pour presque tous : épuisement ou mort du nationalisme arabe radical certes, mais permanence du populisme de type autoritaire, s’exprimant désormais à travers l’islam politique qui ambitionne de réaliser les objectifs du nationalisme arabe radical en appliquant et/ou voulant appliquer – bien souvent en dehors de ses terres et par tous les moyens , même les plus violents , une Chari’a mal interprétée.
Beaucoup de questions surtout liées à l’avenir des pays arabes. Pas mal de réponses apportées ou de pistes dégagées par l’auteur…….qui revient, une fois de plus, en fin d’ouvrage, à l’idée de « régression féconde » car, dit-il, « le problème est que, sans eux (les islamistes), il n’y aura pas de transition démocratique du fait même de leur poids électoral ». Une idée qui ne tient pas (plus) compte, me semble-t-il, des immenses dégâts, de toutes sortes, causés , ces dernières années et aujourd’hui encore, par l’ « islamisme politique »….assurément défendu en raison de la grande méfiance, pour ne pas dire plus, à l’endroit de l’ « autoritarisme militaire »…..et qui ne tient pas compte des changements de comportements sociétaux observés ces toutes dernières années. Une idée qui confond religiosité ambiante et mimétismes comportementaux changeants et islamisation durable.
L’auteur : Professeur de sociologie (Iep de Lyon) , ancien chercheur associé au Crasc d’Oran……auteur de plusieurs publications consacrées à l’Afrique du Nord et l’islam politique…..ainsi que du désormais « fameux » concept de « régression féconde »….sur laquelle il revient
Extraits : « Depuis la moitié du XXè siècle, les pays arabes sont en attente d’un changement qui leur apporterait progrès et sécurité. Hier, c’étaient les nationalistes qui promettaient de réaliser cette attente ;aujourd’hui, ce sont les islamistes » (p 20), « Un secteur public est certainement une nécessité dans des pays sous-développés où le capital privé est porté à la spéculation et faiblement présent dans l’industrie. Il n’est cemendant efficace ou rentable que si la justice est indépendante du pouvoir exécutif pour éviter qu’il soit le lieu de la prédation, du gaspillage et de la corruption » (p 61), « Les sociétés musulmanes n’ont pas réalisé que l’individu est né et qu’une nouvelle morale est à inventer , basée non pas sur la raison et la justice, mais sur la conscience et la liberté » ( p 152), « L’islamisme est un populisme……qui présente des similitudes avec le nationalisme arabe radical ou avec les populismes d’inspiration marxiste, fondés sur les utoppies révolutionnaires qui fascinent les masses populaires dans des périodes de crise économique et sociale » (p 200)
Avis :Une approche analytique et critique apportant indéniablement des éclairages (des clés ?) utiles pour comprendre (et affronter ?) la société « arabe » embourbée dans le nationalisme radical d’hier et l’islamisme politique d’aujourd’hui.
Citations : « Une nation n’est pas seulement un territoire avec des frontières géographiques protégées par des militaires ;c’est surtout l’espace d’une société civile qui aura désacralisé la politique, sécularisé le droit et affirmé son autonomie par rapport à l’Etat dont les dirigeants rendent des comptes à leurs électeurs dans un système pacifique d’alternance électorale « (p 25), « Le modèle populaiste est marqué par une contradiction majeure : la sphère de la production et de l’échange, à vocation privée , est publique, et la sphère de l’Etat, à vocation publique , est privatisée » (p 63), « La politique, ce ne sont pas que des idées et des projets qui attirent l’opinion, ce sont aussi des ressources matérielles qui créent un rapport de force disqualifiant les idées des concurrents » (p 107), « Etant une ressouce du nationalisme, la religion divise parce qu’il y aura toujours une personne-ou un groupe de personnes – qui se sentira plus proche de Dieu que les autres » (p 115), « L’islamisme n’est ni l’expression d’un retour du religieux, ni d’un schisme ;c’est un mouvement socioculturel et politico-idéologique répondant à la déstructuration des sociétés musulmanes, suite à leur insertion dans la modernité qu’elles subissent et dont elle ne maîtrisent pas les dynamiques » (p 138), « Plus la réalité est dure, plus le rêve susceptible d’y échapper est magique » (p 191), « L’idée que la puissance de l’Etat est d’abord intellectuelle ne peut pas être comprise par un militaire pour qui l’avenir des nations se décide par les armes » (p 278), « Si le nationalisme radical a militarisé la politique, les islamistes ont politisé la religion pour délégitimer leurs adversaires « (p 278)
Lahouari Addi tord le cou aux fantasmes idéologiques des nationalistes et des islamistes
Lahouari Addi, sociologue mais surtout intellectuel connu pour son audace et la radicalité philosophique de ses visions, renverse la table de l’Histoire sur les tenants des idéologies nationaliste et islamiste en démontrant, exemples à l’appui, leur impertinence philosophique, en en dévoilant leurs mortelles contradictions et, partant, leur caractère fantasmatique. Plus concrètement, dans un nouvel ouvrage paru aux éditions Barzakh, Nationalisme radical et islam, produits contradictoires de la modernité, il démontre la relation d’intimité qu’il y a entre l’islamisme et le nationalisme d’abord avant d’expliquer les mécanismes de leur autodestruction. Dans un premier temps, il cerne l’histoire et l’héritage politiques du nationalisme arabe radical en démontrant, à travers des exemples dépouillés, que celui-ci était, dès l’origine, porteur de limites idéologiques qui l’ont empêché d’être le moteur du développement économique et culturel dans les pays où il a prospéré. En effet, les régimes dont il était le ciment et le ferment faisaient, selon Lahouari Addi, une sorte de chantage historique à leur population en leur offrant des droits sociaux en contrepartie d’une cession de leurs droits politique, sabotant ainsi toute aspiration à la liberté, dans toutes ses acceptions. Dans un deuxième temps, Lahouari Addi observe que, bien que le nationalisme arabe radical se soit idéologiquement épuisé, le populisme de type autoritaire n’en reste pas moins présent avec de nouveaux appâts : l’islamisme. Selon lui, celui-ci s’exprime aujourd’hui à travers l’Islam politique qui ambitionne de réaliser les objectifs du nationalisme arabe radical en empruntant une voie religieuse. Déduction : selon Lahouari Addi, l’islam politique est l’héritier du nationalisme arabe radical et, tout comme lui, fondé sur la négation de toutes les instances de la modernité et allant à contre-courant des aspirations des populations et du mouvement de l’Histoire, il est condamné à l’essoufflement et à l’échec.
« Si les pays arabes ont échoué dans leur farouche volonté de se moderniser, écrit-il, c’est parce que toutes les politiques de développement ont été conçues pour satisfaire les aspirations du peuple et non pas pour répondre aux demandes de la société réelle jugée trop matérialiste par le mysticisme du pouvoir ». En effet, Lahouari Addi fait une nette distinction entre les notion de peuple et de société qui sont, pour la première, un fantasme idéologique qui n’a aucun prolongement dans la réalité et, pour la deuxième, une catégorie sociologique majeure qui constitue, avec la notion de marché et d’Etat, les trois instances fondamentales de la modernité. Mais pas seulement. Car le nationalisme arabe ne nie pas que la société et les conflits permanents qui la traversent, la société étant une catégorie mondaine et peuplée de marchands égoïstes, et est marqué par ce que Max Weber appelle « les eaux glacées du paiement au comptant », mais il nie aussi le marché.
Lahouari Addi fait une nette distinction entre les notion de peuple et de société qui sont, pour la première, un fantasme idéologique qui n’a aucun prolongement dans la réalité et, pour la deuxième, une catégorie sociologique majeure qui constitue, avec la notion de marché et d’Etat, les trois instances fondamentales de la modernité.
Cette double négation, arrimée à un autoritarisme qui a perverti la notion d’Etat, a conduit à l’échec irréversible du nationalisme radical arabe. L’islamisme politique, parce qu’il a emprunté le même chemin en changeant seulement de jargon qui passe dans un registre religieux, est tout autant condamné à l’échec. « Comme corpus idéologique, l’islamisme a été élaboré par deux penseurs qui ont donné aux représentations culturelles une forme discursive sous forme d’utopie : Abu Al Ala Mawdudi (1909-1979) et Sayyid Qutb (1926-1966). Ils sont formulé une idéologie exprimant une forme de volonté politique susceptible de rendre le monde conforme à ces représentations. Ces deux idéologues ont eu le souci de proposer une alternative au capitalisme (refusé pour ses libertés politiques et ses inégalités sociales) et au socialisme (rejeté pour son indifférence, voire son hostilité à la religion) », écrit-il en soulignant que les exploits électoraux et les mobilisations qui réussissent les discours inspirées de cette vision utopiste sont une sorte d’écume qui ne résistera pas longtemps au mouvement de l’Histoire qui, elle ne sait ni ne saurait s’accommoder des fantasmes idéologique, aussi têtus soient-ils. Sa conclusion est d’une étourdissante lucidité : « L’Occident [où est né la modernité à laquelle aspirent les populations vivants dans les pays arabo-musulmans, NDLR] n’a pas été appréhendé comme une expérience particulière de l’histoire intellectuelle de l’humanité, histoire à laquelle les musulmans avaient fait auparavant une contribution, mais plutôt comme un espace dans lequel la science a émergé par pur hasard, donnant aux Occidentaux un avantage sur les autres peuples. La cristallisation essentialiste d’une différence radicale entre « eux » et « nous » indique que le nationalisme arabe radical est tout aussi étranger à la conscience historique que l’islamisme avec lequel il partage les mêmes références culturelles ».
«La crise du discours religieux musulman : le nécessaire passage de Platon à Kant» de Lahouari Addi, tel que j’ai lu et résumé
par Hacène Merani*
 Le sociologue Lahouari Addi vient de publier en Algérie, il y a quelques mois, aux éditions Frantz Fanon, un ouvrage intitulé «La crise du discours religieux musulman. Le nécessaire passage de Platon à Kant». C’est une édition locale du même ouvrage publié en 2019 en Belgique aux éditions «Les Presses universitaires de Louvain». C’est un essai, de très haute importance, qui prend comme objet d’étude, tel que mentionné dans le titre même de l’ouvrage, la «crise» profonde qui caractérise le «discours» religieux musulman. Dans la présente contribution, je tenterai de rendre compte du contenu de ce brillant ouvrage.
Le sociologue Lahouari Addi vient de publier en Algérie, il y a quelques mois, aux éditions Frantz Fanon, un ouvrage intitulé «La crise du discours religieux musulman. Le nécessaire passage de Platon à Kant». C’est une édition locale du même ouvrage publié en 2019 en Belgique aux éditions «Les Presses universitaires de Louvain». C’est un essai, de très haute importance, qui prend comme objet d’étude, tel que mentionné dans le titre même de l’ouvrage, la «crise» profonde qui caractérise le «discours» religieux musulman. Dans la présente contribution, je tenterai de rendre compte du contenu de ce brillant ouvrage.
Après avoir eu la pertinence, comme à son habitude, de souligner d’emblée que «Le débat sur l’Islam est sensible dans les pays musulmans aux prises avec une sécularisation que les uns souhaitent et les autres redoutent», Lahouari Addi précise que son ouvrage est «le résultat d’un travail de recherche qui a commencé il y a une dizaine d’années». Il prend sa source, ajoute le « socio-penseur », si j’ose l’appeler ainsi, dans ses enseignements à Sciences Po de Lyon et dans son projet de recherche mené au Laboratoire Triangle dont il fait partie. Et comme on le constate déjà dans le titre même, l’objet du livre est la crise du «discours religieux musulman et son influence sur les représentations culturelles.» Discours pris, selon Addi, comme «une interprétation du Coran» sous l’influence «de la pensée grecque antique qui a fourni à la théologie monothéiste, dit-il, son fondement intellectuel rationnel.» L’une des idées essentielles de l’ouvrage, précise encor l’auteur, «est que la religion est obligatoirement interprétée dans une culture, dans une métaphysique». Par conséquent, dit-il, «la crise de l’islam», dont on parle si souvent, n’est en fait, qu’une «crise de la culture de la société musulmane».
Ainsi, et avant d’entrer dans le vif du sujet et le traiter à travers les huit chapitres que contient son livre, Addi souligne que «Malgré les références nombreuses à des philosophies», son travail n’est pas un essai philosophique. C’est plutôt «une réflexion appartenant à la sociologie de la connaissance et des représentations ou des idées qui tissent la culture». Il ajoute que son essai «formule une hypothèse audacieuse : la culture religieuse, qui fournissait à l’homme du Moyen Âge la grille de lecture du monde et le sens de son existence, a pour fondement le dualisme platonicien qui a perdu de sa pertinence en Europe de l’Ouest avec la philosophie moderne apparue aux 16ème-18ème siècles».
Addi entame en suite son brillant exposé, dans le premier chapitre, par souligner le lien étroit qui lie «le monothéisme et la philosophie grecque». Plus précisément c’est de la philosophie de Platon qu’il s’agirait. Ainsi, si «Platon a été judaïsé, christianisé et islamisé, dit-il, c’est parce qu’une partie de son enseignement se prête à l’osmose avec la métaphysique implicite de la Bible d’où sont issus le Nouveau Testament, les Evangiles et le Coran». Toutefois, ajoute notre auteur, il faut savoir qu’en Europe la pensée grecque a été «délégitimée intellectuellement par les découvertes scientifiques de Galilée et plus tard de Newton». Et elle a fini par perdre de sa pertinence «pour interpréter le monde et fournir un cadre d’intelligibilité de la nature». Cela a créé «un vide qui sera comblé par Descartes et Kant». Ainsi, «Le basculement de l’ordre théocentrique de l’univers vers l’ordre anthropocentrique du monde était inéluctable ». A partir de là, «les représentations culturelles ont commencé à s’autonomiser de la tutelle de l’Église».
Dans le deuxième chapitre, qui, selon Addi «apporte un éclairage sur l’influence de la métaphysique platonicienne sur la culture musulmane dans sa forme savante et populaire», il commence par noter que c’est «L’affirmation radicale de l’unicité divine par l’islam en opposition à la trinité chrétienne» qui «a constitué le principe par lequel la pensée de Platon a fait irruption dans les commentaires du Coran». Toutefois, explique-t-il, c’est l’orthodoxie, avec notamment Ibn Hanbal et Abu Hamid al-Ghazali, qui «s’est opposée à ce qu’elle a considéré comme une interprétation païenne du Coran». Mais, fait-il remarquer, «Apparemment défaite, la pensée de Platon resurgit dans la mystique néoplatonicienne qui gagnera la masse des croyants cherchant à entrer en contact avec Dieu par la ferveur». Ce sera le soufisme. Avec Ibn Taymyya les choses seraient devenues plus nettes encore. En effet, en s’appuyant sur une lecture littérale du Coran, celui-ci «a cassé le compromis établi par al Ash’ari et al Ghazali entre raison et révélation», assurant par là «la victoire de son maître Ibn Hanbal sur ses adversaires». Cela a fini tout simplement par imprimer «au discours religieux musulman sa rigidité qui l’a coupé de l’histoire et de l’anthropologie de l’homme». Dans le troisième chapitre, Addi a tenté de montrer «comment la vision néoplatonicienne a marqué la culture musulmane, résistant aux accusations de shirk (associationnisme) lancées par les fuqahâ’ et l’orthodoxie salafiste». Ensuite, Addi essaye de montre comment l’islamisme a, selon lui, constitué dans le monde musulman une sorte de métamorphose du soufisme. Après avoir donné un pertinent résumé sur le sens, l’histoire et les principaux hommes du soufisme, Addi affirme que celui-ci a commencé sa déclinaison «tout au long du 20ème siècle, laissant le champ libre au puritanisme qui s’imposera face à son adversaire de toujours». C’est à la faveur des mutations sociologiques provoquées par le contact avec l’Europe, constate-t-il, que «les penseurs de la Nahda vont développer un discours critique à l’endroit de l’islam populaire», «accusé d’être à l’origine du retard des sociétés musulmanes.» Et c’est là où est apparu l’islamisme sous forme, entre autres, d’un «discours critique véhément» dans les mosquées «dénonçant les dirigeants, accusés de s’être éloignés du chemin tracé par Dieu». Ainsi, pour notre auteur, l’islamisme «est l’expression contradictoire de la modernité dans des sociétés dominées culturellement et économiquement ».
Le quatrième chapitre porte, nous dit Addi, sur la tentative de synthèse faite par le grand réformiste Mohamed Abdou «entre le positivisme européen et la vieille théologie, synthèse qui a réuni les culturalistes conservateurs et les nationalistes progressistes, donnant naissance à une double filiation politico-intellectuelle : d’un côté, un nationalisme libéral qui se radicalisera après 1945 en populisme révolutionnaire et, de l’autre, un culturalisme qui deviendra agressif à partir des années 1960-1970». Mais, après avoir été unis durant la domination coloniale, «les deux courants se sépareront et se combattront après les indépendances». «Considéré à juste titre, souligne Addi, comme le théologien le plus important du monde musulman, Mohamed Abdou s’était fixé comme objectif de moderniser le discours religieux afin de rattraper le retard sur l’Europe et résister à la domination coloniale». Toutefois, note-t-il encore, la tentative de ce réformiste a fini par un échec. En effet, constate Addi, si Mohamed Abdou a «légitimé religieusement les découvertes scientifiques réalisées en Europe», il n’a «cependant pas fait une analyse critique des théologiens qui avaient été hostiles à la science et à la philosophie». Et c’est donc là que se situeraient les raisons qui auraient sapé «la dynamique du projet contradictoire de Mohamed Abdou qui n’avait pas la capacité de réformer la théologie, en l’absence de groupes hégémoniques qui demanderaient sa réforme». Le cinquième chapitre tente «d’analyser le paradoxe de la société musulmane contemporaine qui accepte la technologie la plus moderne tout en refusant la philosophie du sujet qui l’accompagne». Ainsi, et même si après l’avènement «du wahhabisme qui avait interdit toute connaissance qui ne provient pas du Coran et de la tradition, explique Addi, la culture musulmane a accepté les sciences et techniques mises au point par les Européens». Celle-ci a continué de rejeter «les sciences sociales soupçonnées de vouloir affaiblir la foi et se substituer à la vérité divine». Et si les oulémas et avec eux une majorité de musulmans acceptent le positivisme, ils continuent à refuser «toute évolution vers la phénoménologie qui réincarne la raison et humanise l’explication du monde social». En fait, l’enjeu fondamental de cet état de fait, selon Addi, est que le basculement de la raison à la conscience, tel qu’il a été réalisé par le kantisme en Europe, suscite la peur des oulémas «qui craignent que l’individu ne soit autonome et ne s’éloigne de la Norme édictée par Dieu et enseignée par la raison dont ils ont le monopole».
Continuant son exposé, Lahourai Addi passe en revue, dans le sixième chapitre, ce qu’il a appelé «les enjeux contemporains du débat religieux dont les protagonistes sont, d’une part, les tenants de la transcendance qui essayent de mettre l’éthique au-dessus de l’histoire et, d’autre part, les tenants de la conscience historique qui cherchent à proposer une lecture différente du texte sacré». En soulignant que «L’avenir des sociétés musulmanes dépendra de l’issue de la lutte entre les deux camps». Car, «L’enjeu est la sécularisation et celle-ci passe par la nécessité d’enlever au discours religieux sa prétention à contrôler le savoir profane». Rappelant, un peu plus loin que «Dans les pays musulmans, l’imam n’est pas seulement un prêtre», mais aussi «un enseignant de la vie sociale profane», Addi conclut, à bon escient, que c’est là justement où l’ignorance de cet imam «de la sociologie, de l’histoire, de l’économie politique, de la philosophie a pour conséquence la pauvreté de la culture générale du grand public plus sensible à la mythologie qu’à l’histoire». Après avoir passé en revue trois tentatives de «reconstruction du discours religieux» opérées par Mohamed Mahmoud Taha, Mohamed Shahrour et Nour-Eddine Boukrouh, Addi souligne, à très juste titre, que si «le discours religieux est hégémonique dans les sociétés musulmanes, c’est probablement parce que la philosophie et les sciences sociales sont assez faibles et n’ont pas d’impact sur les représentations culturelles».
Dans le chapitre sept, Addi tente de «cerner la problématique juridique dans la société musulmane, en définissant les concepts de charia, de fiqh et de droit musulman». Il aborde cette partie de son ouvrage par dire que si pour les uns le mot Chari’a «recouvre un idéal de justice divine, et pour les autres, il est synonyme d’intolérance religieuse», il va tenter, lui, «de montrer que la question juridique dans les sociétés musulmanes est moins simple que ne le suppose ce manichéisme naïf». Ainsi, précise-t-il, «La chari’a est un idéal d’éthique divine contenue dans le Coran à l’état implicite ; le fiqh est sa traduction culturelle dans la métaphysique médiévale de l’époque ; le droit musulman est une étatisation du fiqh avec des emprunts au droit occidental». Or, souligne-t-il, la demande de la chari’a n’est en fait qu’«une quête de justice et de défense d’intérêts individuels dans une société où la solidarité lignagère est en train de s’effriter». En conclusion, Addi soutient «que le passage du fiqh au droit est une nécessité historique et sociologique à laquelle aucun pays musulman n’échappera».
Dans le huitième et dernier chapitre, intitulé «Europe, Islam et sécularisation», notre sociologue tente de montrer que «la culture musulmane est restée fidèle à la vision platonicienne, tandis que l’Europe a construit une nouvelle vision sur la base de la philosophie de Kant à la fin du 18ème siècle». Addi entame ce chapitre par souligner qu’il «est difficile de parler du monde musulman sans évoquer ses rapports avec l’Europe qui ont changé au cours de l’histoire». Il en a résulté que ayant «perdu leur «autonomie socio-historique», les musulmans ne sont plus capables à «exister et à se percevoir en dehors du regard de l’Europe». Le comble est que, fait noter pertinemment l’auteur, «Désormais, le musulman n’agit plus pour lui-même, il réagit en fonction de l’autre». Et c’est «dans ce contexte que se pose la question de la sécularisation, et c’est ce qui fausse le débat sur l’éthique et en particulier sur le droit qui n’arrive pas à se restructurer autour du concept de liberté de l’individu». Addi note à ce propos, dans l’introduction déjà, que sa réflexion l’a conduit à «conclure que la sécularisation n’est pas un thème de théologie», mais de sociologie parce qu’elle est d’abord une représentation culturelle et, à ce titre, elle doit être recherchée dans les rues de Bagdad, du Caire et d’Alger, loin des représentations des fuqahâ des siècles passés.
A ces huit chapitres, Addi ajoute en annexe une réflexion intitulée «Le débat autour du «théorème de la sécularisation» : Karl Löwith, Carl Schmitt et Hans Blumenberg». Il y note en substance qu’il a trouvé que la thèse de ce dernier éclaire sa recherche «dans la mesure où il affirme que la sécularisation est impensable avec une culture religieuse platonicienne, et que la modernité n’a été possible que parce qu’elle a créé sa propre légitimité philosophique» où «la culture kantienne a remplacé la culture platonicienne». Et c’est justement, fait-il remarquer encore une fois, «à cette tâche que les sociétés musulmanes sont confrontées». A quiconque objectera en disant que ce que propose Addi est «une démarche européo-centriste», il lui répondra «elle le serait s’il existait une supposée essence européenne ontologiquement différente d’une supposée essence musulmane». Thèse à laquelle, dit-il, «je ne crois pas». La preuve ? Platon, qui a eu une grande influence sur la culture musulmane, «n’est ni un Berbère ni un Arabe».
Je le répète encore une fois, l’ouvrage de Addi est d’une importance capitale. C’est une contribution de très haut niveau à un débat vital dont dépendra le présent et surtout l’avenir des sociétés musulmanes. Non seulement il doit être lu, car ce qui en a été dit plus haut n’est qu’un petit résumé, mais il devra, à mon avis, faire date. Comme à son habitude, Addi a traité le sujet avec un esprit et une application dont l’objectivité et la profondeur forcent le respect et l’admiration. A la différence de beaucoup d’autres, «éblouis» qu’ils sont par les réalisations de la civilisation occidentale moderne, jusqu’à l’aveuglement, et souvent sans bagage intellectuel et culturel à la hauteur de leurs «ambitions», qui se lancent dans cette délicate tâche, la «critique du discours musulman», n’a pas empêché Addi de reconnaître la grande valeur des anciens penseurs et savants musulmans, ceux qui étaient soit des «théologiens-philosophes» ou des «philosophes-théologiens», selon ses propres termes, et de montrer un profond respect à leur égard. Il les a même comparés, à très juste titre, dans leurs domaines respectifs, aux grands penseurs de l’Humanité. Même s’il a considéré que certains d’entre eux, comme le grand théologien Ibn Taymyya, ont commis l’erreur historique de chasser la philosophie du champ de la pensée islamique. Cela ne l’a pas empêché non plus de montrer que le problème ne réside aucunement dans la pensée et les réalisations de ces anciens, mais plutôt dans le discours de la plupart des fuqahâ’ qui s’en réclament aujourd’hui. Car, pour Addi, ce sont ces derniers qui ne réalisent toujours pas que le texte sacré est une chose et que son interprétation en est une autre. Que l’interprétation du Coran ou tout autre texte est obligatoirement un acte historique et culturel et, donc, socio-humain. Le nier ou même l’ignorer aura inéluctablement des conséquences néfastes sur l’état de la société et fera d’elle une proie à tous les problèmes de son époque. Car, celui qui ne vit pas son temps, connaîtra nécessairement tous les malheurs de son temps, tel que l’aurait dit Voltaire.
Et c’est sur cela justement qu’insiste avec brio Addi tout au long de son ouvrage. Toutefois, l’importance du travail de notre auteur ne veut aucunement dire que tout ce qu’il y a soutenu est incritiquable. Cela serait contraire à l’esprit du message kantien, à celui de la modernité et à celui que Addi lui-même a bien voulu nous transmettre. Et c’est à partir de là que je me suis permis de me demander si Addi a, par exemple, donné une explication sociologique suffisante à l’échec du passage de la culture musulmane vers la modernité. Certes, il en donne en gros, si ma lecture est juste, deux grandes causes. L’inexistence dans le monde musulman d’une classe bourgeoise porteuse d’une nouvelle culture qui aurait pu jouer un rôle historique dans le changement tel qu’il a été le cas en Europe à la fin du Moyen Âge, d’une part, et la résistance de la classe des théologiens traditionnels à toute entreprise de réformes, d’autre part.
Oui, Addi a parfaitement raison, ces deux causes peuvent être à l’origine de cet échec. Mais seraient-elles suffisantes ? La résistance des masses elles-mêmes, refusant, consciemment ou peut-être surtout inconsciemment, la modernité à l’occidentale, n’y serait-elle pas une des causes essentielles également ? Car, ce qu’il faut avoir présent à l’esprit à ce propos, à mon humble avis, c’est que quand l’Europe s’est modernisée cela s’était produit dans une sorte de vide civilisationnel ». Autrement dit, il n’existait pas à l’époque un modèle hégémonique où on pouvait voir, certes, ses gloires mais aussi ses déboires, réels ou supposés. Les musulmans, eux, sont, heureusement ou malheureusement, selon la position des uns ou des autres, dans une situation différente. Et c’est peut-être à cause de cela que la résistance est si forte. Non seulement la résistance de la classe des fuqahâ’, mais aussi celle de toutes les classes y compris moyennes et populaires et même (et pourquoi pas ?), de celles dont pourrait surgir cette «bourgeoisie» qui fait défaut. Penser que le rôle de ces classes ou de ces causes dans les mouvements historiques est secondaire, ce que Addi n’a jamais dit, bien sûr, ne me semble pas judicieux. Et si notre grand penseur a dit que cela s’était déjà produit avec le platonisme en nous rappelant que Platon n’était ni un Berbère ni un Arabe, je me permets de noter ceci : certes, ce grand philosophe grec n’était «ni un Berbère, ni Arabe». D’ailleurs, il n’était ni un Turc, ni un Perse, ni un Kurde , non plus. Toutefois, je reste persuadé que l’adoption des thèses de Platon n’a pas pu être possible si elles n’ont pas été «dégrécisées» d’une manière ou d’une autre. Il en a été également le cas avec Averroès. Ces idées n’ont été adoptées qu’après avoir été «déislamisées». Cela semble être une «loi» qui régit le passage des idées d’une grande civilisation à une autre. Et cela pourrait être aussi, dans le monde musulman, la condition du passage de Platon à Kant comme le suggère Lahouari Addi. Si Platon a été adopté c’est, me semble-t-il, par une «ruse». Une «ruse» qui ressemble à celle de la nature, dont parle Kant. Mais une «ruse humaine» cette fois-ci. Une ruse dont seuls les grands penseurs, comme ces «philosophes-théologiens» ou «théologiens-philosophes», seraient capables. Dont seuls des penseurs ayant, non seulement la force de Nietzsche, tel que notre auteur lui-même l’avait souligné, mais ayant aussi la subtilité, la souplesse d’esprit, la sagesse et la «ruse» intellectuelle, dont Addi lui-même ne semble pas, loin de là, dépourvu.
*Université d’Annaba

Par cette assertion, Lahouari Addi conçoit la démocratie comme une simple formalité procédurale propre à un régime politique quelconque. Or, la démocratie n’est pas seulement affaire de régime politique. Elle n’est pas seulement une affaire de dimension politique et institutionnelle. Sont également en cause le modèle social et la démocratie des mœurs. La Constitution politique ne peut, en effet, suffire à garantir la démocratie si la société ne peut s’appuyer sur une Constitution civile qui cimente la nation et qui l’émancipe du pouvoir. La Constitution politique démocratique doit consacrer les droits naturels des Hommes. Les libertés individuelles, les droits fondamentaux, le principe d’égalité entre les citoyens, entre hommes et femmes. Le droit en est le fondement qui détermine la citoyenneté. La société ne pourra pas être authentiquement démocratique si la femme n’est pas libre et n’est pas l’égale de l’homme. La démocratie ne peut advenir si la société n’est pas rendue à tous ses membres. Le code de la famille et le code du statut personnel sont le socle sur lequel le vivre-ensemble démocratique peut se bâtir. A travers ces codes se pose la question de l’autonomie de la loi et celle de la souveraineté législatrice du peuple.
Le corps social dans sa diversité se reconnaît dans l’Etat. Il est le lieu où les tensions sociales se résolvent. Il est ce par quoi la nation existe. Il est inséparable du droit et celui-ci est nécessaire aux libertés fondamentales et à la démocratie. Le peuple souverain doit légiférer en toute matière. Etablir l’égalité des droits entre l’homme et la femme. L’égalisation des conditions entre les citoyens de la nation et la suppression des discriminations en raison des appartenances confessionnelles ou tout simplement de leur non croyance. Ces inégalités sont incompatibles avec la démocratie.
Dans la modernité, c’est le rationalisme qui est la raison théorique et c’est un nouveau rapport à la politique, à la religion, à la morale et au droit qui en est la raison pratique. La politique est fondée sur la démocratie et le contrat social, le droit sur la volonté de l’Etat et les droits humains, la morale sur la subjectivité et la religion sur la laïcité. Ne pas situer le discours et la pratique, c’est faire croire que l’islam traverse le temps sans en être affecté. Se référer à des expériences concrètes sans les rattacher à leur contexte historique rend illisibles les ruptures et les évolutions.
C’est d’un droit autonome, libéré des totalités théologiques, que se revendique la modernité. Il est ce qui cimente la société citoyenne. La démocratie s’appuie sur le droit. C’est bien autour du droit que s’ordonne le corps politique, lui aussi autonome. Ce n’est pas seulement d’un point de vue pratique qu’est reconnue l’autonomie de l’instance juridique. C’est aussi en termes de connaissance que celle-ci se donne à voir. En tant que mode de savoir indépendant.
Ce qui semble préoccuper Lahouari Addi, comme tout intellectuel islamiste généralement, c’est comment être moderne sans se renier ? Faut-il, pour rester fidèle à soi, renoncer au monde ?
L’islam politique considère que l’universalité de la modernité cache la vocation expansionniste de l’Occident. Le problème est que la modernité n’est pas seulement une grille d’analyse ; elle est aussi une réalité concrète qui s’universalise. En se détachant de son origine, ne se situant plus dans la continuité historique de la rationalité occidentale, elle devient indifférente au cadre spatio-temporel dans lequel elle s’insère.
Pour s’en sortir de ce dilemme, une démarche constructive s’impose, afin de déplacer le questionnement sur le présent, d’identifier les impasses et les causes du statut quo. Déconstruire le système de production du discours, du savoir et de la légitimité imposée par la tradition. Songer ainsi à l’avenir et entrevoir des perspectives.
Depuis l’indépendance nationale, le pouvoir algérien a échoué à réaliser la transition vers la modernité, faire passer la société du modèle traditionnel à une organisation sociale moderne. L’Algérie demeure toujours scientifiquement arriérée, économiquement sous-développée et faible politiquement, socialement et culturellement. Ce retard est en grande partie amputable à la confusion du religieux et du politique, par l’entremise de la charia dans toute action normative. La charia désigne la voie tracée par Dieu (tarîq ou sabîl) et sert à proscrire le droit. La notion de voie prend ainsi le sens de loi. La charia devient un système cohérent qui tend à réaliser la conformité de la cité des hommes à l’ordre du Dieu. Elle a été entendue dans le sens de normativité ou de réglementation. Comprise dans ce sens, elle est constitutive d’un système qui tend à embrasser tous les aspects de la vie du citoyen, de même qu’elle tend à régenter tous les secteurs de la vie sociale : les relations privées, l’économie, le droit public, l’organisation des pouvoirs politiques, le culte, la foi, y compris même l’enseignement et l’éducation nationale.
En soutenant que «les islamistes sont un courant d’opinion dans la société et il n’est pas question de les exclure du champ politique», Lahouari Addi évacue l’évidence même de deux modèles de société qui s’opposent en Algérie, l’une traditionnelle, l’autre moderne. L’une ordonnée autour d’une foi réduite à une loi, l’autre autour d’un droit qui revendique son autonomie. Ce conflit n’est pas seulement relatif au contenu des règles, il met en cause la structure même de la société et de l’Etat.
L’Etat fondé sur la charia est ambigu, confus dans son être et dans son statut. Il est défaillant sur son principal élément constitutif qui est la pleine souveraineté juridique : dire la loi et en assurer l’application. Comment partager la force publique avec des sectes religieuses qui imposent leur conception du droit fondée sur le dogme religieux ? Un Etat qui n’a pas le monopole de la contrainte, de la violence légitime, au sens de Max Weber, ne peut exercer pleinement sa souveraineté sur la totalité de sa population. L’Etat ainsi défini, pour qu’il puisse exister, est amené à exercer un pouvoir autoritaire et faible. Ne remplissant pas pleinement ses fonctions, celles qui sont inhérentes à sa qualité d’Etat. Pour exister, un tel Etat doit procéder à des ruptures fondamentales. A commencer par la rupture avec le passé. Seule condition pour l’émergence d’un véritable Etat démocratique, au sens moderne. La construction de l’Etat de droit dépendra en grande partie d’une clarification entre le rapport à la modernité et la redéfinition du statut du passé.
En restant à l’extérieur de l’ordre politique, la foi ne sera pas pour autant menacée par la mise en œuvre réelle de la liberté de conscience et de l’égalité entre les hommes. Au contraire, c’est en même temps lui permettre de se purifier et se tenir à l’écart des contingences du temps. La Constitution doit instituer la nation citoyenne. Le droit est le principal déterminant pour la construction de l’Etat démocratique. Poser la question de la laïcité, c’est la poser en tant que question des rapports entre religion et Etat, religion et politique et religion et droit.
La révolution populaire se bâtit sur l’action collective du peuple, contrairement à la révolution bourgeoise et prolétarienne. Elle marque le point de rupture avec soi plus que la contestation d’un régime politique. Par sa nature même, elle vise non pas à un transfert de pouvoir, mais à poser les règles du jeu du pouvoir. C’est le champ du politique que la société investit de façon autonome. Elle constitue de cette manière une rupture puisqu’elle requiert une nouvelle culture politique. Modalité de changement et champ ouvert à l’intervention active de la société dans son ensemble, et non à une classe sociale particulière. Elle engage un processus d’avenir.
Contrairement à l’assertion de Lahouari Addi, qui considère dans cette même contribution, que «la conscience collective du Hirak a compris que la société contient plusieurs courants idéologiques qui ne doivent pas s’exclure», alors que, c’est au contraire, ce même sentiment profond sur la nécessité de rupture avec soi qui est à l’œuvre dans la conscience collective des hirakistes, plus que la contestation du régime politique hérité de Bouteflika ou celui attribué au «système» généralement. Au point de susciter méfiance et polémiques à tout va à chaque fois qu’un symbole du passé est venu s’immiscer ou interférer dans la dynamique du Hirak à son insu. Comme ce fut le cas face à cette rencontre anachronique entre un symbole de l’islamisme politique, en l’occurrence Ali Benhadj, et des acteurs considérés comme emblématiques de la Révolution en cours.
Y. B.