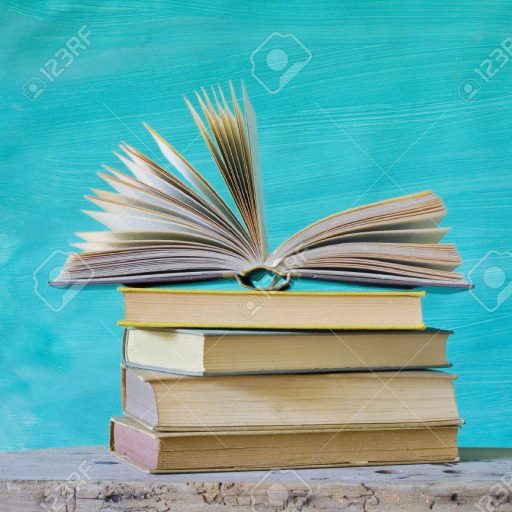Hasni Abidi. Directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève
«L’Algérie est à un moment charnière de son l’histoire : assumer une transition négociée ou s’enfoncer dans le déni. Le peuple est déjà dans une logique de transition depuis le 22 février», analyse le politologue Hasni Abidi. Il serait «plus sage de mener la transition avec le pouvoir, car c’est une négociation permanente animée par la recherche du compromis», préconise-t-il.
– Plus de sept mois de soulèvement populaire général et ce n’est pas encore fini, les Algériens n’entendent rien lâcher. Quel bilan peut-on tirer de cette inédite insurrection citoyenne ?
Tout bilan d’un soulèvement inédit dans ses formes et dans sa substance est prématuré. Il sera partiel dans la mesure où cette mobilisation ne cesse d’évoluer depuis sa naissance. Une lecture académique sans le recul nécessaire imposé par le facteur temporel ne résistera pas à l’examen critique. Néanmoins, un bilan d’étape est possible pour savoir si la mobilisation citoyenne est parvenue à réaliser ses objectifs ou le moins une réponse aux attentes des citoyens.
Désormais, l’après-22 février est une nouvelle époque en Algérie. La force de cette mobilisation et la détermination des Algériens posent un grand défi pour le pouvoir : il est dans l’incapacité de comprendre la nature et l’ampleur du ras-le-bol des Algériens et leur résolution à tourner la page. Pour la première fois depuis l’indépendance du pays, aucune réponse émanant des décideurs ne satisfait une rue qui estime que le régime est en panne avec des recettes périmées. En mettant une grande partie des figures politiques et oligarques en prison, le pouvoir donne raison au peuple. Il confirme que le système a failli.
– Cette mobilisation a-t-elle impacté le système ou a-t-elle juste réussi à changer sa façade ?
Le système est largement touché. C’est un système épuisé qui tente de faire face à une demande populaire de rupture avec des instruments du passé. Cependant, ledit système ne se résume pas à des hommes du pouvoir dont le départ est susceptible d’enclencher une gouvernance démocratique. Le système politique perdure parce qu’il est d’abord une pratique de pouvoir qui dure depuis des décennies, mêlée à une conception horizontale et autoritaire.
Des pans entiers de la société et du pouvoir sont biberonnés à la rente, perçue comme le socle du pouvoir. Remplacer la rente par une légitimité démocratique n’est ni une idée séduisante ni un projet qui fait rêver. Avec un civisme exemplaire, la mobilisation algérienne a réalisé un miracle. Celui de convaincre le système de se séparer de la moitié de sa composante désormais en détention. La deuxième partie qui reste ne peut pas partir d’une manière volontaire. Seule une transition graduelle et négociée saura la déposer.
– Pourquoi la transition démocratique devant conduire à l’instauration d’un nouvel ordre politique n’a-t-elle pas pu voir le jour ?
C’est un point qui fait débat. Sommes-nous dans une transition ou dans l’attente d’une transition ? Malgré l’hypersensibilité du pouvoir à l’égard de la transition en tant que concept, celle-ci est à l’œuvre depuis le jour où un citoyen a piétiné le portrait de l’ex-Président dans le hall du siège de la mairie de Khenchela. Que signifie l’instauration d’une instance autonome chargée des élections présidentielles ? Quelle lecture donner aux propos de M. Gaïd Salah quand il insiste sur l’absence d’un candidat soutenu par l’armée ?
Certes, le pouvoir esquive la transition parce qu’elle mène à son départ et non pas à sa mise à jour, mais, in fine, il est rattrapé par une configuration d’une transition sans s’assurer de l’issue démocratique de cette transition. En définitive, la transition politique est le «passage d’un régime à l’autre».
La nature de ce passage est laissée aux bons soins de chaque Etat en fonction de ses dynamiques internes. Aucune transition ne ressemble à l’autre. Ce qui explique les incertitudes et les vulnérabilités d’un processus de transition. L’Algérie est à un moment charnière de son l’histoire : assumer une transition négociée ou s’enfoncer dans le déni. Le peuple est déjà dans une logique de transition depuis le 22 février. Il est plus sage de la mener avec le pouvoir car la transition est une négociation permanente, animée par la recherche du compromis.
– Une élection présidentielle est fixée pour le 12 décembre prochain, pensez-vous que c’est la réponse suffisante pouvant sortir le pays de l’impasse politique actuelle ? Aidera-t-elle à changer le système, ou servira-t-elle à le reproduire ?
L’élection est une réponse à une crise du système, mais elle n’aboutit pas à son départ. Nous avons l’impression que l’objectif du pouvoir réel est la tenue des élections et on arrête tout ! L’Algérie est passée maître en matière d’organisation des élections, et ce, depuis son indépendance, sans pouvoir régler la question de la légitimité constitutionnelle et l’acceptation du pouvoir par les citoyens. Si les conditions du scrutin du 12 décembre ne changent pas d’une manière substantielle, son issue ne sera pas différente de celle qui a convaincu le peuple à sortir dans la rue.
Pour deux raisons, l’élection présidentielle du 12 décembre n’est pas de nature à résoudre la crise politique en Algérie. Parce que le temps dont nous disposons est trop court pour assurer les conditions d’une compétition libre et transparente.
C’est un délai contraignant pour permettre aux partis de faire émerger des candidats et des programmes à la hauteur des défis du moment. Il est évident que l’élection libre d’un Président est le seul moyen légitime pour abréger la vie politique de l’armée et lui épargner une exposition coûteuse. Le vote est l’expression libre d’un choix politique qui consolide une construction démocratique.
– Le chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, est en première ligne depuis la déposition de Abdelaziz Bouteflika ; pourquoi s’empresse-t-il à organiser la présidentielle ?
L’échec du pouvoir dans l’organisation de deux élections capitales, quand on connaît l’attachement dogmatique du pouvoir à l’organisation des élections, n’est pas facile à soutenir. Ceci est le réflexe erroné du régime autoritaire qui considère la tenue des élections source de légitimité renouvelée. Il est à noter qu’il est dans l’intérêt de l’armée de se retirer de la gestion des affaires de la cité.
Ce n’est ni sa compétence ni son souhait de perdre son capital de sympathie auprès du peuple. L’empressement traduit l’inquiétude de la troupe face à la radicalisation de certaines revendications populaires. Cette crainte est renforcée par la paralysie du gouvernement actuel dans une situation économique et sociale tendue. Aux yeux de l’armée, l’élection paraît l’option la moins coûteuse pour s’en sortir et surmonter la crise. Sans dégâts.
– L’institution militaire est-elle dans une situation confortable en étant au-devant de la scène en assumant le pouvoir dans cette période ?
Non. Elle ne se plaît pas dans sa mission actuelle qui alourdit un cahier des charges déjà très chargé. Le soutien de l’armée à son commandement n’est pas un mauvais signe. Au contraire, il montre que les efforts de la professionnalisation de l’armée sont en bonne voie et que la cohésion de l’institution militaire est primordiale. Les limites dans le traitement de certains dossiers sont courantes dans une situation où la seule institution stable et organisée est appelée à gérer les questions sécuritaires, politiques, économiques et même juridiques.
La transition reconnaît l’état de fait illustré par le legs catastrophique de Bouteflika. L’absence de véritables institutions et le cafouillage autour de la Constitution compliquent la recherche d’un consensus et l’absence d’une locomotive neutre chargée de conduire le processus transitionnel. Dans les Etats où les militaires sont un acteur incontournable, l’expérience égyptienne menée par le maréchal Tantaoui ne plaide pas en faveur d’une transition conduite par l’armée. En revanche, le Soudan a tiré son épingle du jeu grâce au dialogue et à la négociation. Osons une autre voie, celle de l’Algérie.