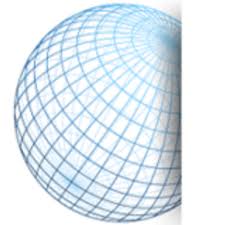Après le coup d’État, la répression avance à pas de géant en Bolivie. La dictature persécute les « narcotrafiquants », les « vandales » et les « terroristes », c’est-à-dire les mouvements sociaux, les anciens membres du gouvernement, les paysans et les indigènes qui manifestent et sont assassinés par l’armée (35 morts et plus de 800 blessés). Le gouvernement de facto criminalise les missions internationales d’observation des droits de l’homme, le Bureau du Défenseur du Peuple et même les journalistes, les qualifiant de » guerriers numériques » ou de » terroristes informatiques « , essayant ainsi d’enterrer la vérité sous une montagne de fausses accusations.

Depuis les élections du 20 octobre, la Bolivie traverse une crise politique qui est loin d’être terminée. Dans le cadre d’un processus électoral qui a fait l’objet d’une attention particulière de la part des médias internationaux, le vice-président du Tribunal électoral a démissionné pour des raisons obscures, jetant une ombre de suspicion sur la victoire d’Evo Morales par 47,08% des voix exprimées. Une différence de 10% (648 180 voix) par rapport à l’ancien président et candidat de droite Carlos Mesa qui suffisait pour remporter les élections au premier tour.
En fait, Mesa n’a pas attendu les résultats pour dénoncer ce qui pour lui était une fraude annoncée : il la prédisait depuis des mois: prophétie autoréalisatrice ou fuite en avant ? Pendant ce temps-là, le milliardaire Fernando Camacho – dont le nom figure sur les « Panama Papers » et qui avait perdu une part de marché lucrative dans ses contrats de distribution de gaz lorsque Evo Morales est arrivé au gouvernement en 2006 et décida de nationaliser les hydrocarbures pour renégocier les contrats-, annonçait un délai de 48 heures pour la démission de Evo.
C’est dans ce contexte que la violence de l’opposition s’est déchaînée avec une fureur inconnue : les tribunaux électoraux départementaux et le siège du MAS ont été brûlés, leurs représentants tels que le maire de Vinto à Cochabamba Patricia Arce, l’ancien vice-ministre de l’interculturalité Feliciano Vegamonte ont été lynchés et attaqués…mais aussi les directeurs de médias tels que Bolivia TV et la CSUTCB Radio (Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos), José Aramayo, ce dernier a même été attaché à un arbre, donnant lieu à une scène proche de l’Inquisition médiévale.
Le président de la chambre des députés Víctor Borda a démissionné après avoir dénoncé l’incendie de sa maison et l’enlèvement et l’agression de son frère, l’avocat Marco Antonio Borda, par des membres du « Comité civique de Potosí ». Quelques jours plus tard, son frère a rendu publique une vidéo adressée aux organisations internationales de droits de l’homme, alors qu’il était en convalescence dans un lit d’hôpital. Il y dénonçait qu’« apparemment il y avait des ordres de porter atteinte à ma vie pour demander la démission de mon frère (…) Si le Président n’avait pas démissionné, ma vie aurait été en danger ». Le ministre des Mines et de l’Energie César Navarro a également démissionné après l’incendie de sa maison à Potosí et la tentative de pendaison de son neveu. Un même scénario minutieusement appliqué par des criminels agissant sous le couvert de soi-disant « comités civiques », financés par Fernando Camacho. Tout correspond : Camacho lui-même a menacé sans scrupules ceux qui résistent au coup d’Etat, disant qu’il a préparé une « liste noire de traîtres à la Pablo Escobar ».
Intermède magistralement joué par l’OEA, partition écrite par Washington
Dans la perspective des élections du 19 octobre, la Bolivie a mis en œuvre toutes les recommandations de l’Organisation des États américains (OEA) concernant l’amélioration du processus électoral. Plusieurs réunions ont eu lieu entre le gouvernement d’Evo Morales et le secrétaire Almagro. Il fallait assurer la « transparence » et la « crédibilité » tant souhaitées face aux suspicions habituelles à l’égard des gouvernements considérés comme « populistes ». Le système de comptage rapide appelé TREP faisait partie de ce mécanisme rassurant… Mais ce prétendu gilet de sauvetage s’est avéré être une arme par destination. L’engrenage de la manipulation médiatique a été lubrifié à la perfection en tentant d’effacer le comptage traditionnel dans un pays où le vote rural et autochtone a toujours été favorable au MAS.
L’ancien vice-président du Tribunal électoral suprême (TSE) Antonio Costas, qui a démissionné de son poste, ne l’a pas fait parce qu’il s’interrogeait sur le fonctionnement du système de dépouillement rapide du TREP, qu’il jugeait positif car il « génère beaucoup de confiance et décourage la fraude ». Toutefois, il a estimé que « le processus aurait pu être interrompu par le hackage » d’une société concurrente de l’audit. Après vérification par Costas et le TSE, les données TREP après l’arrêt détecté comme un hackage étaient les mêmes. Car, lors du premier rapport, « la progression était très forte, avec environ 10% ». Selon Costas, « les données n’ont pas été modifiées » : « Les ingénieurs de l’OEA étaient tout le temps avec le TSE au moment de la transmission du TREP, prenant des photos de l’avance de très près et le TSE avait une progression de presque 94% jusqu’à 22h, mais nous avions suspendu la publication des informations à 83%. L’OEA connaissait l’évolution de 83 à 94 % dans un délai raisonnable avec 380 opérateurs transmettant les informations ». Il n’y a pas eu non plus de violence le jour du scrutin : « plus de 200 observateurs ont certifié la tranquillité de la journée ».
La présidente du Tribunal électoral suprême (TSE), María Eugenia Choque, a précisé que le TREP » a été suspendu pour éviter toute confusion avec le résultat du système de calcul des départements. Le fonctionnaire a assuré qu’ils avaient décidé de suspendre ce système parce que les tribunaux démarraient avec le calcul officiel et que le TES ne pouvait pas « avoir deux résultats fonctionnant en même temps ». Selon le chancelier Diego Pary, « il n’y a pas eu d’interruption dans le TREP », mais le comptage officiel l’a remplacé. Mais « à la demande des missions d’observation, le comptage TREP a repris 24 heures plus tard. Une nouvelle tendance a été dévoilée, incorporant les votes des régions plus éloignées du pays ».
Le coup d’État en Bolivie a mis en lumière le double jeu de l’OEA. Il a immédiatement annoncé, avant même que les résultats définitifs ne soient connus, que le processus électoral n’était pas crédible. Le département d’État américain a rapidement affirmé que » les États-Unis appuient fermement le rapport d’observation de l’OEA du 23 octobre, qui révèle un certain nombre d’irrégularités qui doivent être corrigées. Elle a ainsi fait comprendre au « monde libre » quelle était la position du gendarme mondiale à l’égard du processus électoral bolivien.
Le gouvernement d’Evo Morales a alors accepté sa proposition d’envoyer une mission d’audit. Mais le candidat Mesa a rejeté la mission de l’OEA, attisant les flammes. Le coordonnateur de l’audit électoral de l’OEA a même dû démissionner pour donner de la crédibilité au rapport, puisqu’il était l’auteur d’une série d’articles à chargecontre le gouvernement Morales ! Pourtant, Evo a accepté son remplacement et s’est engagé à rendre le résultat contraignant. Enfin, le communiqué préliminaire de l’audit de l’OEA sur le processus électoral est arrivé une semaine plus tard, deux jours plus tôt que prévu. Il n’est pas surprenant qu’il ait dénoncé les irrégularités. Le Président Evo a accepté de nouvelles élections. Mais Mesa et Camacho les ont rejetés. Bien que le président Evo ait annoncé qu’il respecterait les conclusions du rapport de l’OEA et autoriserait de nouvelles élections, l’opposition a suivi sa stratégie de coup d’État. Son objectif était précis : forcer Evo à démissioner, persécuter le « masisme » et ainsi mettre fin à un sujet historique collectif.
Peu avant son discours de démission, Evo Morales a reconnu que l’OEA avait fait « un rapport politique et non technique ». Pour avoir surmonté une autre tentative de coup d’État peu après son accession à la présidence en 2006, le gouvernement d’Evo aurait pu se préparer à cette éventualité. Les câbles confidentiels de Wikileaks auraient même pu aider à anticiper le modus operandi. Le 21 août 2009, Hillary Clinton a demandé à son ambassade à La Paz : « Dans quelle mesure l’opposition est-elle prête à recourir à la violence si nécessaire ? Avez-vous des plans pour contrer les forces de sécurité à des fins défensives ou offensives ? » Dans un autre câble, le 10 septembre 2009, Hillary a insisté : « Les chefs ou groupes de l’opposition ont-ils l’intention de protester ou de manifester s’ils soupçonnent une fraude électorale, ont-ils l’intention de s’abstenir de voter ou de tenter de commettre une fraude ?3
Contrairement à la rapidité avec laquelle l’OEA a publié son premier communiqué incendiaire, le rapport final est arrivé avec beaucoup de retard presque un mois plus tard, le 4 décembre. En réponse, une centaine d’experts internationaux lui ont demandé de « retirer ses déclarations trompeuses sur les élections, qui ont contribué au conflit politique et ont servi comme l’une des ‘justifications’ les plus utilisées pour consommer le coup militaire ». Compte tenu de ce précédent, ainsi que des exemples récents d’ingérence de l’OEA dans les cas du Nicaragua et du Venezuela, il sera nécessaire que la population tire ses propres conclusions. Après le coup d’État en Bolivie, quel pays indépendant prendra l’OEA au sérieux, lui permettant de délivrer des « certificats de démocratie » ?
La guerre médiatique à son apogée
Sous la toile de fond d’une suspicion de fraude sogneusement médiatisée, la violence a pris des dimensions croissantes, bien qu’elle ait été étrangement tolérée. Après avoir été désignés comme partisans du gouvernement, les journalistes et les travailleurs des médias de service public ont été attaqués, humiliés et empêchés de travailler. La police semblait ne pas agir, après que l’opposition soit venue la rencontrer et la convaincre de se joindre au coup d’État. Ceci a probablement été préparé à l’avance. La mutinerie des forces de police de Cochabamba et d’autres départements a été dûment mise en scène et médiatisé avec des banderoles annonçant « Nous ne voulons pas de dialogue, tous ensemble pour la démocratie » et d’autres affichant une caricature grossière du Président Evo suspendu par ses parties intimes. La guerre psychologique et médiatique a atteint son apogée lorsque la peur s’est emparée du masisme, les attaques criminelles de l’opposition comptant sur la passivité des forces de police et des casernes de l’armée. Avec leur aide, une véritable stratégie de terreur a pu être mise en œuvre : des membres du gouvernement ont été menacés, kidnappés, leurs maisons privées incendiées en toute impunité et ils ont fini par démissionner sous la pression des représailles contre leur famille.
A gauche, la mutinerie policière de Cochabamba accueillie par des civils équipés de casques, matraques et lance-roquettes artisanaux (photo : France 24).
A droite, des illustrations enfantines diffusées sur les réseaux sociaux par l’Union de la jeunesse de Cruceña, visant à masquer la violence.
A ces moments-là, avec la trahison des forces de sécurité, le destin de la Bolivie plurinationale était compromis. Cet événement a fait pencher la balance en faveur d’une stratégie de coup d’Etat conçue comme un ensemble de forces combinées. Une opposition fabriquée à base de dollars dont le seul but était de saboter la démocratie. Son objectif ? Permettre une fois de plus le pillage de la richesse nationale et empêcher le développement industriel de la Bolivie à partir de ses importantes réserves de lithium.
Le commandement militaire est alors entré en scène : il a « suggéré » au président Morales de démissionner de la présidence pour le bien du pays. Le 10 novembre, Evo Morales a été contraint de renoncer à ses fonctions pour mettre fin à la violence de l’opposition et éviter un bain de sang. Fait significatif, les groupes de choc, des motocyclistes, sont sortis pour célébrer l’arrivée de ce qu’ils considèrent comme la démocratie…et beaucoup d’entre eux portaient encore des cagoules !
Une fois le coup d’État consommé, ces mêmes forces sont sorties pour réprimer sans scrupules ceux qui résistaient, tandis que les médias privés les décrivaient comme des « hordes », des « vandales » ou des « radicaux ». Contrairement à l’idée que l’on pourrait se faire d’une « dictature » installée au pouvoir depuis 13 ans, les médias privés combinés à l’utilisation des réseaux sociaux a joué un rôle crucial dans la justification du coup d’Etat à travers une campagne de propagande dans laquelle le rôle de la victime et de l’agresseur était inversé et le Président Evo Morales diabolisé. Dans quel régime tyrannique les médias se sont-ils placés si ouvertement et librement du côté des putschistes ?
Il est temps d’appeler un chat un chat. Les groupes néofascistes ont joué un rôle décisif dans ce véritable coup d’Etat. Une place privilégiée leur a été réservée, favorisant l’organisation de milices armées qui agissent en coopération avec les forces de police. Des groupes comme l’Unión Juvenil Cruceñista, défini par la Fédération internationale des droits de l’homme comme un « groupe paramilitaire fasciste ». Le 25 novembre, ses membres ont occupé le siège de la Fédération des syndicats paysans de Santa Cruz pour brûler leur matériel et leur documentation. En Bolivie, les voyous et les militaires établissent maintenant leurs propres règles. Il est impossible d’imaginer dans le contexte actuel une quelconque « transition » sans que l’effusion de sang se poursuive.

A gauche, l’émeute policière de Cochabamba accueillie par des civils équipés de casques, matraques et lance-roquettes artisanaux (photo : France 24). A droite, des illustrations d’enfants diffusées sur les réseaux sociaux par l’Union de la jeunesse de Cruceña, visant à masquer la violence.
Imputer les massacres aux victimes elles-mêmes
Vendredi 15 novembre, une marche des paysans des 6 Fédérations du Tropique de Cochabamba a eu lieu sur le pont Huayllani, de Sacaba à Cochabamba. Ce lieu stratégique de liaison avec la capitale du département a fait l’objet d’un déploiement militaire important pour empêcher les cultivateurs de coca du Chapare d’entrer dans la ville. Le résultat a été un massacre sanglant qui a fait au moins 9 morts et des dizaines de blessés. Grâce à des vidéos enregistrées par les paysans eux-mêmes, l’utilisation excesive des gaz chimiques a pu être mis en évidence. En outre, plusieurs témoignages ont mis en évidence l’utilisation d’armes de guerre par des soldats qui survolaient les lieux à bord d’hélicoptères. Le même jour, Jeanine Añez avait signé le décret 4078 autorisant les Forces armées à utiliser des armes militaires sans la moindre responsabilité, dans le but de neutraliser les mouvements sociaux en faveur d’Evo Morales. Ce document précise également que toutes les entités publiques et privées de l’État « doivent fournir un appui aux forces militaires ». Les médias et les réseaux sociaux ont inoculé dans les esprits l’idée folle que les manifestants s’étaient tirés dessus pour attirer l’attention, et que la répression du gouvernement était justifiée pour « pacifier le pays » après le coup.
Quelques jours après, à Senkata, El Alto, un nouveau massacre a eu lieu. Cette fois-ci les médias privés l’ont justifié comme une sorte d’ »attaque préventive », en relayant l’idée que les manifestants, présentés comme des « terroristes », auraient cherché à provoquer une explosion de l’usine à gaz qui aurait fait disparaître la ville d’El Alto.
Le président de facto Añez n’a pas ménagé ses ressources pour présenter l’agresseur comme une victime et vice versa : « nous n’avons jamais pensé à attaquer, nous étions attaqués (…) l’armée n’a tiré aucune balle (…) Des experts nous ont dit que si une flamme s’allumait à Senkata, El Alto peut voler en éclats ». Ceux qui conçurent ce thème ont atteint le sommet dans l’art de la propagande. Cependant, contrairement au mensonge répété mille fois que l’armée n’a pas tiré « une seule balle », différents témoignages affirment que les victimes mortelles ont été prises en cible par hélicoptère.

Au cours de sa mission d’observation, la CIDH (Commission interaméricaine des droits de l’homme), dont on ne peut pas soupçonner une quelconque partialité en faveur du gouvernement d’Evo, a recueilli de nombreux témoignages sur les massacres de Sacaba et Senkata et dénoncé qu’il « n’existe actuellement aucune garantie de l’indépendance de la justice » en Bolivie. En réponse, le 6 décembre, la présidente autoproclamée a approuvé le « décret suprême 4100 » dans le but d’indemniser les familles des 35 morts et des centaines de blessés de la répression qu’elle a elle-même ordonnée. 50.000 bolivianos, un peu plus de 7.000 dollars. Un véritable « chantage » pour les porte-parole des victimes, qui ont déjà annoncé leur volonté de porter l’affaire devant les Nations Unies. Immédiatement, un groupe de porte-parole a répondu : « Nous ne voulons pas de votre argent, c’est du chantage ». Le silence des victimes ne s’achète pas. La CIDH s’est déclarée préoccupée par l’inclusion dans le décret d’une clause qui empêcherait les victimes de faire appel aux instances internationales pour faire valoir leurs droits. Cela constituerait une violation des engagements pris lors de la ratification du Statut de Rome, en particulier du principe d’imprescriptibilité en matière de crimes contre l’humanité.
Une persécution politico-judiciaire frénétique
Les persécutions, les détentions arbitraires et les menaces de mort à l’encontre des responsables du gouvernement destitué et de leurs familles augmentent de jour en jour. Le scénario mis à l’oeuvre pour aboutir au coup d’Etat reste d’actualité, jusqu’à ce que l’objectif de la dictature de mettre fin à toute résistance au coup d’Etat soit atteint. C’est ainsi que toute personne qui puisse servir de bouc émissaire pour blanchir ses crimes continue d’être détenue à titre préventif.
Ces dernières semaines, le Bureau du Défenseur du Peuple bolivien, qui se contente de procéder à une évaluation des droits de l’homme et de dénombrer les victimes, a été harcelé et ses travailleurs ont été empêchés de mener à bien leur travail. Son représentant à Cochabamba, M. Nelson Cox, a remis en question « le rôle joué par le bureau du procureur général et la police en ce qui concerne les blocages et les protestations devant les locaux du bureau du Défenseur« , les qualifiant de permissives face à ces actes d’agression. La simple existence de cette organisation est inacceptable pour les putschistes. Enragés lors de cette petite manifestation de résistance, les représentants du gouvernement de facto incitent leurs partisans à attaquer les membres de la Defensoría même chez eux : « Ils ont fait exploser des explosifs chez moi, ils m’ont accusé d’avoir commis des actes illicites, j’ai été qualifié de narcotrafiquant, assassin, terroriste (…) on a menacé mes filles et ma famille » – a déclare M. Cox.
Loin de se contenter d’avoir pris le pouvoir par la force, le gouvernement de facto est conscient que sa légitimité ne tient qu’à un fil. C’est pourquoi la répression doit prendre une tournure importante jusqu’à l’organisation des prochaines élections. Sans tarder, des unités anti-terroristes spéciales ont été présentées en grande pompe …annonçant les prochains crimes qui resteront impunis ?
Sans crainte du ridicule, le 6 décembre, le président autoproclamé a annoncé la création d’un « comité interinstitutionnel pour la défense des victimes pour des raisons politiques et idéologiques des 14 dernières années ». Peu avant, Añez avait félicité le porte-parole des bandes paramilitaires qui terrorisaient la population aux moments décisifs du coup d’Etat, agissant avec la complicité de la police et de l’armée (incendies de maisons, lynchages, attaques racistes, etc.). Et s’il était encore nécessaire de prouver qui sont les victimes selon Añez, le même jour quatre mineurs condamnés pour la torture et le meurtre du vice-ministre de l’intérieur Rodolfo Illanes en août 2016, ont été libérés.
Le 11 novembre, la présidente et ancienne vice-présidente du Tribunal électoral suprême (TSE), Maria Eugenia Choque et Antonio Costas, ainsi que 34 membres ont été arrêtés.
Le gouverneur de Chuquisaca, Esteban Urquizu, a été arrêté à titre préventif le 27 novembre pour « abandon de ses fonctions » après sa démission le 10 novembre.
Le 3 décembre, l’ancienne ministre du Développement productif Susana Rivero Guzmán a dénoncé « les menaces de mort contre mon fils, la destruction de notre petite maison à La Paz et un climat hostile d’intimidation contre la famille. C’est pour cette raison qu’il a annoncé sa volonté de « se tourner vers les organismes internationaux de protection des droits de l’homme ».
Le 4 décembre, Idelfonso Mamani, ancien membre du TSE (Tribunal électoral suprême), a été arrêté. Voici l’accusation : « On présume que la TSE a attribué l’impression du matériel électoral à une imprimerie, mais que le travail a finalement été effectué par une autre ».
Le 6 décembre, le départ du pays de l’ancien ministre de l’Economie Luis Arce Catacora, qui a pu bénéficier de l’asile offert par le Mexique, a été annoncé. Le même jour, l’ancienne ministre de la Communication Amanda Dávila a été accusée d’avoir utilisé des fonds de la Maison d’édition de l’État pour imprimer du matériel de campagne du MAS. Dávila a dénoncé avoir été victime d’un montage par le biais d’une photo de la visite de la fille de Morales.
Cette liste non exhaustive nous permet de comprendre que ce qui est en cours est une persécution politico-judiciaire frénétique contre tous les membres des gouvernements Morales précédents, jetant une ombre de suspicion généralisé autour de la question de la corruption, afin de remettre en cause et d’effacer complètement la mémoire des 13 années du processus de changement en Bolivie, dont les avancées économiques et sociales ont été mondialement reconnues, notamment avec la réduction de la pauvreté extrême de 23%.
Confession de crimes contre l’humanité
Parce que la meilleure défense est l’attaque, le « ministre du gouvernement » Murillo, qui a incité à « chasser » les membres du gouvernement déchu et tenté d’intimider ceux qui les défendaient, a rendu publique son intention de traduire Evo Morales devant la Cour pénale internationale à La Haye « pour crimes contre l’humanité », lui reprochant les 35 victimes mortelles, même après sa démission et son exil du pays. Imputer à un président destitué la responsabilité des victimes d’un régime qui a militarisé le pays et réprimé la protestation, c’est faire preuve d’audace sans limites, ou bien se convaincre de l’impunité sur laquelle il croit pouvoir compter après la reprise des relations avec les États-Unis.
Murillo essaie sans aucun doute d’utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour inverser la victime et l’agresseur. C’est ainsi qu’il a tenté de présenter le vice-président Alvaro Garcia Linera comme un « terroriste avoué » et un « narco-guérillero », réactivant l’imaginaire des dictatures pendant la Guerre Froide. Il a aussi largement diffusé un enregistrement audio dans lequel on entendrait Morales encourager le blocus des villes afin que la population puisse résister au coup d’Etat. Qu’il s’agisse d’un document authentique ou faux, le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, clairement inspiré de la déclaration française de 1789, prévoit implicitement le droit à la rébellion dans les situations marquées par l’absence de garanties démocratiques et constitutionnelles : « Il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par une règle de droit, afin que l’homme ne soit pas contraint au recours suprême de la rébellion contre la tyrannie et l’oppression ».
Légitime, le gouvernement de facto d’Añez-Murillo a été imposé par une armée dont la première mission a été d’écraser les protestations dans le sang et de donner une leçon aux humbles habitants des zones rurales, les privant de leur droit de vote et de leur participation à la vie démocratique après des siècles d’exclusion. Sa fonction prévisible est d’occulter et de justifier la vague actuelle de répression. Mais le peuple digne de l’État plurinational de Bolivie porte sur son dos l’expérience de siècles de résistance avec détermination à la tyrannie du colonialisme et de ses successeurs. Il est temps de comprendre que les campagnes de désinformation sont un mécanisme mondial dont l’objectif est de briser la souveraineté des peuples du monde et de détruire les ponts de la solidarité. L’apôtre de l’indépendance cubaine José Martí l’a résumé d’une manière imbattable : « Les peuples qui ne se connaissent pas doivent se dépêcher de se connaître comme ceux qui vont se battre ensemble ».
Alex Anfruns
Cet article a été publié à l’origine sur le site du blog de l’auteur, Alex Anfruns.
Lire aussi :

>> Evo Morales recherché par la Bolivie, mais «n’abandonne pas le combat politique»