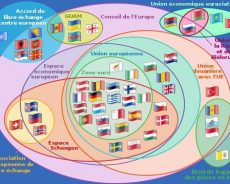par Lydia Khalil *

SYDNEY – Depuis 2018, de grands mouvements de contestation des gouvernements – parfois appelés le Printemps arabe 2.0 – secouent le Moyen-Orient. Les manifestants dénoncent la corruption, le sectarisme et la stagnation économique. Tout comme les soulèvements arabes d’il y a dix ans, ces manifestations sont parvenues à déloger des dirigeants politiques de premier plan – les Premiers ministres ont démissionné au Liban, en Irak et en Jordanie, et des dictateurs en place depuis longtemps ont été renversés en Algérie et au Soudan.
Les forces gouvernementales et les milices qui leur sont associées en Irak et au Liban ont tenté de réprimer les mouvements de protestation par la violence et l’intimidation, sans pour autant décourager les manifestants. Les autorités de ces deux pays ont alors pris exemple sur des régimes plus autoritaires de la région, comme l’Égypte et l’Arabie saoudite. Ces deux pays sont parvenus à étouffer avec plus de succès – du moins pour l’instant – toute voix dissidente, en bâillonnant les médias et en manipulant les informations, en sus des arrestations arbitraires et d’une répression violente. Aux yeux des dirigeants de ces pays, un environnement trop permissif pour les médias et les sources d’information était responsable des soulèvements qui avaient enflammé le monde arabe en 2011.
En Égypte par exemple, le président Abdel Fattah al-Sissi mène une offensive déterminée contre tout compte rendu ou analyse qui va un tant soit peu à l’encontre des intérêts de son régime et a pris le contrôle des médias au moyen de changements constitutionnels et législatifs étendus. Les arrestations ont été facilitées grâce à des lois édictées par le gouvernement égyptien qui criminalisent la diffusion de « fausses nouvelles » (c’est-à-dire des reportages qui contredisent les déclarations officielles du gouvernement). Un projet de loi qui criminaliserait la diffusion de rumeurs est également en cours d’examen, avec la mise en place d’une instance judiciaire secrète, sous l’égide du Parquet général de la sûreté d’État, chargée d’analyser ce que les gens échangent discrètement.
Le raid mené en novembre dernier par les forces de sécurités égyptiennes dans les locaux du site d’information Mada Masr, le dernier grand média indépendant du pays, n’est que l’un des exemples de l’assaut généralisé du régime contre les médias. Les policiers ont arrêté trois journalistes de la rédaction, les accusant de répandre de fausses informations et d’avoir des liens avec les Frères musulmans (considérés comme une organisation terroriste par le gouvernement). En réalité, cette perquisition avait pour objectif de discréditer Mada Masr après que le site ait publié un article peu flatteur sur le fils d’al-Sissi, Mahmoud. Dans ce cas précis, les journalistes ont été relâchés, mais d’autres n’ont pas eu cette chance.
En fait, seules la Chine et la Turquie ont emprisonné plus de journalistes que l’Égypte et l’Arabie saoudite. Dans ce dernier pays, le nombre de journalistes et d’opposants incarcérés n’a cessé d’augmenter depuis 2011. Dès son arrivée au pouvoir en 2017, le prince héritier Mohammed ben Salman (MBS) a orchestré une répression sans pitié des dissidents, dont un exemple parfait a été l’assassinat en 2018 du journaliste saoudien entré en dissidence et résident permanent des Etats-Unis Jamal Kashoggi, au consulat de l’Arabie saoudite à Istanbul.
MSB ne s’est pas cantonné aux journalistes : toute personne perçue comme critique du régime est visée. En novembre dernier, la police a arrêté huit écrivains et entrepreneurs, qui n’étaient en majorité pas des dissidents actifs. Deux d’entre eux, les écrivains Abdulmajeed al-Buluwi et Bader al-Rashed, avaient même publiquement soutenu le programme de réformes socio-économiques de MBS dans l’espoir d’atténuer des critiques passées. Comme en Égypte, les autorités saoudiennes ont accusé les personnes arrêtées d’avoir cherché à déstabiliser le gouvernement au nom d’une puissance étrangère. Cette allégation était au centre de la campagne acharnée sur les réseaux sociaux menée par Saoud al-Qahtani, le bras droit du prince héritier, ciblant les détracteurs de la monarchie saoudienne.
Ces pays, l’Arabie saoudite, l’Égypte et la Turquie, n’ont pourtant pas eu à subir de conséquences majeures, ou de sanctions de la communauté internationale, pour leur répression et manipulation des médias. Cette absence de réaction ne les a pas seulement encouragé à durcir leur appareil répressif : elle a également incité d’autres gouvernements confrontés à des manifestations populaires de recourir aux mêmes méthodes.
En Irak, le gouvernement a accusé les médias de se faire l’écho de la frustration populaire à l’origine des grandes manifestations contre la corruption, le chômage, la déliquescence des services publics et l’ingérence de l’Iran dans les affaires intérieures. En novembre 2019, la Commission irakienne de l’information et des communications a suspendu les émissions de Dijlah TV, une chaîne irakienne basée en Jordanie, et temporairement fermé ses bureaux à Bagdad, ainsi que ceux de 11 autres chaînes de télévision et stations radio locales, pour avoir prétendument « violé les règles d’octroi de licences ». La commission a également lancé un avertissement à l’encontre de cinq autres organisations, les invitant à « adapter leur discours » sur les manifestations aux règles de diffusion.
Des journalistes ont également été détenus par les forces de sécurité et ciblés par les milices qui leur sont associées. L’an dernier, des hommes armés non identifiés ont envahi les locaux de quatre radiodiffuseurs à Bagdad, saccageant les studios et les bureaux, volant du matériel et agressant les employés. Le gouvernement a coupé le service Internet à de nombreuses reprises pendant les manifestations, entraînant des pertes considérables pour l’économie irakienne.
Au Liban, souvent perçu comme une oasis de liberté des médias dans la région, le gouvernement a de plus en plus eu recours à l’intimidation et à l’arrestation des voix dissidentes pour tenter de juguler le mouvement de contestation populaire qui a éclaté en octobre 2019. Les griefs des manifestants concernant l’incompétence et la corruption du régime, et la mainmise de l’élite politique sur le gouvernement, peuvent aisément être transformées en accusations de fomenter le sectarisme, ce qu’interdit la Constitution libanaise. La diffamation est un autre chef d’accusation utilisé pour discréditer les manifestants et les journalistes.
Les partisans des partis au pouvoir au Liban ont rassemblé leurs forces pour intimider les manifestants et fait pression sur les fournisseurs de services pour que ceux-ci ferment les comptes des leaders de la contestation et des journalistes de renom sur les réseaux sociaux. Ces comptes revêtent une importance cruciale, car les médias libanais traditionnels, contrôlés par les partis politiques, n’ont pour ainsi dire pas couvert les manifestations. Les médias contrôlés par les partis politiques ont également diffusé de fausses informations et affirmé que des puissances étrangères soutenaient le mouvement de contestation dans le but d’affaiblir le Liban.
Il est toutefois évident que les gouvernements irakien et libanais n’ont pas su appliquer les tactiques de suppression des informations pour mater leurs citoyens avec le même succès que les régimes autoritaires des pays voisins. Les manifestants semblent déterminer à poursuivre la lutte jusqu’à ce les gouvernements répondent véritablement à leurs demandes et museler les médias n’a servi qu’à donner naissance à des moyens alternatifs de diffusion de l’information.
Les régimes autocratiques ont depuis longtemps compris qu’il était plus facile et plus efficace de discréditer ou d’interdire les médias que de recourir à la violence pour se maintenir au pouvoir, même si ce contrôle se fait aux dépens de l’ouverture et du dynamisme économique dont ces pays ont désespérément besoin. La conjoncture en Irak et au Liban laisse toutefois penser que cette approche a ses limites. Bien que ces deux pays soient confrontés à de graves problèmes structurels et que les journalistes, les écrivains et les intellectuels courent des risques au quotidien, la dépendance de leurs systèmes politiques à des arrangements de partage du pouvoir entre factions empêche que les voix dissidentes soient entièrement réduites au silence.
*Chargée de recherche du programme sur l’Asie de l’Ouest du groupe de réflexion australien Lowy Institute