Au moment où on s’apprête à prendre des résolutions de fin d’année, je me suis surpris à rêver que la darija est enfin officialisée et qu’à l’instar de tamazight, elle peut jouir de ses droits nationaux.
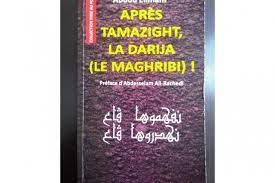
Alors, à supposer que tel est le cas, que va-t-il se passer de nouveau? Pour faire court, je me propose d’examiner quatre secteurs stratégiques pour notre vie de nation qui en seraient directement bénéficiaires.En premier lieu, son rapport à la langue arabe, langue d’État.
La collaboration de la darija à la couverture sociolinguistique de l’arabe va enfin devenir explicite et transparente. En effet, de nos jours, les deux langues collaborent certes quotidiennement, mais la partie « darija » des échanges est refoulée car politiquement « non-correcte». En mettant un terme à cette hypocrisie sociale, on finira par admettre et prendre acte des fonctions sociales et culturelles que les deux langues ont commencé à partager, il y a plus de 10 siècles. L’arabe pour la lecture du Coran et pour couvrir les exigences juridiques, administratives et scientifiques. Le maghribi / darija, pour assumer les échanges sociaux quotidiens, la production culturelle nationale et l’ancrage identitaire. Cette situation de transferts linguistiques entre les deux langues est telle que l’on ne s’en aperçoit même plus. Alors qu’il est possible de bien distinguer/respecter les deux, selon la fonction prise en charge. Assumer ce bilinguisme positif profitera aux deux langues. De même qu’il profitera aux variétés amazighes face à l’arabe et au maghribi / darija.
En second lieu, son rapport à l’émergence d’une citoyenneté assumée
Une fois le veto sur la darija levé, les locuteurs natifs vont progressivement libérer leurs pulsions communicatives pour s’affirmer et donner corps à une citoyenneté en herbe. Le citoyen est avant tout un négociateur de sens via la parole; une parole circulante et partagée. Sa mise en marge actuelle du marché du sens linguistique l’exclut du débat national et de toute implication politique responsable. Ceci est clairement mesurable aux taux effectifs de participation aux différents scrutins, depuis des années. Cette exclusion – de fait – de la sphère citoyenne favorise les fuites en avant extrémistes et donne du crédit aux vendeurs d’illusions populistes qui se présentent comme alternatives sincères et sérieuses.
Un tel terreau entretient un mal-être endémique et favorise toutes les formes contemporaines de comportements de «non-concernés» (fuites en avant, Harga, drogue, etc.). Renouer avec une parole digne et respectée dans une langue de naissance digne et respectable, tel est le chemin simple, économique et pertinent d’accès à la citoyenneté.
En troisième lieu, son rapport à l’enseignement, du primaire au supérieur
Les humains naissent avec un potentiel de langage gravé dans leur cerveau ; c’est du contact de ce potentiel biologique avec la socialisation précoce que durant les deux premières années de leur vie, ils construisent une matrice linguistique que l’on appelle parfois «langue maternelle» alors qu’elle est « langue de naissance», plutôt. Cette matrice linguistique s’élabore de l’enrichissement cognitif (l’ensemble des expériences vécues) pendant qu’une dynamique naturelle s’empare de la capacité de parole et de cognition, à la fois. Lorsqu’à l’âge de 5/6 ans, l’enfant est au seuil de l’école, il est déjà un être de langage, capable de parole et d’intelligence. Les pédagogues qui ont intégré cette réalité à leurs théories sont parvenus à émettre un principe universel: mettre l’apprenant au centre. Or l’apprenant est un être parlant et mû par une subjectivité entièrement ancrée dans sa culture environnante. Lorsque l’école le met face à une autre langue que celle qui l’a vu naître et venir à la socialisation, il est désarmé, vidé et désemparé. A quoi peut-il bien s’accrocher? Comme on fait table rase de son potentiel culturel et linguistique considérés comme souillés, le seul salut se présente sous la forme de la mémorisation. Là est la caractéristique essentielle du système éducatif algérien, depuis le primaire jusqu’au supérieur. Et l’on s’étonne que l’esprit critique soit absent et que notre pays soit si mal noté dans les classements mondiaux?
Si l’entame de la scolarisation s’effectuait dans la langue de naissance, l’être humain que l’on prépare à une vie d’adulte serait à son aise et développerait ses potentialités cognitives, linguistiques, créatrices et culturelles. Rien n’empêche d’introduite la langue d’État dès la troisième ou quatrième année comme le conseillent vivement tous les experts mondiaux, l’Unesco, la Banque Mondiale et bien d’autres organismes.
En quatrième lieu, son rapport à la Culture nationale
Soyons clairs: comment produire/entretenir une culture nationale avec une langue trans-nationale? L’arabe est une langue partagée, qui, par définition, n’appartient à aucune nation. Son rôle est certes fédérateur, mais il n’est pas producteur de valeurs locales, de valeurs nationales. Seules les langues natives permettent de s’ancrer dans une culture qui nous pré-existe et que nous enrichissons. L’exclusion des langues natives nationales depuis près de 60 ans aura contribué à affaiblir lourdement ce que des générations ont semé depuis des siècles. Notre âme sociale est dévitalisée en bonne partie et cela se ressent dans une culture nationale faite de bric et de broc, avec l’accent mis sur un folklore reconstruit à partir d’un passé mythifié et bridé. Tel est le cas de «nos» danses, bijoux berbères, fantasias et quelques vêtements et mets. Quant à notre littérature maghribie/darija de mille ans, on la réduit à une exploitation laborantine de la poésie dite « melhûn ». Notre histoire, pour sa part, deux schèmes caricaturaux se la disputent: le mythe d’une hégémonie berbère, d’un côté, et l’encensement d’une arabité que l’on confond avec une islamisation effective et profonde, de l’autre. Nous avons de moins en moins d’artefacts culturels qui nous soient propres; nous sommes démunis et nous ne voyons pas que derrière cette indigence se niche la question linguistique. Jusqu’où pourrions-nous continuer de la sorte?
Alors, au moment où nous passons à l’année du soixantième anniversaire de notre indépendance, ne pourrait-on pas accorder un peu de crédit à cette question, pourtant si cruciale ? Je lance cette invitation à nos chers élus de la Nation et à tous nos compatriotes jaloux du bien-être de notre nation.
Bonne nouvelle année.
*Linguiste
 La troisième langue
La troisième langue
par Belkacem Ahcene-Djaballah
Il y a de cela un certain temps (plusieurs années), un «économiste et universitaire», intervenant lors d’une rencontre sur «la pratique de la langue arabe dans le monde des finances et des affaires», a appelé les décideurs politiques à «imposer l’application de la loi portant généralisation de la langue arabe et à sanctionner tout contrevenant».
Résultat des courses: une langue française devenue un «pataouète» imbuvable, pire que celui des «pieds-noirs « de Bab El Oued, une langue arabe précieuse, et la naissance d’une troisième langue, comprise seulement par les Algériens ; langue sans règles que l’on entend à la radio, que l’on «voit» à la télé, dans la rue … et même dans les discours politiques. Un étrange mélange d’arabe parlé, d’arabe littéraire, de français violenté et de tamazight (version Centre du pays) ! Puis, un plus tard, tout récemment, vinrent d’autres «doktours », cette fois-ci Phd…istes qui, du haut de leurs postes de «responsabilité » enfin conquises, demandèrent que le français (ce qui en restait, tout du moins) soit «éradiqué» et devait être remplacé par l’anglais, comme si les algéro-anglophones couraient les rues et/ou qu’ un accord de coopération avec une ou plusieurs universités américaines ou anglaises allait résoudre le problème et/ou qu’une « injonction » administrative , émise à la va-vite, allait résoudre un problème créé de toutes pièces en invoquant la « présence » de l’anglais dans le monde de la recherche scientifique. Que d’injonctions, que de projets, que de menaces dans un pays qui n’occupe -selon l’organisme international de voyages linguistiques, Ef- en matière de maîtrise de la langue de Shakespeare que la 75è place (Alger 492 ème).
Pour l’instant, la langue arabe poursuit son bonhomme de chemin lentement mais sûrement en compagnie de l’arabe algérien qui est train (peut-être) de se construire comme se sont construites, par le passé, bien des langues dans d’autres pays, le tamazigh est en train de se frayer son chemin recherchant la piste la plus sûre et la plus rassembleuse et, en attendant l’anglais, le turc, le chinois, le russe, l’italien ou … le français d’Algérie (et non celui de la Macronie et de la Zemmourie) reste bien présent. Hélas ou heureusement, la question est toute politicienne et le citoyen lambda n’en à rien à f… avec pour seule préoccupation, pour l’instant, la lecture de sa fiche de paie et les prix affichés de produits de consommation. Tous en chiffres … arabes !
Le complexe arabe ou les identités meurtrières…
par Kamal Guerroua
Jusqu’à présent, j’ai lu plus de cinq fois l’ouvrage «Les identités meurtrières», du Libanais Amin Maalouf : deux fois dans mon pays natal et trois fois dans des pays étrangers, et j’avoue que mon impression n’était pas toujours la même. J’éprouve, à vrai dire, un sentiment d’ambivalence et d’incertitude à la fin de chacune de mes
Loin de tout esprit de polémique ou de division, je voudrais revenir un peu ici sur ce «complexe arabe», nourri par nos aînés, comme un succédané à une culture nationale en effritement constant, suite à de longs siècles de dégénérescence et d’abandon. Quand on parle des Arabes, par exemple, on trouve que, sur le plan ethnique, ils sont le produit d’un profond métissage avec les peuples de l’Empire musulman, asiatiques, africains, européens même, sans parler bien sûr des Arabes d’origine comme du fond de la population, lui-même mélangé : nabatéen, chaldéen, et araméen en Syrie-Irak comme au Liban, Jordanie et Palestine; berbère au Maghreb, et d’autres composantes moins importantes que les Arabes ont rencontrées sur leur chemin. En conséquence, il est permis de dire que la nouvelle société arabe est constituée beaucoup plus de populations arabisées que d’Arabes d’origine. Et c’est grâce à l’islam qu’une telle diversité de peuples et d’ethnies a pu trouver dans la langue et la culture arabes l’instrument de sa cohésion. Cela ne peut pas aller sans provoquer des problèmes ou des crises d’identité au contact du modèle de l’Etat national moderne, et par conséquent du recul effectif du sentiment religieux y afférent. C’est toute l’ambiguïté de la situation. Une ambiguïté qui s’est cristallisée, au demeurant, par le mythe du Monde arabe, posé par certains idéologues de l’arabo-baâthisme du siècle dernier, en particulier Michel Aflaq et Salah-Din El Bitar, comme un sacerdoce pour l’unité des peuples «ethniquement» et «culturellement» différents mais dont la culture arabe est «hégémonique». Ce mythe fut mis au-devant de la scène politico-culturelle pendant des décennies, au nom de la résurrection de l’âme arabe et surtout d’une laïcité, à même de servir d’abri pour les minorités de l’Orient, notamment celles chrétiennes, menacées de persécution constante de la part de groupes extrémistes musulmans, démographiquement en surnombre. Cette logique a trouvé, toutes proportions gardées, un terrain fertile en Afrique du Nord, où les nouvelles dictatures installées après les indépendances nationales furent, politiquement faibles et géo-stratégiquement isolées.
L’héritage colonial de la France a laissé un avant-goût d’amertume chez les élites maghrébines, coupées de leurs racines et acculturées soit à l’Occident (francophones), soit à l’Orient (arabophones), délaissant la culture-matricielle, le Berbère, accusée de tous les maux complotistes, contre le diptyque Arabe-Islam. A titre d’exemple, l’Arabo-bâathisme en terre algérienne, fut très différent de celui pratiqué en Orient, dans la mesure où l’islamisme avait investi, même au temps de Boumediene, le secteur éducatif et culturel, inséminant son poison dans les cerveaux de presque trois générations de jeunes. Ce qui aurait provoqué une dangereuse crispation identitaire, ayant alimenté des haines et des sentiments d’adversité des uns contre les autres, au sein du même peuple, et une opposition farouche contre nos racines berbères communes. En vérité, le Maghreb fut de tout temps otage de ces «identités meurtrières qui, au lieu de l’enrichir, l’ont en quelque sorte abâtardi. Quand ce n’est pas l’Occident qui instrumentalise à sa guise sa culture, c’est l’Orient qui le fait et cette bipolarité Orient-Occident a cassé le génie local, rendu incapable de s’ancrer, sinon de s’attacher à l’identité algérienne, diverse, riche et plurielle.




