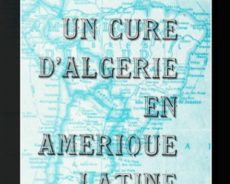![]()

Par Arezki Ighemat, Ph.D in economics
Master of Francophone Literature (Purdue University, USA)
“The Arab Spring, properly understood, was not a failure, but at least a partial success” (Hugh
Roberts, Loved Egyptian Night: The Meaning of the Arab Spring, Verso, 2024)
“The hijacking of the Arab uprisings by Western powers has been effected by their success in
Substituting for profound change a purely superficial regime change that merely means the
Ejection of a ruler they have never liked (Saddam, Qadhafi, Asad) or have no further use for
(Mubarak) and his replacement by someone they approve of. In seeking this change in their own
Interests, they have repeatedly shown a reckless disregard for the consequences of their policies,
From Iraq to Egypt, to Libya, to Syria” (Hugh Roberts, op. cit., p. 91).
INTRODUCTION
Ainsi que Hugh Roberts l’indique dans les premières lignes de son livre, intitulé « Loved Egyptian Night : The Meaning of the Arab Spring », publié chez Verso en 2024, l’objet du livre est de retracer l’histoire des politiques des révoltes ayant eu lieu dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, notamment en Libye et Egypte, au début de 2011 et d’analyser chacune d’elles dans une perspective comparative, notamment avec la révolte tunisienne de 2010. Il aboutit à la conclusion que ces révoltes—qui sont considérées par une grande partie des citoyens de ces pays et par les observateurs et les médias occidentaux comme des révolutions—ne le sont pas en fait et que la seule révolte qui mérite ce nom—même si Hugh Roberts ne lui consacre pas un chapitre spécifique—est celle intervenue en Tunisie en 2010 à la suite de l’immolation de Mohamed Bouazizi.
Hugh Roberts met l’accent, dans son livre, sur les cas Lybien et Egyptien, tout en les comparant avec les autres cas en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En particulier, il compare ces deux révoltes à la révolte de 2010 en Tunisie qu’il considère comme une révolution au sens véritable du mot. Par conséquent, avant d’aborder les deux cas principaux étudiés par l’auteur dans son livre—la Lybie et l’Egypte—nous résumerons d’abord sa pensée sur la révolution tunisienne.
LE PRINTEMPS TUNISIEN : UNE REVOLUTION STRICTO SENSU
Ayant une connaissance profonde de la vie politique dans les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie et Maroc) et du Moyen-Orient, et après avoir étudié les révoltes ayant eu lieu dans ces pays au début des années 2010 dans le cadre de ce qu’on a appelé les « Printemps Arabes », Hugh Roberts montre que l’insurrection de 2010 intervenue en Tunisie—appelée « Révolution du Jasmin » ou « Révolution du Sourire »–est une révolution stricto sensu. Il commence par définir ce qu’est une révolution : « J’ai toujours soutenu le point de vue selon lequel une révolution politique complète est celle qui établit un nouvel Etat à la place de l’Etat qu’elle renverse… » (p.112, notre traduction). Ou encore : « Une révolution politique est un moment, bref ou étendu selon le cas, de changement radical d’un type d’Etat et forme de gouvernement à un autre » (p.127, n.t).
Pour lui, la révolte de 2010 en Tunisie est une révolution dans le sens donné ci-dessus : « L’insurrection en Tunisie a fait plus qu’évincer le Président Zine el Abidine Ben Ali ; elle a mis fin au monopole du parti au pouvoir sur lequel la dictature de Ben Ali reposait et a ensuite tracé la voie à une démocratie incluant la légalisation de plusieurs partis politiques et l’organisation d’une élection devant établir une Assemblée constituante » (Préface, p. xii, n.t). Roberts poursuit en disant : « La révolte n’a pas fait qu’éjecter un autocrate, elle a transcendé et laissé derrière elle le système qui a rendu sa dictature possible, et donc elle a tous les droits de se faire appeler révolution » (Préface, p.xii, n.t). L’auteur dira encore : « The Tunisian revolution was a real revolution, not because it toppled Ben Ali, but because it went on to establish a new form of government with real political representation and the rule of law” (La révolution tunisienne est une vraie révolution, non pas parce qu’elle a renversé Ben Ali, mais parce qu’elle est allée jusqu’à établir une nouvelle forme de gouvernement avec une réelle représentation et l’Etat de Droit) (p. 91, n.t).
Comparant la révolution tunisienne avec la révolte égyptienne, il dira qu’une autre différence fondamentale entre les deux est dans la nature de leurs partis au pouvoir. Il explique qu’en Tunisie, « le parti au pouvoir—le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, RCD—était la source du pouvoir, et donc mettre à bas le parti équivalait à ouvrir la voie au pluripartisme, à des élections démocratiques et à l’Etat de Droit, et que, parce que le Président Ben Ali contrôlait le RCD, le renverser était l’élément préliminaire qui allait permettre de briser le Parti unique » (pp. 169-170, n.t). A l’inverse, « en Egypte, le NDP (National Democratic Party), était une simple façade et non la source du pouvoir où les décisions étaient prises. La source du pouvoir était l’armée qui déléguait le pouvoir présidentiel à un des siens sous certaines conditions non dévoilées » (pp.169-170, n.t). Par la suite, poursuit Roberts, « détrôner le NDP n’ouvrait pas la voie à la démocratie et à l’Etat de Droit et n’a fait qu’endommager la façade du régime, laissant la substance de la structure du pouvoir intacte… et que renverser Mubarak ne menaçait pas le rôle de l’armée comme source du pouvoir » (pp.169-170, n.t).
Pour Roberts, « le RCD en Tunisie a joué un rôle vital dans la révolution de 2010 et dans la quête du peuple tunisien d’un Etat démocratique : il a confiné l’armée au rôle mineur de serviteur loyal de l’Etat ; il a subordonné l’Islam à la ‘raison d’Etat’ ; et il a permis à l’Etat de promouvoir une vision exceptionnellement avancée des droits et du statut des femmes » (Préface, p.xiii, n.t). A cela, dit Roberts, « il faut ajouter deux autres facteurs : la nature de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens, UGTT et l’importance de la tradition constitutionnelle » (Préface, p.xiii). Concernant particulièrement cette dernière—la tradition constitutionnelle—Roberts dira : « Finalement, le règne du parti [RCD] de 1956 à 2010 a contribué, de façon décisive, à préserver la mémoire collective du constitutionnalisme comme tradition fondatrice de la politique tunisienne et, par suite, un élément important—le poteau indicateur, la mesure, et la boussole—dans la conscience sociale du peuple tunisien » (Préface, pp.xiv et xv).
LE PRINTEMPS LIBYEN
Hugh Roberts pense que l’insurrection du 2 février 2011 en Libye—appelée « Révolution de la Dignité »–n’est pas une révolution dans le sens indiqué précédemment, mais plutôt « une addition à la liste des guerres occidentales, ou appuyés par l’Occident, contre des régimes considérés hostiles, défiants, insuffisamment fidèles, ou voyous » (pp.1 et 2). Il cite une longue série de ces guerres : « Afghanistan I et II (1979-1992), Iraq I et II (1990-1991 et 2003), la République Fédérale de Yougoslavie (1999), Panama (1989-1990), Sierra Léone (2000), Côte d’Ivoire (2011) » auxquelles il ajoute des guerres plus anciennes : « la Baie des Cochons (1961), l’intervention au Congo (1964), le coup à Oman (1970) et les tentatives de renversement de Qadhafi en 1971 et 1973 dans ce qui est appelé le ‘Hilton Assignment » (pp.1 et 2, n.t).
Roberts dit que la révolte libyenne n’est pas une révolution pour deux raisons : « la fragilité des institutions politiques libyennes et son statut de non-Etat » [d’une part], et l’implication des forces extérieure, [d’autre part] ». Concernant les institutions Libyennes, Roberts dira que la Jamahiriyya, proclamée en 1977—appelée ‘Etat des masses »–est basée sur deux types de structures politiques : les « Congrès Populaires » et les « Comités Révolutionnaires », « les premiers ayant pour tâche d’assurer la gouvernance du pays et d’encourager la participation populaire, les seconds étant chargés de garder vive la flamme révolutionnaire » (p.13, n.t). Il dira aussi que « la Jamahiriyya nie totalement le rôle des partis politiques qui, dit-il, sont antinomiques avec l’Islam dans le sens où ils sont une source de ‘fitna’ (division) ». Il cite Qadhafi qui a déclaré en 1977, en effet, que « la seule source du pouvoir est le Coran ». Ce qui a fait durer le régime Qadhafi, selon l’auteur—qui cite l’anthropologue anglais John Davis dans son ouvrage ‘Lybian Politics : Tribe and Revolution. An Account of the Zuwaya and the Government, IB Tauris, 1987—c’est que ce ‘non-Etat’ est une ‘hydrocarbon society’ (Une société des hydrocarbures) et un « Distributive State » (Un Etat distributeur) », qui sont devenus « the central element of their strategy for governing the country, given the dilemma they faced over the question of political institutions” (ces deux éléments sont devenus l’élément central de leur stratégie de gouvernance du pays, compte tenu du dilemme auquel ils font face concernant la question des institutions politiques) (p.5, n.t).
Toujours selon l’auteur, dans ce système politique à deux structures contradictoires—ce qu’il appelle le ‘secteur informel’—Qadhafi jouait en quelque sorte le rôle d’arbitre « exerçant un degré d’hégémonie sur ce secteur informel qui n’a aucune contrepartie contemporaine » (p.16, n.t). Il conclut sur ce point en disant—se référant au Roi-Soleil en France—« le Roi, c’était Lui », et que ce qui légitimait son pouvoir hégémonique était l’idée mystique de révolution » (p.16, n.t). Un dernier élément intérieur ne justifiant pas, selo l’auteur, d’appeler « révolution » la révolte Libyenne est «le rôle joué par l’armée. L’armée Libyenne, en effet—loin de constituer une force d’arbitrage—« était dans l’impossibilité de jouer un rôle politique indépendant » (p.22, n.t).
La seconde raison qui explique, selon Roberts, que l’insurrection en Libye n’est pas une révolution est le rôle joué par les puissances extérieures (occidentales et arabes) dans le renversement de Qadhafi et dans la résolution—mais en partie seulement—du conflit entre le régime Qadhafi et les insurrectionnistes.
Roberts indique que, en dépit de toutes les propositions de solutions pacifiques pour trouver une fin à ce qui était devenu une ‘guerre civile’, les puissances occidentales—avec l’accord et le support des pays arabes et du Conseil de Sécurité—ont opté pour intervenir, prétextant que c’était là « le seul moyen d’arrêter la répression du régime et de protéger les civils » (p.24, n.t). Roberts dira que, avec l’assentiment du Conseil de Sécurité, « Londres, Paris et Washington se sont permis—avec l’intermédiaire de l’OTAN—de faire ce qu’ils voulaient quand ils le voulaient tout en sachant parfaitement qu’ils ne seraient jamais rendus responsables puisque, en tant que membres du Conseil de Sécurité, ils sont au-dessus des lois » (p.26, n.t).
Roberts souligne aussi les effets désastreux de cette intervention qui, dit-il « elle a provoqué la mort de milliers de civils ; elle a ôté toute base à l’idée de démocratie ; elle a enlevé le sens à l’idée du Droit et elle a fait passer une révolution fabriquée comme si elle était la chose réelle » (pp. 36-37, n.t). L’auteur termine en disant que « l’intervention s’est appuyée sur deux hypothèses qui étaient, en fait, des ‘mystifications réitérées à plusieurs reprises parce que cruciales pour justifier la guerre des puissances occidentales : que Qadhafi était en train de tuer son peuple, et qu’il avait perdu toute légitimité » (pp.36-37, n.t).
LE PRINTEMPS EGYPTIEN
Dans le chapitre 2, intitulé « Loved Egyptian Night », Roberts passe au peigne fin la révolte égyptienne, appelée « Révolution de la Liberté », « Révolution de la Jeunesse « ou encore « Révolution Blanche ». Comme dans le cas Libyen, Roberts dira que la révolte égyptienne n’est pas une révolution pour deux types de raisons : des raisons internes et des raisons externes.
Au plan intérieur, Roberts dira que, contrairement au cas tunisien, la révolte du 25 janvier 2011 en Egypte n’est pas une révolution, mais « une révolte populaire ayant perdu l’initiative parce qu’elle n’avait pas d’agenda ou de demande positive » (p.52, n.t). Il explique que « Bread, freedom, social justice are not political demands, just aspirations and slogans […] But a movement that wants these desirata provided by government and, at the same time, wants the government to clear off, has a coherence problem” (Le pain, la liberté, et la justice sociale ne sont pas demandes politiques, [ce sont] uniquement des slogans […] Mais un mouvement qui veut que ces desirata soient satisfaits par le gouvernement et, en même temps, veut que le gouvernement dégage, a un problème de cohérence) (p. 52, n.t).
L’auteur dira que « la seule demande politique qui importait était le départ de Mubarak (Irhal !), demande que le commandement militaire avait reprise à son compte et tournée à son avantage » (p.53, n.t). Roberts poursuit en disant que « lorsque les protestataires égyptiens avaient détruit le siège du Parti National Démocratique de Mubarak, ils n’étaient pas en train de s’attaquer à la source du pouvoir, mais seulement à sa façade. L’armée était la source du pouvoir politique depuis 1952 » (p.52, n.t). Il compare le rôle joué par l’armée dans la révolte égyptienne à celui joué par l’armée algérienne depuis 1962 et même avant, écrivant : « En Algérie en 1962, comme en Egypte depuis 1952, l’armée était la source du pouvoir, pas le parti, qui n’était qu’un appareil d’Etat soumis au contrôle étroit du président et des services d’intelligence—une coquille vide, comme l’avait un jour admis Boumediene » (p.65, n.t).
Roberts souligne le rôle majeur joué par l’armée égyptienne. Il dira que « la chute de Mubarak n’as pas eu lieu en tant que réalisation d’une révolution ; c’était plutôt l’accomplissement d’un coup militaire entrepris derrière le dos du mouvement de protestation qui, n’ayant aucun sens de la direction à suivre et aucune idée précise de l’objectif à atteindre en partant de Tahrir Square, demandait le départ de Mubarak comme une fin en soi, c’est-à-dire comme un fétish » (p.153, n.t). Il ajoutera que « ce coup a été aidé par le support des puissances extérieures : « They could not overthrow Mubarak on their own but only with the help of the army and/or an external force” (ils ne pouvaient pas renverser Mubarak par eux-mêmes, mais seulement avec l’aide de l’armé et/ou d’une force extérieure) (pp. 169-170, n.t). A propos de la force extérieure, il dira précisément : « The bridge was constructed not by any of the insurgents, but by external powers in every case” (Le pont était construit non pas par les protestataires, mais par les puissances extérieures dans chaque cas) (p.107).
CONCLUSION
Comme la seconde partie du titre de l’ouvrage de Hugh Roberts l’indique—The Meaning of the Arab Spring—le livre a permis de poser la question de la signification des « Printemps Arabes », en commençant par les noms donnés aux révoltes du début de la décennie 2010 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cependant, au-delà des questions de terminologie, et en dépit du fait que l’étude s’est focalisée sur deux cas seulement—la Libye et l’Egypte—le livre de Hugh Roberts a permis d’analyser les forces en présence dans ces révoltes : le rôle des protestataires, de l’Etat (lorsque ce dernier existe), des forces armées et des services d’intelligence, des puissances occidentales, des pays arabes et de l’ONU.
L’auteur a montré—faits et chiffres à l’appui—que ces révoltes n’étaient pas seulement le fait des forces intérieures, mais qu’elles étaient aussi le fait des forces extérieures qui y étaient impliquées soit directement—comme dans le cas Libyen—soit indirectement dans les autres pays où ces révoltes avaient eu lieu. Dans la majeure partie des pays, l’implication des puissances extérieures était motivée par un changement de régime, comme l’explique clairement Hugh Roberts dans le passage suivant (placé en épigraphe tout en haut du présent article) : « Le détournement des révolutionnaires par les puissances occidentales a été effectué grâce à leur succès dans la substitution, à la place d’un profond changement, d’un changement purement superficiel qui signifie simplement l’éjection d’un dirigeant qu’ils n’ont jamais aimé (Saddam, Qadhafi, Asad) ou dont ils n’ont plus besoin (Mubarak) et son remplacement par quelqu’un qu’elles approuvent.
En voulant ce changement, pour leurs propres intérêts, elles ont, de façon répétitive, montré un mépris caractérisé pour les conséquences de leurs politiques, en Irak, en Egypte et en Syrie » (p.91, n.t). Une telle implication des puissances extérieures est souvent facilitée, selon Roberts, par la faiblesse de la gouvernance des pays arabes, ainsi qu’il le souligne dans la phrase suivante : « In the Arab countries, government had long ceased to be ‘res publica’, if it ever had been » (Dans les pays arabes, le gouvernement a cessé depuis longtemps d’être une République, s’il l’a jamais été » (p.60, n.t).