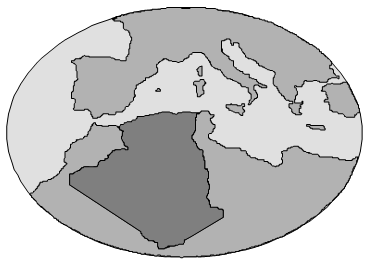Par Arezki Ighemat, Ph.D in economics, Master of francophone literature (USA)
« Quand l’écrivain sort ses griffes, cela ne signifie en aucun cas qu’il est devenu un diable ou un monstre. Au contraire, les griffes de l’écrivain ne sèment ni violence ni brutalité ; elles exhument plutôt les étoiles enfouies dans la tête du lecteur […] Dans cet ouvrage [Les griffes de l’écrivain, d’Amin Zaoui] ‘l’écriture’ bourgeonne de griffes. Une écriture qui n’hésite pas à creuser dans des terres torrides, hantées de sujets brûlants et piquants […] La vie est un champ de bataille où l’écrivain est cette luciole éclairant la noirceur quotidienne » (Amin Zaoui, l’écrivain, Dalimen Editions, 2025, p. 5). «
[..] L’écrivain n’est pas seulement un écrivain. Il est un homme, un citoyen, et il doit prendre position d’autant qu’il est écrivain, parce qu’il est un citoyen qui a un pouvoir d’expression qui peut être multiplié, qui peut porter et faire avancer une idée ou une cause » (Kateb Yacine, Le poète comme boxeur, entretiens 1958- 89, Editions Seuil, 1994, p. 146).
« Lorsque nous mettons des mots sur les maux, les dits mots Deviennent des mots dits et cessent d’être maudits » (Guy Corneau Les Fées des mots et des maux).
Dans le contexte régnant aujourd’hui en Algérie, caractérisé par le harcèlement et la répression contre les intellectuels en général et contre les écrivains et journalistes en particulier—voir les cas récents du journaliste Saad Bouakba et de l’écrivain Boualem Sansal—il est opportun de rappeler que les intellectuels algériens, qu’il s’agisse de ceux en exil ou de ceux qui résident en Algérie, adorent leur pays d’origine et ne lui veulent et ne lui souhaitent aucun mal. Au contraire, ils souhaitent et militent pour que leur pays retrouve son aura des années de guerre de libération et des années qui ont suivi son indépendance. Un pays dont le peuple a mis fin à cent trente-deux de colonisation sauvage, pour ne parler que de la plus récente. Les intellectuels algériens et les écrivains algériens ont joué un rôle crucial dans cette longue et douloureuse bataille de libération politique et de décolonisation économique et culturelle, par leurs positions et leurs écrits.
Aujourd’hui que leur pays est libéré du joug colonial, ils poursuivent ce combat pour une Algérie développée, juste, équitable, et démocratique. Lorsqu’ils s’insurgent et s’indignent—comme ils l’ont fait au cours de la période coloniale—contre toutes les injustices et contre toutes les formes de restrictions et de répressions que les intellectuels subissent de la part des autorités au pouvoir, censées promouvoir le bien-être de la population, cela ne veut nullement dire qu’ils sont contre leur patrie adorée, mais plutôt contre une gouvernance qui empêche la création intellectuelle et toute idée non conforme aux orientations officielles de s’exprimer librement. Ils s’indignent et expriment leur inquiétude lorsqu’ils voient des intellectuels—journalistes, militants des droits humains, écrivains, poètes, etc—être harcelés quotidiennement et souvent jetés en prison simplement parce qu’ils ont exprimé leurs opinions dans leurs écrits ou sur les médias sociaux et qu’ils ont dit leur désaccord sur ces pratiques qui ne sont pas dignes d’un pays dont le slogan est pourtant bien clair et fort : « République Démocratique et Populaire ».
Les intellectuels algériens, et les écrivains en particulier, ne critiquent pas ces pratiques pour faire du mal à leur pays. Un pays ne peut être que ses habitants, peuple et gouvernants, en font. Ils ne font ni médire—dire du mal du pays–ni maudire leur pays. Ce qu’ils font, c’est tout simplement « mots-dire »–exprimer par des mots leur indignation et leur mécontentement sur ce qu’est devenu leur pays aujourd’hui—afin de « maux-dire », c’est-à-dire décrire les maux et les maladies qui frappent le pays de nos jours et ce afin de trouver les solutions et des remèdes les plus appropriés à ces maux. C’est à la fois leur devoir—éclairer le peuple et les pouvoirs publics sur les politiques qui ne vont pas dans le sens des préoccupations et des souhaits des Algériens et des Algériennes—et leur droit, reconnu par la Loi Suprême de l’Etat.
Ce diagnostic des maux que connaît le pays fait par ses intellectuels est absolument indispensable si on veut que l’Algérie se mettre sur les rails d’un développement intégré et intégral et d’une véritable démocratie participative. Il est donc souhaitable que la politique et l’attitude des autorités vis-à-vis de son élite intellectuelle aillent dans le sens de l’encouragement de l’expression libre des opinions plutôt que dans le sens de leur étouffement, comme c’est le cas aujourd’hui./