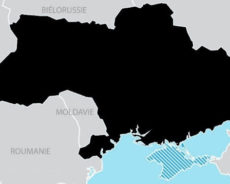Résumé
Résumé
Dans un contexte de crise économique, la question du maintien des capacités industrielles françaises en matière de défense se pose. Alors que cette industrie revêt une importance économique et sociale non négligeable, la réduction des dépenses publiques engendre une nécessaire adaptation qui s’inscrit au-delà de la logique nationale.
En effet, si la France a historiquement démontré sa puissance et son indépendance en matière d’industrie de défense européenne, elle n’occupe qu’une place relative sur la scène mondiale. Son développement fut longtemps déterminé par une dépendance à la commande publique. La place prépondérante de l’État était synonyme de préservation de la souveraineté technologique nationale, et visait à maintenir l’indépendance du pays dans la conduite de sa politique étrangère. En outre, la stratégie politique et militaire de la France s’inscrit dans la perspective de la construction d’une Europe de la défense et de l’armement. Les tentatives avortées d’une unification européenne en matière d’armement ont été tributaires du poids des préférences nationales dans le domaine de la fabrication d’armement.
Ce processus, jamais abouti jusqu’alors, tente toutefois de se concrétiser tout en préservant les spécificités du marché de l’industrie militaire. En cela, l’harmonisation en matière d’Europe de la défense passe par quelques dérogations aux règles du marché commun et une unification des règles nationales de la commande publique.
L’avenir de l’industrie de la défense doit tenir compte tant du contexte européen que de la réduction des dépenses publiques nationales. Si la réduction des budgets de la défense est susceptible d’influer sur les engagements en matière de dépenses militaires, elle ne saurait en affecter leur qualité. Ces circonstances sont l’occasion pour l’industrie militaire française de s’adapter à la réalité financière, en s’inspirant notamment du modèle américain tant en matière de concurrence, d’investissements, que d’exportations.
Guillaume Lagane, Haut fonctionnaire, spécialiste des questions de défense
–

Introduction
La Direction générale de l’armement (DGA) a reçu, en 2010, le premier hélicoptère NH90 en version navale NFH (Nato Frigate Helicopter) commandé par la France. Six pays participent à la construction de l’appareil : Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Portugal. Cette bonne nouvelle pour la Marine française et l’industrie européenne de défense laisse toutefois songeur : la conception du programme NH90 a près de trente ans et, dans le calendrier initial, la livraison du dernier hélicoptère devait intervenir en 2007 (elle sera, normalement achevée en…2021 !).
Cet exemple souligne combien la question du maintien des capacités industrielles françaises en matière de défense se pose avec plus d’acuité que jamais. Certes, la dérive des coûts et des délais des programmes d’armement est presque une constante de l’industrie. Aux États-Unis, le cas du Joint Strike Fighter (JSF) de Lockheed Martin, le futur F-35, est symptomatique de cette tendance : entre le coût initialement estimé par le Congrès en 2001 (226 milliards de dollars) et les estimations les plus récentes (382 milliards de dollars), la construction des 2.457 avions de l’armée américaine et de diverses nations alliées coûtera 76% de plus… Mais, dans le contexte budgétaire actuel, la poursuite de programmes d’armement à la fois dispendieux et souffrant de retards est une gageure. Notre pays est aujourd’hui confronté, du fait de la crise bien sûr mais plus encore de difficultés structurelles anciennes, à d’immenses difficultés : nos 7,9% de déficit par rapport au PIB en 2009 (8,2% en 2010) représentent près de la moitié des dépenses de l’État. Dès lors, il serait douteux que les dépenses militaires (32 milliards d’euros en 2009), et en particulier les achats d’armement (un tiers du total, 10 milliards d’euros par an), ne constituent pas une variable d’ajustement.
L’industrie française de la défense s’alarme évidemment beaucoup des économies à venir. Elle rappelle la nécessité de maintenir une base industrielle et technologique de défense (BITD) française et européenne autonome. Elle souligne sa contribution à la croissance (un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros) et à la balance du commerce extérieur (un solde positif de 3,7 milliards d’euros en moyenne). Elle insiste enfin sur son poids « social » : le secteur de la défense représenterait en France 165.000 emplois directs et autant d’emplois indirects.
Sans nier la réalité de telles craintes, cette note s’efforcera de montrer que les restrictions budgétaires peuvent aussi permettre la mise en œuvre de réformes salutaires pour l’industrie de défense. Dans la situation actuelle, les résultats de l’industrie ne sont pas toujours satisfaisants. Les industriels français répondent parfois mal aux besoins de notre armée. Malgré un libéralisme affiché, ils demeurent excessivement dépendants des commandes publiques (70% du chiffre d’affaires) et entretiennent des redondances coûteuses en refusant de procéder aux corrections de périmètre nécessaires (voir le refus du rapprochement entre les activités de Thalès et de Safran). Enfin, serpent de mer des discours officiels, la coopération européenne reste largement inefficace et ne peut masquer la prévalence des logiques nationales. Dans ce contexte, la pénurie budgétaire pourrait être une véritable opportunité de réforme pour l’industrie de défense française.
L’industrie de la défense française face à ses limites
L’existence d’une industrie nationale de défense puissante et indépendante est un aspect majeur de la « posture stratégique » française. La France possède en effet, avec le Royaume-Uni, une capacité de tout premier plan en matière d’offre d’équipement militaire : les deux pays représentent 50% des dépenses militaires européennes et 70% de l’effort en matière de recherche et développement.
L’industrie française d’armement proprement dite, avec 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires, est composée d’une dizaine de grands groupes français (Dassault, Safran, DCNS, Nexter) ou franco-européens (Thales, EADS avec ses filiales MBDA et Eurocopter) et de plusieurs milliers de PME-PMI, généralement des sous-traitants. Elle se place au deuxième rang européen, derrière la Grande-Bretagne (40 milliards d’euros de chiffre d’affaires et plus de 300.000 emplois) et devant l’Allemagne (8 milliards d’euros, 80.000 emplois), l’Italie (5 milliards d’euros, 500.00 personnes), l’Espagne et la Suède (3 milliards d’euros chacun, 150.00 emplois).
Par le caractère complet de son offre, la France est un des piliers les plus solides de la BITD européenne (55 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 600.000 personnes). L’industrie française est en effet capable de proposer des produits sur l’ensemble des segments de l’offre militaire (matériels navals, terrestres et aériens), contrairement à ces voisins dont l’offre est parfois plus faible. Ainsi, le Royaume-Uni est peu présent dans le secteur spatial, à l’exception des télécommunications militaires. Quant à l’Allemagne, outre l’aérospatial, les points forts de son industrie sont historiquement les blindés lourds et les sous-marins.
Une fois ce postulat établi, il faut le nuancer fortement. Si l’industrie française est incontestablement un poids lourd européen, son rôle devient relatif sur la scène mondiale. Le marché mondial de l’armement est en effet largement dominé par les États-Unis : l’industrie américaine, portée par les premières dépenses militaires de la planète (549 milliards de dollars en 2011, plus 139 milliards de dollars pour les opérations en Irak et en Afghanistan, soit autant que l’ensemble des budgets militaires des autres États) et une place dominante sur le marché export (50% des ventes), a un chiffre d’affaires de 160 milliards d’euros, dix fois supérieur à l’industrie française, trois fois le total européen. Elle emploie plus de 2 millions de personnes.
Deuxième nuance, si l’industrie française apparaît divisée entre groupes de tailles et de statuts très divers, elle est unie par une forte dépendance aux commandes publiques. Certes, Dassault Aviation, Safran ou Thales détiennent des parts de marchés civils importantes, mais l’activité d’industriels comme DCNS (anciennement DCN) ou Nexter (anciennement Giat Industries) repose essentiellement sur l’activité de défense. L’État joue un rôle fondamental : après avoir nationalisé une grande partie de cette industrie (Thomson, devenu Thales, 1981-1998), il continue de posséder des parts importantes (27% de Thales) ou majoritaires (Nexter, DCN) dans de nombreux groupes. Surtout, ses achats (10 milliards d’euros par an) constituent les deux tiers du chiffre d’affaires des industriels français.
Enfin, l’industrie française est peu présente dans certains segments, très dynamiques, du marché de l’armement. C’est, par exemple, le cas des drones, ces avions sans pilote aujourd’hui très utilisés sur les théâtres d’opérations (Afghanistan) et qui pourraient, demain, remplacer les actuels chasseurs. Sur ce marché en pleine expansion (l’armée américaine comptait 54 drones en 2001, 4.000 aujourd’hui), les États-Unis occupent une position dominante (70% de parts de marché avec General Atomics, le fabricant du Predator et du Reaper, ou Northrop Grumman, qui fabrique le Global Hawk), suivi par Israël. Avec une offre limitée, les Européens, et donc les Français, ne jouent qu’un rôle mineur (5% de parts de marché). On estime pourtant que les achats de drones vont passer de 4,9 milliards de dollars par an actuellement, à 11,5 milliards en 2020, soit un marché de 80 milliards sur la décennie 2010.
Au-delà des enjeux économiques, le soutien de l’État au développement d’une puissante industrie de défense française est fondé sur la capacité de ces industriels à fournir aux armées françaises, sans dépendre d’un État étranger, des matériels nombreux et performants. Ce rôle de fournisseur des armées, qui explique la part majoritaire des commandes publiques dans le coeur d’activité de l’industrie de l’armement française, était le corollaire de l’affirmation par le Général de Gaulle de la notion d’indépendance nationale. L’industrie française est ainsi devenue un symbole de la souveraineté technologique nationale.
En pratique, cette indigénisation de l’offre d’équipement a doté l’armée française de matériels très majoritairement nationaux. Sans évoquer la composante nucléaire (née de la « filière française »), les armées françaises sont aujourd’hui équipées d’avions de chasse (Mirage, Rafale de Dassault), de navires (DCNS) ou de véhicules blindés (Nexter, Panhard) de fabrication exclusivement française. Au-delà des systèmes d’armes complètes produites par des industriels systémiers et leurs sous-traitants (Dassault par exemple avec le Rafale), les équipements sont également, le plus souvent, issus de la production nationale (Safran, Thales).
On ne peut nier qu’en termes d’autonomie stratégique, cette situation présente certains avantages. La France peut ainsi mener, en toute indépendance, sa politique étrangère et, dans l’absolu, mener des conflits, sans craindre par exemple l’arrêt de la fourniture de pièces de rechange par un fournisseur qui serait hostile à cette politique. C’est d’ailleurs ce qu’elle avait elle-même fait pour Israël, en 1967, pour marquer sa désapprobation contre le déclenchement de la guerre des Six Jours par l’État hébreu. En pratique, les États dépourvus d’industrie de défense ou qui ne couvrent pas leurs besoins nationaux par leur propre production prennent toujours soin de diversifier leurs fournisseurs pour précisément éviter une trop forte dépendance. C’est le cas de Taïwan où la France, fournisseur secondaire, est venue battre en brèche le quasi-monopole américain.
Mais ce choix d’une préférence nationale se heurte aux réalités du marché. L’industrie française n’a pas toujours pu, ou su, fournir aux armées le matériel dont elles avaient besoin. Ces « trous dans la raquette » (les achats à l’étranger ne représentent que 3% du total des commandes militaires françaises) peuvent s’expliquer par l’absence de compétences technologiques au niveau national. Pour certains produits où n’existait aucune offre domestique, la France a dû se fournir sur le marché international (acquisition des ravitailleurs américains KC 135 en 1965, des avions Awacs en 1987 ou Hawkeyes en 1994). Les importations peuvent, plus prosaïquement, concerner des matériels simples mais que l’industrie française n’a pas pensé à produire. C’est notamment le cas des « achats en urgence opérationnelle » auxquels l’État français doit procéder pour la protection de ses soldats sur les théâtres de conflit (260 millions d’euros en 2009, contre 100 en 2008).
Plus fondamentalement, la préférence nationale peut en effet se traduire par l’insuffisante prise en compte du client final. L’armée française se trouve devoir accepter et utiliser des matériels moins nombreux, plus chers que prévus ou simplement étrangers à ses besoins. Des matériels moins nombreux : pour être financé par un État de plus en plus impécunieux, le nombre de frégates multimissions (FREMM) prévu pour la Marine dans le cadre de la loi de programmation militaire 2003-2008 est par exemple passé de 17 à 11, le nombre d’hélicoptères Tigre de 210 (cible initiale) à 80, celui des hélicoptères NH 90 Marine de 60 à 27, sans tenir compte des nécessités opérationnelles. Des matériels inutiles et chers : les qualités du char Leclerc, capable de tirer à cadence élevée tout en roulant à grande vitesse, en font un pur produit de l’affrontement Est-Ouest où il s’agissait d’affronter, dans un grand style, les divisions soviétiques. Il a été livré aux armées en…1992, deux ans après la fin de la guerre froide.
À l’origine du problème, il existe une ambiguïté sur la nature même du client final de l’industrie de défense. En dernier ressort, le citoyen contribuable français est bien sûr en droit d’exiger que les sommes considérables qu’il consacre bon an mal an à la défense (30 milliards d’euros annuels, dont un tiers dans les achats d’équipement) lui assurent la sécurité. Cela suppose donc de mettre, au service des armées, le matériel le plus performant au meilleur prix. Mais entre l’offre industrielle de matériels et la demande des armées, d’autres acteurs entrent en ligne de compte, notamment l’acheteur public, la Direction générale de l’armement (DGA), les intérêts industriels (ce que le président américain Eisenhower appelait le « complexe militaro-industriel ») et, naturellement, le pouvoir politique.
La nécessité de préserver l’indépendance nationale, la souveraineté technologique française ou, très naturellement, les profits et les emplois des industriels comptent donc parfois autant que la satisfaction du client militaire. Ainsi, on peut expliquer le choix du Leclerc ou du VBCI, un véhicule blindé dont il existait de nombreuses autres versions étrangères sur le marché, par la nécessité de préserver l’emploi chez l’industriel français.
1. Article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, TFUE ou traité de Lisbonne, de 2007.
La construction d’une Europe de l’armement forte est un axe majeur de la stratégie politique et industrielle française. Il s’agit du volet industriel de la volonté affichée d’édifier, à côté de et même face à la puissance américaine, une Europe de la défense et de l’armement. Depuis les années 1970, la France s’est systématiquement associée aux initiatives cherchant à construire une BITD européenne solide et cohérente.
Il est vrai que la situation est paradoxale. L’Europe unie est une puissance industrielle de premier plan (la deuxième industrie de défense mondiale). Avec 250 milliards d’euros, ses dépenses militaires la placent au second rang mondial en valeur absolue (même s’il faut rappeler qu’avec 1,3% du PIB, elle se positionne loin des États-Unis, 4%, et même de la moyenne mondiale, 2,1%). Au total, ses investissements (c’est-à-dire les achats et la R&D) pèsent un poids non négligeable (25 milliards d’euros), même s’ils sont encore loin des montants américains (130 milliards d’euros).
Malgré ces atouts, l’Europe joue un rôle mineur du fait de la division de ses membres. Chaque État cherche à conserver chez lui les capacités industrielles de défense, ce qui favorise le protectionnisme (donc renchérit les achats) et la duplication des moyens tout en empêchant l’émergence de champions industriels européens. Le traité de Rome, dès 1957, a pris acte de cette spécificité du marché de l’armement : l’article 296 TCE1 permet aux États de déroger aux règles du marché commun pour les achats d’armements.
Face à cette situation, diverses initiatives ont cherché à favoriser la coopération industrielle entre Européens. C’est, dès 1976, le Groupe armement de l’Europe occidentale (GAEO) qui, dans le cadre de la défunte Union de l’Europe occidentale (UEO), regroupait une vingtaine d’États européens. C’est, en 1996, l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR), qui, dans un format plus restreint (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) gère des programmes en coopération (l’A400M par exemple). C’est enfin, en 1998, l’accord-cadre LoI (Letter of Intent) entre les six pays majeurs de l’Union européenne en matière d’industrie de défense (les mêmes que précédemment, la Suède ayant remplacé la Belgique).
La création de l’Agence européenne de défense (AED), en 2004, visait à unifier tous ces dispositifs (elle a absorbé le GAEO en 2005). De son côté, la Commission européenne a tenté de limiter l’application de l’article 296 (article 346 TFUE) après 2007. En 2009, elle a fait adopter un « paquet défense » comprenant une directive simplifiant les conditions des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense (on exportait jusqu’ici vers la Belgique suivant la même procédure que vers le Pakistan) et une seconde directive ayant pour objectif d’harmoniser les règles émanant des codes de marchés publics des États membres afin de permettre une meilleure transparence et plus de concurrence dans le processus d’achat des équipements de défense.
Force est de constater que, globalement, ces initiatives ont échoué à construire une Europe de l’armement. Dépourvue de force de frappe financière, l’AED a tenté, sans véritable succès, de créer, sur une base volontaire et intergouvernementale, un marché européen de la défense transparent et concurrentiel, notamment en lançant en 2006 un “code de conduite” sur les achats. Quant aux États membres, ils n’ont eu de cesse que de chercher à limiter la portée des initiatives de la Commission. La directive 2004/18/CE sur les marchés publics de travaux, fournitures et services a ainsi été contournée, les États, dont la France, ayant largement fait appel à une exemption pour les « marchés secrets » ou jugés tels par les États membres.
Il est vrai qu’un État qui a consacré, du fait de la dépendance aux commandes publiques nationales de chaque industriel de l’armement, de vastes sommes au développement de programmes de défense, va nécessairement hésiter à laisser un concurrent étranger remporter les appels d’offres. Ce principe, dit du « juste retour », qui consiste à obtenir une charge industrielle équivalente à l’investissement que l’on a consenti, mine l’efficacité de tous les programmes en coopération en niant leur logique même.
Ces programmes se révèlent de ce fait plus coûteux que d’autres quand, par intérêt bien compris, chaque État cherche à se faire attribuer, dans le montage industriel, non pas la technique qu’il maîtrise, mais celle qu’il ne possède pas ou plus, et dont il veut retrouver la possession. C’est la négation même des éventuelles économies d’échelle ou de la théorie des « avantages comparatifs » (chacun met en commun ce qu’il a de meilleur) censées justifier les programmes en coopération.
Voilà pourquoi, au-delà des discours, la réalité de l’Europe de l’armement est celle de programmes en coopération dispendieux et créateurs d’incohérences industrielles. Le marché européen voit ainsi coexister une offre pléthorique de seize véhicules blindés de combat différents. Et il est le seul continent à se payer le luxe d’avoir développé trois programmes d’avions de chasse concurrents : l’Eurofighter anglo-germano-italien, le Gripen suédois et le Rafale français !
Quel avenir pour l’industrie de défense ?
Même si elle le redoute, l’industrie de la défense va devoir procéder à d’importantes coupes budgétaires. En 2010, à la suite de la quasi-faillite grecque, la France a affiché son intention de passer d’une augmentation de la dépense publique en « zéro volume » pour 2011 et 2012 (pas plus que l’inflation) à un principe de « zéro valeur » (maintenir la dépense de 2010 en 2011, quelle que soit l’inflation), soit, en pratique, une réduction des dépenses de fonctionnement (- 10% en trois ans) et, sans doute aussi, d’investissement.
Il est à craindre que cette rigueur, souhaitable du point de vue de l’équilibre des finances publiques, ne compromette les engagements pris en matière de dépenses militaires. En particulier, la loi de programmation militaire (LPM) 2009-2014, qui prévoit 186 milliards d’euros sur la période, avec une progression des crédits au rythme de l’inflation et même, à compter de 2012, une croissance de 1% par an, sera difficile à exécuter dans ces conditions. En soi, rien d’exceptionnel : le non-respect des lois de programmation militaire est une constante de l’histoire financière récente de la France. Reste que le gouvernement français avait pris, à partir de 2007, des engagements louables visant à rendre crédible la LPM, notamment en fournissant un effort accru en faveur des investissements et de l’équipement (passer de 15 à 18 milliards d’euros par an d’ici 2014, sur un budget, hors pensions, d’environ 30 milliards par an). De fait, dans les budgets 2008, 2009 et 2010, sans même parler des effets du plan de relance (qui à permis l’augmentation des commandes de la DGA), la défense n’a pas été véritablement malmenée.
Aujourd’hui cependant, la dégradation de la situation dans l’Union européenne est préoccupante. La dette française, qui représente près de 1.500 milliards d’euros, soit environ 80% du PIB, est détenue en majorité par des non-résidents : à hauteur de 60%, contre 30% en 1999. Afin de contenir cette dégradation et de rassurer les marchés financiers, des économies sont d’ores et déjà envisagées. Si l’on en croit la loi de finances présentée pour 2011, elles resteront mesurées : les 3,6 milliards d’euros en moins sur le budget de la défense seront en partie compensés par 2,3 milliards de recettes exceptionnelles, soit une réduction de seulement 1,3 milliards d’euros en net cumulé sur la période 2011-2013.
Reste que ces économies peuvent être l’occasion de réexaminer notre posture stratégique, en tenant compte des priorités du Livre blanc sur la Défense d’août 2008 mais, plus encore, des réalités financières. Aux États-Unis, confrontés aux mêmes problèmes budgétaires, le secrétaire d’État à la Défense envisage des économies substantielles (100 milliards de dollars sur cinq ans), avec notamment l’abandon de nombreux programmes. On doit sans doute s’attendre à des réductions équivalentes aux baisses observées après la fin de la guerre froide (les « dividendes de la paix »).
À terme, ces économies devraient immanquablement déboucher sur la réduction des commandes françaises à l’industrie de défense. Paradoxalement, cette réduction pourrait avoir un effet positif, celui de « désintoxiquer » un secteur très dépendant de ces commandes. Mais elle ne peut être une fin en soi. Il ne s’agit pas de réduire pour réduire mais de choisir avec clarté d’affecter des budgets désormais contraints au financement d’une politique favorable à l’industrie en général. Rappelons que l’industrie en France représente 16% du PIB (contre 30% en Allemagne) et que les effectifs industriels dans notre pays se sont réduits de 40% depuis 1981. Les causes sont à rechercher dans l’effritement continu de notre compétitivité industrielle du fait du renchérissement du coût du travail (charges sociales, 35 heures), de prélèvements sur la valeur ajoutée des entreprises deux fois supérieurs à ceux de l’Allemagne, et d’une délocalisation générale des entreprises industrielles (là où, outre-Rhin, on choisit de laisser partir les fragments à faible valeur ajoutée).
Si les marges de manœuvre budgétaires nouvelles doivent financer une ambitieuse politique de réduction des entraves réglementaires et fiscales qui pèsent sur les entreprises, pas seulement de défense d’ailleurs, elles doivent aussi encourager les investissements dans ce secteur précis. Rappelons que la France, comme l’Europe, a un différentiel à rattraper : ses investissements dans le domaine de la défense (achats et R&D) représentent le cinquième de l’effort américain (25 milliards d’euros contre 130 milliards d’euros). Or, de l’invention du Nylon à l’énergie nucléaire ou à l’Internet, la relation entre recherche militaire et application civile est abondamment illustrée. Il est donc indispensable de favoriser la recherche dans les technologies militaires si l’on veut qu’en 2050, la France et l’Europe jouent encore un rôle, non seulement sur le marché de l’armement, mais sur le marché tout court.
2. Avec plusieurs années de retard. Un seul est actuellement opérationnel.
La réduction ou l’abandon de certains programmes industriels laissera inévitablement l’État face à un choix cornélien : renoncer à ces capacités, au prix d’une aboulie de nos forces armées, ou se fournir ailleurs, sur étagère (off the shelves), au prix, il est vrai, d’une perte relative de souveraineté. C’est un choix stratégique qu’il faut assumer mais qui correspond, en fait, au déroulement réel des opérations militaires de la France. Notre pays, et l’exemple de l’Afghanistan vient l’illustrer, intervient désormais le plus souvent en coalition. Pour peser, sauf situation bien particulière (notre politique africaine, avec des opérations telles que l’opération « Licorne » en Côte d’Ivoire), il ne peut plus guère se passer de l’aide de ses alliés. L’hypothèse d’une action solitaire de la France, que ses alliés occidentaux ou européens condamneraient, voire tenteraient d’empêcher, semble aujourd’hui bien improbable.
L’achat sur étagère est jusqu’ici, nous l’avons vu, demeuré marginal dans les commandes nationales (3% du total). Pour certains produits bien particuliers, la France a rompu avec sa démarche autarcique et a dû accepter de se fournir sur le marché international (acquisition des avions américains Awacs en 1987 ou Hawkeyes en 1994). L’idée serait ici d’adopter une posture dynamique nous permettant de tirer le meilleur parti de l’offre étrangère, en fonction des créneaux et des entorses que nous accepterions de faire à notre « indépendance nationale ».
Dans certains cas, par exemple l’achat d’un produit en quasi monopole (cas des acquisitions précitées) qui place l’acquéreur en position de faiblesse, l’achat sur étagère n’est guère favorable.
Mais dans d’autres cas, il permet, en créant une véritable concurrence dans les appels d’offres, de pousser les acteurs nationaux à donner le meilleur d’eux-mêmes en termes de prix, de qualité ou de respect des délais et de ne pas financer les frais de développement déjà amortis par les commandes américaines. Il permet également, dans un contexte budgétaire contraint, de satisfaire les besoins des armées au meilleur prix.
L’exemple des drones, ces avions sans pilote désormais indispensables, est très parlant. L’armée française, qui dispose de quatre drones Harfang livrés par EADS (et l’entreprise israélienne IAI) en 20082, souhaite posséder davantage de drones tactiques Male (« moyenne altitude, longue endurance ») de nouvelle génération, notamment pour le terrain afghan. Les deux propositions françaises, portées d’un côté par EADS (depuis 2007, le Talarion, successeur du Harfang, fruit d’une coopération France, Allemagne, Espagne, d’un coût de 1,4 milliard d’euros, disponible en dix ans), de l’autre par Dassault-Thales (le Mantis, en coopération avec BAE pour 700 millions d’euros, selon le groupe, et disponible en sept ans), ont l’inconvénient d’un coût élevé et de n’exister que sur le papier…! Dans ce contexte, l’État envisage donc d’acquérir les drones Predator B de l’américain General Atomics, moins chers, opérationnels sur le terrain afghan et déjà disponibles.
Le cas des drones illustre bien les effets pervers de la dépendance des groupes français à la commande publique. Focalisés sur les besoins de l’armée française, qui n’en faisait pas une priorité et se montrait hostile, par principe, à l’armement de ces appareils, les groupes industriels franco-européens n’ont pas développé d’offre crédible en matière de drones : la France ne dispose en effet que d’un parc réduit (60 mini-drones Drac d’EADS, 18 drones de renseignement tactique Sperwer de Sagem, et enfin les Harfang) quand Israël (dont les drones ont représenté 70% des aéronefs mobilisés au cours de l’opération « Plomb durci » en 2009) ou les États-Unis développent leur parc. Ils ont ainsi laissé passer le train de ce marché désormais stratégique.
Le secteur des missiles est un autre domaine où la logique de l’achat sur étagère est en passe de s’imposer. Après avoir longtemps utilisé et loué le missile antichar Milan, l’armée française l’a jugé peu adapté aux conflits actuels : filoguidé, il met le tireur en danger et son effet de souffle empêche qu’il puisse être tiré depuis un espace confiné. Elle réfléchit donc aujourd’hui à l’acquisition d’un système « tire et oublie » (shoot and forget), actuellement utilisé par les Américains et les Israéliens. En l’absence d’un tel système en France ou en Europe (MBDA), ce sont donc les matériels américains (Javelin) ou israéliens (Spike) qui tiennent la corde. Ces exemples ne devraient pas nécessairement demeurer isolés à moyen terme. Dans l’avenir, compte tenu des contraintes budgétaires, il est probable que la logique de la « souveraineté nationale » s’efface au profit des achats sur étagère. Véhicules blindés, avions de transport, hélicoptères, armes de poings (le Famas n’a pas de successeur) : tous les matériels militaires pourraient être concernés. Et pas nécessairement au détriment de l’industrie française…
L’industrie française de l’armement a en effet toute sa place dans le marché mondial de l’armement. Cette place est toutefois amenée à évoluer : le secteur doit se tourner résolument vers le grand export. Au cours des dix dernières années, les exportations ont représenté en moyenne environ 32% de l’activité des entreprises basées en France. De leur côté, les entreprises étrangères en Allemagne ou en Italie, confrontées à des commandes nationales moins importantes que les nôtres, se révèlent plus agressives à l’export. La part export du chiffre d’affaires du britan- nique BAE est ainsi de 82%, celles des groupes allemands Krauss-Maffei Wegmann et Rheinmettal Defence respectivement de 70 et 66%.
Pour mieux pénétrer le marché mondial, les groupes français doivent adopter une stratégie de niche, c’est-à-dire renverser la logique qui pré- valait jusqu’alors. Au lieu de chercher à occuper l’ensemble des créneaux du marché de l’armement, pour répondre aux besoins du client français, l’industrie nationale doit développer des pôles d’excellence. Cela suppose, on l’a vu, un effort continu en matière de recherche et d’investissement, la réponse à la montée en puissance du low cost dans le marché de l’armement ne pouvant être qu’une offre renouvelée de high tech. Cela signifie également une souplesse commerciale et une certaine forme d’inventivité, par exemple dans le secteur des services. C’est le cas notamment de la location et du leasing de matériels ou des sociétés militaires privées, dont le chiffre d’affaires mondial est de 200 milliards de dollars, sans vraie présence française).
Surtout, il est indispensable que l’industrie française se restructure et s’ouvre plus largement à la coopération internationale. L’exemple du marché du nucléaire civil est là pour le prouver : au lendemain de l’échec français aux Émirats arabes unis, la filière française a compris la nécessité de s’ouvrir. Ainsi, EDF et le russe Rosatom, qui ont signé un accord de coopération pourraient vendre à des pays tiers des réacteurs russes VVER, dont EDF a modernisé des unités en Europe centrale dans les années 1990. EDF pourrait, d’autre part, s’associer, au cas par cas, avec l’américain General Electric ou le groupe américano-japonais Toshiba-Westinghouse.
Ce modèle est transposable au secteur de l’armement. En Inde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Chine, les Français n’ont pas d’autre choix que de s’associer avec des partenaires locaux, de transférer de la technologie et de faire travailler l’industrie locale. Cette logique répond du reste aux demandes des clients qui souhaitent, à travers les exigences de compensations (offsets), obtenir de plus en plus de transferts de charge et de technologies. À terme, de tels transferts favorisent évidemment la création et la montée en puissance de concurrents nouveaux. Mais si l’on entend exporter, il n’existe pas vraiment d’alternative à la satisfaction de ces demandes : chacun des compétiteurs qui s’affrontent aujourd’hui pour répondre aux besoins du Brésil de renouveler sa flotte d’avions de chasse propose au client des transferts majeurs.
Dans ce contexte, les groupes français doivent davantage s’ouvrir sur le monde. C’est le modèle choisi par BAE Systems. Né en 1999 du rapprochement de British Aerospace (BAe) et de Marconi, le groupe de Farnborough s’est, à partir de 2002, recentré sur la défense (95% de son chiffre d’affaires contre 48% pour Boeing) et surtout résolument internationalisé (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Australie avec le rachat des activités militaires de Tenix en 2008, Inde et Suède), notamment vers le marché américain. Ce choix d’une internationalisation de sa production a accentué la désindustrialisation du Royaume-Uni mais il a permis à l’entreprise britannique de conserver un rôle central sur un marché de l’armement : en 2008, selon le classement établi par l’institut suédois Sipri, BAE Systems est devenu le premier fournisseur d’armes mondial avec 32,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires et devance désormais les américains Boeing (29,2 milliards de dollars) et Lockheed Martin (29,4 milliards de dollars).
La clé d’une meilleure insertion sur le marché mondial passe aussi par les États-Unis. Le marché américain est le premier du monde, tant en volume que dans la définition même des besoins de la clientèle, qui a tendance à s’aligner sur les normes de l’US Army. La réussite de BAE ne s’explique pas autrement : les États-Unis constituent 59% de son chiffre d’affaires (et la moitié de ses 106.000 employés). Pour autant, la pénétration de ce marché très protégé sera difficile : pour avoir une chance d’emporter des contrats gouvernementaux, il faut se comporter en « bon citoyen américain » capable de « produire localement et de créer de l’emploi ». La concurrence y est d’autant plus rude que les groupes américains, dont la part export est aujourd’hui réduite (Boeing : 16%, Lockheed Martin : 14%), veulent relancer leurs ventes à l’étranger pour compenser la baisse prévisible des commandes domestiques et ne sont guère disposés à partager ces dernières.
Mais cette situation est précisément une source d’opportunités pour les groupes français. Après la guerre du Golfe, la baisse du budget américain de la défense avait plongé de nombreuses entreprises dans la difficulté et entraîné un regroupement sans précédent (création de Lockheed Martin en 1995, rapprochement Boeing et McDonnel Douglas, Hugues et Raytheon en 1997). La période actuelle est donc favorable au rachat d’entreprises américaines. Ainsi, l’industrie italienne, regroupée autour de son champion national qu’est Finmeccanica (privatisé en 2000, l’État italien conservant un tiers du capital), a mis en place une stratégie de pénétration du marché américain, notamment grâce au rachat d’entreprises telles que DRS (2008, pour 3,4 milliards d’euros).
À côté des rachats, l’industrie franco-européenne doit d’autant plus proposer ses produits sur le marché américain qu’un contexte budgétaire moins favorable rend le Pentagone plus ouvert aux prix réduits provoqués par une concurrence accrue. EADS a déjà remporté, en 2006, un contrat de 2 milliards de dollars pour fournir à l’armée américaine, à la Garde nationale et à la Marine 345 hélicoptères utilitaires légers, aujourd’hui assemblés dans l’usine de Columbus (Mississippi). Allié à Lockheed Martin, le groupe européen concourt aujourd’hui, face à Boeing, pour l’énième avatar du contrat de 179 avions ravitailleurs (35 milliards de dollars).
Conclusion
Même si son poids est à relativiser, la France reste bien cette « mère des arts, des armes et des lois » que chantait jadis le poète Joachim du Bellay. Exportateur net (8 milliards d’euros en 2009, alors que notre commerce extérieur accuse un déficit, persistant depuis 2002, de 43 milliards cette année-là), l’industrie de défense continue de peser d’un poids singulier dans notre économie. Reste qu’à l’heure des restrictions budgétaires, cette industrie, très dépendante de la commande publique et dont les coûts comme les délais ne sont pas toujours performants, est sans doute amenée à se remettre en question.
La solution ne doit pas nécessairement reposer sur les recettes traditionnelles, d’une révision à la baisse des programmes, qui ne seraient pas conforme aux besoins de l’armée française, à la relance d’une hypothétique et souvent coûteuse coopération européenne.
Elle doit plutôt passer par une réaffectation des budgets publics en faveur des efforts de recherche et de développement (aujourd’hui seulement de 2,7 milliards d’euros, contre un budget américain, 54 milliards d’euros, sept fois supérieur à celui de l’Union Européenne) et, plus généralement, de la baisse des charges pour l’industrie.
Elle pourrait également inclure une ouverture, partielle et raisonnée, des achats publics à la concurrence étrangère. Enfin, à l’image du repas surnommé « The Last Supper » (« la Cène ») et organisé en 1993 par William Perry, le secrétaire américain à la Défense, au cours duquel les industriels américains étaient invités à se regrouper, il faut sans doute envisager des restructurations doublées d’une ouverture accrue vers le grand export, des marchés émergents aux États-Unis.