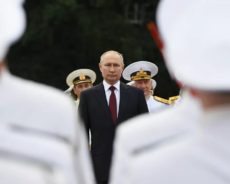par Farouk Lamine*
Le débat sur la place de la langue arabe et de la langue française en Algérie a toujours été un débat investi d’une charge émotionnelle et identitaire électrique.
C’est ce qui empêche de poser les bonnes questions et rend le débat souvent stérile. Ce débat est revenu avec l’annonce du nouveau ministre de l’Education de son intention de consolider l’usage de la langue anglaise à l’université, à la place de la langue française. La vieille polémique entre arabisants et francisants refait surface et l’on note déjà des termes incendiaires. Les uns réduisent les défenseurs de la langue arabe à des « islamistes », et les autres réduisent les francophones à « hizb frança ». Et on se demande déjà si ce n’est pas une autre façon de créer de la division à un moment crucial de l’histoire de notre pays.
Donner l’avantage à l’anglais est une bonne chose. C’est un tort que de réduire ce souhait à une manœuvre « islamiste » comme le font certains. Nombreux chercheurs algériens ont exprimé leur désir de se tourner vers la communauté scientifique anglophone, largement plus foisonnante et universelle. Il est de nos jours impossible pour qui que ce soit de dire qu’il est spécialiste éminent ou grand chercheur, dans quelque domaine qu’il soit, sans être au courant de ce qui se publie dans le monde en anglais.
Cependant, le problème avec la mesure prise par le ministère n’est pas en elle-même, elle est dans ses motivations. On n’introduit pas une langue étrangère juste pour évincer une autre jugée détestable pour des raisons historiques. C’est la raison qui doit prévaloir dans ces débats et non pas les passions, et le raisonnable veut que nous choisissions ce qui nous arrange, et ce qui nous arrange doit aussi rester dans la mesure du possible.
Le français, contrairement à ce qui est parfois affirmé, nous a toujours été utile. Tout d’abord, il existe une forte tradition démocratique francophone en Algérie qui commence avec le FLN historique. Les leaders du mouvement national ont puisé leurs idées dans des traditions politiques occidentales, communisme et socialisme notamment. Et c’est le fait d’avoir puisé dans cet Occident hégémonique qui leur a permis de lui résister. Et puis, l’élite algérienne (médecins, architectes, ingénieurs, journalistes, etc.) reste majoritairement francophone. Il est donc ridicule de vouloir combattre soi-même. En plus, la France a été, jusqu’à l’année dernière, la première destination des étudiants algériens et cela pour une raison simple : les études en France ont été jusque-là relativement abordables. Le montant nécessaire pour une année entière en France pour un étudiant algérien, incluant le gîte et le couvert, ne couvrira pas les frais d’un seul semestre dans une université anglo-saxonne. Dans ce cas, on peut s’interroger si la mesure du ministère va s’accompagner d’une mise en place de bourses pour nos étudiants afin qu’ils partent étudier dans des universités anglo-saxonnes ? Voici une bonne question.
C’est là une mesure qui n’a pas été prise avec les frais relativement inférieurs des universités françaises, va-t-on le faire maintenant alors que ces frais sont désormais multipliés par dix ou vingt ?
En ce qui concerne la langue arabe et la politique d’arabisation, il est important de rappeler que, dans la conception des chefs politiques qui avaient lancé le processus d’arabisation, la langue française devait avoir « une place largement confortable même dans un système d’éducation et de formation complètement arabisé »1, selon les mots de Abdelhamid Mehri. Il précisait aussi que le devenir de la langue française dépendait également de la coopération française. Malheureusement, l’arabisation a été un échec et le rôle de la France dans la coopération n’a pas été exemplaire. Les raisons de l’échec de la politique d’arabisation ne sont pas à chercher très loin, elles se trouvent dans la politique elle-même. On a d’abord imposé la langue arabe au lieu de la faire aimer. Son introduction ne s’est accompagnée d’aucune préoccupation pédagogique ou valorisation profonde. C’est dans les disciplines techniques et scientifiques que l’arabe a eu naturellement du mal à s’implanter.
Derrière l’agitation sur la langue arabe, il y avait l’idée naïve selon laquelle il suffit de traduire le savoir pour le posséder. Le fait de se tourner aujourd’hui vers l’anglais est, en un sens, une façon d’avouer que c’était là un vœu pieux. C’est en possédant le savoir qu’on l’écrira à notre manière et non pas l’inverse. Et ceci peut prendre parfois des siècles. Il existe toutefois des raisons extérieures à cet échec.
Le projet d’arabisation lancé après l’indépendance n’était pas une mince affaire, et les chefs du FLN ne l’ignoraient pas. C’est pourquoi l’effort immense d’arabisation devait, selon Abdelhamid Mehri, « s’harmoniser avec les travaux parallèles des autres pays arabes où un travail considérable a été déjà réalisé»2. C’était pour eux une façon de se libérer complètement du joug colonial. Malheureusement, les régimes arabes ont misé sur tout sauf sur la démocratie. Ils ont donc tous échoués, et ce qui ressemblait à l’amorce d’une renaissance arabe au XIXe siècle s’est vu, peu à peu, remplacé par une contre-révolution islamiste orchestrée par les pays du Golfe avec l’aval de l’Occident. Mais la France n’a-t-elle pas une part de responsabilité dans ce grognement contre sa propre langue ? La coopération dont parle Mehri a été jusque-là infiniment modeste. Si les Algériens veulent de plus en plus se tourner vers l’anglais aux dépens du français, c’est aussi parce qu’on a interdit aux étudiants algériens de poursuivre leurs études en France en augmentant significativement les frais d’inscription l’année dernière, et cela dans l’espoir d’attirer des étudiants des pays riches (pays du Golfe, Chine, etc.), raflés par les universités anglo-saxonnes.
Les Algériens ont aussi ras le bol d’une scène intellectuelle française profondément hostile à tout ce qui a trait à l’arabe et à l’islam. Ils savent aussi que les intellectuels et écrivains algériens promus ces dernières années en France sont choisis minutieusement pour adosser les bêtises de leur intelligentsia.
La méconnaissance et le désintérêt envers tout ce qui est en lien avec le Maghreb sont sidérants dans ce pays. L’historien français spécialiste de l’Algérie, Benjamin Stora, l’avait souligné. Les intellectuels français, y compris quelqu’un comme Jean-Paul Sartre par exemple, encore apprécié en Algérie pour sa position anticoloniale, ont toujours fait montre d’une absence élémentaire de sympathie à l’égard de tout ce qui est en lien avec la culture et l’histoire arabo-musulmanes. Cela est peut-être dû aussi au fait que la France reste un pays relativement replié sur lui-même. Les traductions des livres importants, dans nombreux domaines, se font très en retard et parfois jamais.
Le fait de se tourner vers le monde anglo-saxon nous serait probablement plus bénéfique, leur élite est beaucoup plus universelle et beaucoup plus respectueuse des principes de liberté d’expression.
Cependant, le vrai problème de l’Algérie pour le moment n’est pas celui de la langue, mais celui du savoir et de sa distribution. Les librairies sont quasi inexistantes en dehors du centre d’Alger et même les revues ou les bandes dessinées, par exemple, ne sont pas distribuées, plusieurs bureaux de tabac s’en plaignent. Pourtant, il existe une demande. Le sabotage de la culture et de la distribution du savoir, dans quelque langue que ce soit, n’ont pas été l’œuvre de la France, ils ont été l’œuvre du gouvernement algérien à coup de censure et par une absence de politique culturelle pérenne. On se trompe d’ennemi quand on désigne la langue française du doigt.
Faut-il rappeler, comme l’a fait Mehri, que l’apprentissage de la langue arabe était rendu « obligatoire pour tous les élèves sans distinction », en Algérie en 1961, par Charles de Gaulle ? En fin de compte, le complexe du colonisé se trouve également du côté de celui qui rejette tout sur l’ancien colonisateur. C’est à l’élite arabophone qu’incombe le devoir de « développer, d’enrichir, de faire œuvre d’inventivité et d’adapter notre arabe à nos besoins actuels, en se l’appropriant »3, comme l’écrit Soufiane Djilali. C’est en particulier le rôle des écrivains de faire évoluer la langue arabe, de la réconcilier avec l’arabe populaire (daridja), de traduire les grandes œuvres vers cette langue, y compris les œuvres algériennes de langue française.
Dans son livre Les Croisades vues par les Arabes, Amin Maalouf rappelle que le refus de s’ouvrir aux idées venues d’Occident a fini par coûter cher aux musulmans. « Pour l’envahisseur », écrit-il, « apprendre la langue du peuple conquis est une habileté; pour ce dernier, apprendre la langue du conquérant est une compromission, voire une trahison. De fait, les Franj ont été nombreux à apprendre l’arabe alors que les habitants du pays, à l’exception de quelques chrétiens, sont demeurés imperméables aux langues des Occidentaux ». L’époque est différente, et pourtant les réactions humaines demeurent identiques. A nous d’apprendre des erreurs du passé et poser enfin les bonnes questions.
*Professeur de langue anglaise
Notes
1- Abdelhamid Mehri, «La langue arabe reprend sa place», Le Monde Diplomatique 1972.
2- Ibid.
3- Djilali Soufiane,Choc de la Modernité: crise des valeurs et des croyances, Editions Jil Jadid, 2017, p.109.
La quatrième langue
par Belkacem Ahcene-Djaballah – Il y a peu, lors d’une Université d’été (2008) le dirigeant d’un parti politique a déterré un sujet que l’on croyait certes non définitivement enterré, mais classé pour raison, assurément,… de Réconciliation nationale : celui de la non-utilisation généralisée de la langue arabe, constitutionnellement nationale et officielle, dans les amphis… la langue française étant le «barrage» et la cause de tous les échecs.
Cette sortie n’a pas manqué de surprendre tous les observateurs qui l’ont traitée de «diversion» politicienne, tant il est vrai que le pays a d’autres «chats à fouetter» d’autant que, selon notre connaissance du terrain (dont l’enseignement universitaire), la langue française n’est plus cette «arme fatale» d’une invasion culturelle… née bien avant l’Indépendance et qui n’en finit pas. Et, par ailleurs, la plupart des Facultés sont, depuis bien longtemps, dirigées par …des arabisants bon teint.
Mis à part l’enseignement scientifique et technique qui reste (un peu ici, beaucoup là) à la traîne, surtout dans les disciplines des sciences dites «dures», tout le reste est, pour ce qui concerne les étudiants et pour les enseignants, «mis à niveau» ou en fin de «mise à niveau», à de très rares exceptions près concernant ceux que les «chasses francophobes aux sorcières» encore existantes çà et là, ne sont pas encore arrivées à débusquer et à remplacer (il paraît qu’avec la rentrée 2008, ça recommence de plus belle , mais, of course, cela reste à vérifier !). D’ailleurs, bien des docteurs d’Etat d’universités prestigieuses, presque émérites ou en fin de carrière, sont, pour la plupart, de plus en plus «parqués» dans l’enseignement du français aux premières années de fac. Une denrée pourtant de plus en plus rare et, par la suite, l’heure de la retraite venue, il faudra, immanquablement, en importer du Liban, d’Egypte ou … de France.
Il y a de cela quelques années, intervenant lors d’une rencontre sur «la pratique de la langue arabe dans le monde des finances et des affaires», un économiste de notre vénérable Université avait alors appelé les décideurs politiques à «imposer l’application de la loi portant généralisation de la langue arabe et à sanctionner tout contrevenant».
Il est évident que l’Algérie a cumulé énormément de retard dans la récupération de sa langue nationale officielle, en l’occurrence l’arabe. Mais, cela est-il réellement dû à tous ceux… de plus en plus rares, disions-nous, qui enseignent, travaillent et dirigent en français. Loin s’en faut !
Les retards sont dus d’abord aux structures gouvernementales et de l’université qui ne sont pas arrivées, 46 ans après l’Indépendance du pays, à mettre en place et surtout à développer et à conserver des mécanismes et des moyens humains et matériels oeuvrant en arabe de manière continue (traduction immédiate et obligatoire, édition des documents dans deux ou trois ou quatre langues, formation et cours de perfectionnement, bibliothèques bien fournies… comme cela se faisait dans les années 70 et début 80).
Les retards sont dus, ensuite, à l’activisme et la surenchère de certains «doktours» qui, actionnant des associations ou des individus au nationalisme linguistique exacerbé ou de organisations estudiantines politisant tout et ce à dessein, ont freiné beaucoup plus qu’accéléré le processus mis en branle dans les années 70. Un activisme qui avait, en son temps, dans les années 60, «immobilisé» l’immense Malek Haddad et qui, par la suite, avait fait certainement «perdre quelques belles œuvres» au grand Rachid Boudjedra, le premier ne voulant plus écrire en français, le second hésitant à le faire. Dib a préféré l’exil extérieur, Kateb l’exil intérieur, Djebar l’indifférence… et les nouvelles générations, plus universelles, la «harga».
L’arabisation se faisait alors lentement, mais sûrement et solidement. Les francophones, alors ni laïcs, ni francophiles, ni assimilationnistes, ni… s’arabisaient sans trop de peine (ceci leur était plus facile étant donné leur fonds culturel et éducationnel arabisé) et sans complexe. Puis, vinrent donc la contrainte, les interdictions de s’exprimer, les obligations d’aller encore plus vite, encore plus loin, de faire mieux, et les menaces de sanctions. Il est vrai que des «places» devaient être prises rapidement avant que les francophones ne s’ «adaptent», même si cela devait se faire aux dépens de la compétence. Même les bilingues «passèrent à la casserole», soupçonnés d’être passés à l’ «ennemi» ou plus prosaïquement, considérés comme des concurrents sérieux.
Résultat des courses : un univers éducation nel et culturel de bas niveau, une langue française devenue un «pataouète» imbuvable, pire que celui des «pieds-noirs « de Bab El Oued, une langue arabe précieuse, élitiste, et une troisième langue, comprise seulement par les Algériens, langue sans règles que l’on entend à la radio, que l’on «voit» à la télé, ainsi que dans des discours politiques, qu’on «lit» dans les journaux populaires… et que l’on rencontre à travers les Sms et la publicité : un étrange mélange de Dardja, d’arabe littéraire, de traductions approximatives avec des «querelles de clochers» à n’en plus finir, de transcriptions en lettres latines d’appellations et d’adjectifs souvent ridicules surtout lorsqu’elles sont reprises dans les écrits officiels et les discours, de français violenté, de tamazight… depuis quelques années (chacun voulant, tout d’un coup, assumer, publiquement et «fièrement», ses racines berbères)…et, depuis peu, de termes anglo-américains (beaucoup de nos universitaires arabophones ayant fait des études in England or in The States). Même pas un langage pouvant être ordonné. Un sous-langage. Ceci sans parler de la prolifération des sigles. Une langue de «mutants»… à laquelle échappent, bien sûr, les nantis du portefeuille et du «bouzellouf» (comme ont échappé les héritiers des décideurs des années 60-80 qui, tout en prônant l’arabisation accélérée de l’école algérienne, avaient envoyé leur progéniture au Lycée français Descartes puis en France, ou en Suisse ou en Grande-Bretagne ou aux States). Tout le reste «merdoie» dans un vocabulaire bien pauvre, mélange de très mauvais français et de très mauvais arabe, sans aucun échafaudage grammatical. Qui se dit mais ne s’écrit pas ! Ce qui est certain, c’est qu’il ne se comprend que difficilement.
Notre homo politicus aurait dû demander, avant son intervention, aux étudiants et aux chercheurs, quelles sont les sources documentaires les plus disponibles dans les bibliothèques et sur le Net et si, en arabe, elles sont suffisamment pertinentes pour aborder le recherche moderne et contemporaine… en lettres comme en sciences, certes en sciences beaucoup plus qu’en lettres. Notre homo economicus, aurait dû (et devrait) beaucoup plus fournir les résultats de ses recherches scientifiques, de ses travaux (en n’importe quelle langue, nous sommes preneurs !) et de son enseignement scientifique.
Quant aux langues, qui vivent au rythme de la société et du génie de cette dernière, elles trouveront, dans la bousculade contemporaine, toutes seules, le chemin de leur salut, celui de la «langue du fer et de l’acier» de Houari Boumédiène ou de «la langue du monde réel» de Merzag Bagtache. A condition, bien sûr, que les règles essentielles et de base de leur utilisation, surtout dans les cadres officiels et représentatifs du pays, soient respectées.
Encore faut-il que ces règles soient sainement et simplement enseignées au niveau des écoles. Et, encore faut-il qu’il y ait, en dehors des sous-langages, un langage unifié… en Algérie et dans le monde arabe. Encore faut-il, pour ce qui nous concerne, que l’Académie algérienne de la langue arabe (déjà créée, mais dont les activités restent limitées, pour l’instant, à celles de son directeur au niveau de la Ligue arabe en tant que président du Comité supérieur du projet… encore un !… de «banque de données arabe») se réunisse et commence à travailler. Encore faut-il…
Quant à l’arabisation, il n’y a qu’à suivre l’exemple de la presse écrite nationale qui, aujourd’hui, à peine en moins d’une décennie a réussi, dans la liberté, sans menaces ni contraintes ni sanctions, à s’arabiser et à s’imposer sur le marché (près de 60% pour la presse quotidienne et bien plus pour la presse périodique)… et ses journalistes et ses collaborateurs, écrivains ou poètes, véritables intellectuels, dont les noms sont bien connus et qu’il ne faut pas citer ici au risque de leur attirer des «ennuis» pour «complicité francophile», quelles que soient les critiques émises à leur endroit, sont devenus, sans menaces ni contraintes ni sanctions, les moins mauvais des multilingues du pays…
(Article déjà publié in le magazine «Le Cap», n°10, 16-31 octobre 2008)
Sondage en ligne pour passer du français à l’anglais à l’université :
95% des étudiants favorables?
Les résultats du sondage lancé le 5 juillet dernier, à ce sujet, sur la plateforme numérique du ministère de l’Enseignement supérieur, a révélé que la majorité des étudiants serait «favorable» à cette idée.

La question de substituer le français par l’anglais dans le cursus universitaire algérien fait toujours débat. Les résultats du sondage lancé le 5 juillet dernier, à ce sujet, sur la plateforme numérique du ministère de l’Enseignement supérieur a révélé que la majorité des étudiants serait « favorable » à cette idée. Il en est ressorti que plus de 90 % des étudiants disent oui à ce changement de langue. Il faut, cependant, souligner que les normes sur lesquelles a reposé ce sondage d’opinion, sont toujours méconnues.
D’autant plus que cette proposition a été largement critiquée, aussi bien par les étudiants eux-mêmes que par nombre d’universitaires.
Ces derniers ont parlé d’une décision « précipitée » et « irréfléchie » de la part du ministre actuel de ce département. Beaucoup ont ainsi expliqué que si l’on venait à introduire une nouvelle langue d’enseignement, les étudiants perdraient le nord.
Les étudiants risqueraient de faire face à des difficultés sur les plans de la compréhension et de la rédaction. Le taux d’échec n’en sera que plus élevé, selon les mêmes avis.
D’autres ont expliqué que la mise en œuvre d’un tel projet mérite que des experts avérés se penchent sérieusement dessus.
Des études doivent notamment être initiées pour mesurer la faisabilité de la chose. Ils disent encore que les défaillances qui marquent les facultés algériennes ne résident absolument pas dans la langue avec laquelle sont dispensés les cours.
Les conditions peu reluisantes de l’université se posent, d’après eux, au niveau pédagogique, entre autres. Par ailleurs, beaucoup ont interprété cela comme « une arrière-pensée politique » de la part des autorités.
En ce qui concerne les étudiants ou ceux qui se préparent à rejoindre l’université, là encore, nous sommes loin de l’unanimité vis-à-vis de ce changement de langue.
Certes, il y en a qui sont pour et ceux qui ne rejettent pas totalement l’idée, mais pour beaucoup, qui ne maîtrisent pas l’anglais, cela peut devenir source d’appréhension.
Pour rappel, le premier responsable du secteur, Tayeb Bouzid, a annoncé le lancement d’un sondage en ligne pour avoir l’avis des étudiants sur la faisabilité de la chose.
Ce dernier, commentant les résultats dudit sondage, a affirmé sur sa page facebook officielle qu’un « échantillon de 33 000 personnes a été sondé, avec une réponse favorable représentant 95,2% des voix exprimées, alors que seulement 4,8% des étudiants participants à cette consultation se disent opposés à ce changement ».
Massiva Zehraoui