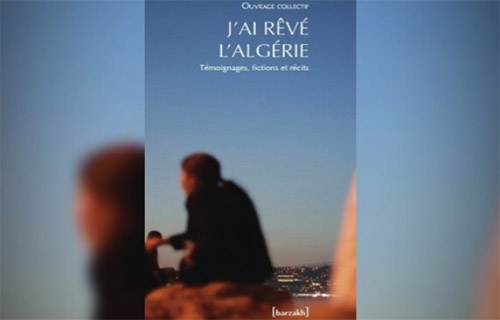
Un ouvrage collectif réunissant des textes d’une quinzaine auteurs de différents horizons sur une Algérie rêvée et la perception de la vie de l’Algérien dans un futur relativement proche, a été publié récemment sous le titre «J’ai rêvé l’Algérie».
Cet ouvrage de 192 pages publié aux éditions Barzakh, a été élaboré dans le cadre des activités de la fondation Friedrich-Ebert en Algérie qui devait organiser des ateliers sur ce thème, transformés finalement en livre collectif pour cause de pandémie de Covid-19. Amina Izarouken, chargée des programmes à la fondation, a expliqué que ce projet a été «très favorablement accueilli par les auteurs participants qui ont accepté de partager avec les lecteurs leurs rêves algériens».
Entre fictions, récits, poèmes et témoignages, 14 auteurs entre écrivain, journaliste, étudiant, architecte, psychologue et sociologue ont pris part à ce projet à l’instar du romancier, chroniqueur et acteur Chawki Amari, la journaliste et romancière Sarah Haidar, la poétesse et cinéaste Habiba Djahnine ou encore la psychologue et thérapeute de famille Bouchra Fridi. Dans la partie fiction de cet ouvrage, la qualité de vie appuyée par une transition écologique, technologique et urbanistique prime sur les textes d’auteurs comme le romancier Samir Toumi, qui emmène son lecteur en balade à Alger 80 ans après le hirak du 22 février 2019, la romancière Hajar Bali, rêvant d’une gestion complètement numérisée et participative, ou encore l’architecte Mohamed Larbi Merhoum pour qui la dynamique passe par la redynamisation du cadre de vie.
Dans les «rêves» des auteurs, des projets écologiques comme «Green Algiers» ou numérique comme «Smart Country» révolutionnent la vie de l’Algérien de demain avec un grand intérêt pour la végétation en milieu urbain et les modes de transport propres, une implication dans la vie associative et la gestion locale, une réhabilitation de l’espace urbain, ou encore une vie culturelle des plus dynamiques. Dans un autre style d’écriture Chawki Amari propose un sorte d’état des lieux de la profession de journaliste et une projection sur ce que pourrait être les médias de façon générale alors que la sociologue Khadidja Boussaid aborde le domaine de la recherche scientifique qu’elle rêve de voir reconsidéré.
Chacun des textes de cet ouvrage restitue un fragment d’intimité et rend compte d’une part de soi sans se positionner dans la proposition de plan de développement ou d’une feuille de route. L’éditrice de cet ouvrage, Selma Hellal, estime pour sa part que les auteurs ont tenu à proposer des textes avec une pointe d’humour, éloignés du défaitisme de la revendication et du militantisme, abordant différents aspects de la vie de chacun et de son environnement. Non destiné à la vente, «J’ai rêvé l’Algérie» a été tiré à mille exemplaires disponibles gratuitement dans plusieurs librairies du pays et au siège de la fondation Friedrich-Ebert. L’ouvrage sera prochainement traduit en langue arabe selon l’éditeur.
R. C.
Ainsi donc, le nom Algérie envahit les cerveaux de ceux et celles qui ont mal à leur pays. Ce sont des femmes et hommes qui n’ont pas le même nombre de printemps et, cependant, toutes et tous portent la marque de la mémoire d’une terre labourée par la guerre, le terrorisme, la misère et l’absence de la démocratie. Les enfants de ce pays ont une mère qui se fait élire et porte dorénavant la casquette de maire d’une commune. L’écrivain/architecte Merhoum nous décrit un trio ô combien ! symbolique d’une Algérie éparpillée ici et là, qui se reconstitue derrière la mère/maire. Une femme donc qui donne sa chance à un jeune ex-émigré et à une jeune femme «Betbota» (2). Ainsi, rien n’est perdu puisque le narrateur assiste enfin à la concrétisation de son rêve à lui : «Belouizdad, terre de toutes les mémoires, terre de tous les espoirs. J’en ai rêvé. Betbota l’a fait.»
Ce pays, son nom revient dans toutes les nouvelles de cet ouvrage collectif. Dans ces récits de fiction ou documentaire, l’Algérie est présente, non pas sous forme d’indice géographique ou historique, mais simplement de façon obsessionnelle. Elle colle à la peau des auteurs comme une sangsue. L’Algérie est à l’origine de leur fuite éperdue (ici dans les écrits) pour échapper à la chape de plomb qui empêche de voir le ciel la journée, et la nuit de regarder les étoiles. Un pays pourtant gorgé de soleil qui ne caresse pas nos peaux (surtout celle des femmes) de son incomparable lumière méditerranéenne : «Notre pays ne nous a rien donné et ne donnera jamais rien à des prostituées.» (Atiqua Belhacène, critique d’art).
Alors, pour traverser ce champ de bataille où chaque mètre carré de terre peut cacher une mine, alors que les yeux aimeraient savourer les couleurs arc-en-ciel des paysages, personne ne songe chasser les ténèbres et les remplacer par les nuages d’antan pour faire revenir un peu de fraîcheur. Il ne reste alors aux auteur(e)s de ces écrits, pour tenir debout dignement, qu’à rêver. Ô pas de rêves de la fée qui attend son prince, mais de laisser des traces d’écriture qui parlent de leur quotidien, de leurs nuits hantées par des fantômes… pour qu’un jour les futurs habitants sachent les calvaires traversés par leurs ascendants, pour qu’un jour ils fassent alors et, enfin, de vrais rêves. Des rêves de femmes et d’hommes qui se rencontrent pour ouvrir les portes non pas d’un illusoire paradis mais celles de la beauté à construire et à offrir comme un présent à leur bien aimé(e) le passeport du futur pour sortir de l’insoutenable enfermement : «Les pavés et les chemins sinueux connaissent les cris, les, rires, les chants. Devinent le poids de nos pas désabusés. J’entends des mots qui ne riment pas avec mes rêves.» (Habiba Djahnine, poétesse et réalisatrice.)
Rêver la beauté à partir de l’enfermement, tel le pari réussi de ces auteur(e)s. Pari réussi grâce à cette littérature qui n’a pas peur des mots qui défrisent, qui fait appel à ces mots interdits par une morale aux ras des pâquerettes, des mots qui se moquent de la langue riquiqui des analphabètes qui s’autoproclament scribes d’une académie. Ils ne savent pas qu’ils ne sont que des serviteurs des gardiens du Temple. En tout cas cette littérature truffée de mots fort peu usités chez nous ne se laisse pas tomber des mains comme celle qui ennuie parce que sentant la naphtaline. Le lecteur est plutôt content de lire la dénonciation de la violence inouïe que les citoyens lambda endurent, et en particulier les femmes. Les récits sur les douloureuses vies de femmes sont d’une force qui suscite respect et admiration. Les mots de la vie quotidienne sculptés par les plumes de leurs auteures témoignent, ô combien ! du lien qui existe entre les souffrances des femmes, la maltraitance des enfants et le déchaînement de ces agressions maladives qui balafrent des vies dans les rues, à l’intérieur des familles, sur les lieux de travail.
Chawki Amari, dont on connaît les chroniques d’une ironie mordante, ausculte le monde de la presse tombée dans les filets, ici du pouvoir, ailleurs de la finance. Il ne s’inquiète pas pour son avenir, il sait que la machine ne peut reproduire son humour. En bon camarade, il pense à ses collègues qui pratiquent le «vieux» journalisme qui ne peut plus, hélas, rivaliser avec les médias qui se livrent à une entreprise d’abrutissement de la société. Il a tellement raison Chawki. Après le parti unique, le pouvoir de l’argent et la nécessité de plaire à un certain électorat, la marge de manœuvre de la presse s’amenuise. Même des journaux qui étaient des fenêtres d’où l’on pouvait observer et rapporter les bruits de la ville tirent leurs rideaux. De peur sans doute que des opinions encore libres prennent des chemins de traverse et portent préjudice aux miettes de leurs ressources publicitaires. «Je serai peut-être l’un des derniers à être remplacé par une machine parce que celle-ci a encore un problème de recul, et notamment avec l’humour, arme suprême du recul et finalement dernier ressort de l’humain.» (Chawki Amari écrivain, journaliste).
Ce qui est rassurant, c’est de voir, au milieu des champs de la culture abandonnés aux friches depuis belle lurette, surgir des francs-tireurs avec, dans leurs besaces, un roman, un film, un essai, un tableau de peinture qui voyagent et réussissent à franchir des frontières sans l’autorisation des lourdeurs et des laideurs des censeurs, ni l’aval du marché qui ne reconnaît qu’un seul maître, le dieu dollar. Et ces exploits n’ont pas besoin de prix. Il leur suffit de contribuer à construire pierre par pierre des récits pour, qu’à l’avenir, on consacre moins de temps à rêver et plus de temps à aimer, à imaginer, travailler, réfléchir et à hurler à tue-tête : vivons parbleu !
Samir Toumi (écrivain, entrepreneur conseil) a déjà commencé son voyage sans franchir les frontières de l’Algérie, capitale Alger. Il aime bien Alger, sa ville natale qu’il nous fait découvrir rue par rue. Il a le temps maintenant et il le prend ce sacré temps pour nous parler du Hirak, de ses militants. Il termine sa balade en regardant dans son quartier des enfants jouer et clôt ainsi son récit : «Des enfants qui, enfin, récoltent les fruits de nos combats.»
Hajar Bali (poète, romancière) doute de ce qu’elle voit. Dans un jardin public devenu asile pour accueillir les amours interdits : désir infini jamais assouvi, le rêve n’est-il finalement que l’expression du plus total désir d’accaparement. Son héros est victime des détonations de la guerre qui brouille son regard et s’interroge sur la réalité de la scène des jeunes amoureux qui se bécotent sur un banc public (Brassens).
La guerre, encore la guerre, toujours la guerre. Pourquoi se focalise-t-on sur le passé et tourner le dos à l’avenir, se demande Salah Badis (écrivain/journaliste). On a envie de lui répondre, parce que nos nuits sont peuplées de cauchemars, parce que nos rues sont interdites aux femmes, parce que l’espace public est livré à la laideur pour tenir compagnie à la solitude des passants. Dans pareille vie, comment peut-on simplement se représenter la beauté ? Sacrée beauté qui fait rêver, tu nous manques, hélas, trois fois hélas.
A. A.
1- Rêver l’Algérie. On peut le télécharger gratuitement à : 17243.pdf
2- Betbota, sobriquet traduit par l’auteur par femme rondelette. Dans mon patelin, il a un autre sens pas très gentil pour la femme. J’ai écrit à l’éditeur pour savoir si le sens de ce sobriquet était typiquement «algérois». J’ai oublié que nous habitions bled Mickey car j’attends toujours sa réponse. En vérité, je n’ai pas été étonné de sa non-réponse car cette anomalie est «normale». On va encore patienter avant que le normal chez nous détrône l’anomalie. Ce jour-là, on pourra dire que notre pays ressemble aux autres, pas trop tout de même pour ne pas échouer dans celle de la triste banalité du quotidien. Mais plutôt accoster dans des rivages où fleurissent de vraies «Anomalies», celle du prix Goncourt 2020.
LIRE AUSSI :
![]() À quoi rêve l’Algérien ?! par Amine Zaoui
À quoi rêve l’Algérien ?! par Amine Zaoui
Je suis sûr et certain que l’Algérien, tout Algérien, fait ses rêves les yeux grands ouverts. Il appartient à ces créatures qui rêvent en plein jour, sous le soleil de plomb. Il rêve éveillé, réveillé. Qu’il pleuve ou qu’il vente, il rêve en marchant. Il rêve en sirotant son café. En prieur, en menteur, en coléreux, en amoureux, il rêve. En conduisant sa voiture ou en marchant à pied. Il rêve aussi en rêvant de quelque chose rêvée !
Mais pourquoi l’Algérien rêve-t-il consciemment et en plein jour ?
À l’origine, c’est la maman algérienne qui lui apprend comment rêver de cette façon revivifiée et ensoleillée. En faisant sa première sortie, sa première incursion dans l’espace de la bande du village ou du quartier, la voix de sa mère lui chuchote au creux de l’oreille : sois un homme, rajal, viril ! Et cet Algérien passera sa vie rêvant de trouver le sens de ce mot : “Homme”. Comment devenir un Homme ? Perplexe.
Puis viendra le rôle de la rue, de la bande, qui à son tour lui apprend la deuxième leçon de la vie : la prison est faite pour les hommes. Et ainsi, cet Algérien passera sa vie en rêvant de tomber sur le sens de cette expression : “La prison est faite pour les hommes et les hommes sont faits pour la prison.”
Puis viendra le tour du voisin, le plus malin des voisins, pour lui ouvrir les yeux sur la manière de rêver réveillé, en lui disant sur un ton fort et certain : il faut que tu sois malin, qafez, dans ta vie. Et cet Algérien passera sa vie en rêvant de devenir “qafez, malin” dans son travail, au hammam, dans sa langue, dans son silence, dans son parti, dans ses pierres, dans sa façon de mâcher son chewing-gum… D’abord, c’est quoi le sens du mot “qafez” ? Il signifie : épargne-toi les pièges et les yeux guetteurs, et tout est permis pour toi. Ainsi, tout Algérien rêve, à midi comme à quatorze heures, de devenir président de la République algérienne démocratique et populaire. C’est le rêve le plus commun et le plus banal. Ce n’est pas pour sauver son pays mais juste parce qu’il veut faire comme Ben Bella, Boumediene, Chadli ou Bouteflika. Une vengeance. Ces derniers ne sont pas meilleurs que lui. Il rêve de devenir président parce que chaque Algérien est né pour devenir président. Et en chaque Algérien, il y a un petit dictateur qui s’endort et se réveille ! En chaque Algérien, la culture de la rancune, de la rancœur et de la dictature est bien nourrie !
Depuis qu’il a regardé le ciel, enfant encore, depuis qu’il a vu un avion survoler son village, sa ville ou sa dechra, l’Algérien rêve d’être embauché par Air Algérie. C’est Air Algérie avec ses avions dans le ciel qui le rapproche de ses rêves journaliers ! Et pourtant tous les Algériens critiquent Air Algérie !
L’Algérien rêve de travailler comme gardien de nuit. Le boulot préféré des Algériens ! Le job le plus demandé, le plus recherché par tout le monde de 17 à 77 ans ! L’Algérien aime travailler la nuit pour rêver le jour ! En réalité, il préfère ce boulot pour dormir parce qu’il n’y a rien à garder, et pour se réveiller en bonne forme afin de rêver toute la journée !
L’Algérien rêve d’être recruté à Sonatrach. À Sonatrach, c’est le travail des princes. C’est le rêve national par excellence ! Elle est excitante et séduisante, cette Sonatrach ! Sur cet immense rêve, il n’y a pas de divergence, chez les Algériens. Le consensus ! L’Algérien aime le pétrole et le parfum du gasoil ! L’Algérien dénonce la corruption et rêve de travailler dans la société la plus corrompue, soubhanallah wa astaghfiroullah ! Tout le monde veut téter, sucer, sucrer et se sucrer, emmieller et s’emmieller. Pourquoi pas moi, pourquoi pas nous tous ? Consensus !
L’Algérien rêve d’une belle femme, avant le mariage, à l’image d’Angelina Jolie, de Brigitte Bardot, de Marilyn Monroe, de Faten Hamama ou de Leïla Tahar. Mais une fois qu’il pense au mariage, il rêve d’une femme qui ressemble à sa mère El Hadja ! Consensus social !
Par rejla, virilité, l’Algérien rêve d’interdire à sa femme de travailler, tout en fumant une cigarette, mais broyé par la machine infernale de la réalité, il préfère ne pas perdre son salaire ! Il rêve les yeux ouverts d’un salaire mensuellement dans la poche ! Consensus !
L’Algérien rêve de quitter son pays l’Algérie qu’il qualifie de tous les noms d’oiseau. Mais une fois dans une autre contrée, il porte avec lui, en lui ce pays avec tous les noms d’oiseau pour continuer à rêver debout, même sous d’autres cieux !
A. Z.
[email protected]
Désintérêt et faible présence
Littérature pour enfants en Algérie

Nombre d’éditeurs, d’auteurs et de critiques sont unanimes à dire que l’écriture littéraire pour enfants en Algérie souffrait d’un désintérêt et d’une «faible» présence, en raison de la «médiocrité» de la publication locale, de la «dominance des contenus étrangers» et du «désintérêt des autorités concernées», sachant que ce genre de littérature avait connu sa période dorée dans les années 70 et 80.
Pour l’écrivaine, Djamila Zennir qui s’est lancée dans la littérature pour enfants dans les années 80, avec à son actif près de 700 contes, la situation de cette littérature est «catastrophique» en comparaison avec les années 70 et 80, lors desquelles elle avait connu son apogée, regrettant qu’«aucun intérêt ne soit accordé à l’enfant en particulier dans l’écriture des contes ou bien dans les autres domaines à l’instar de la musique».
«Une grande partie des auteurs et écrivains s’intéresse davantage aux questions religieuses, conférant à ses écrits une espèce d’ennui et de monotonie», d’autant que l’enfant «est intelligent, aime la nouveauté et la variété et déteste la monotonie», a-t-elle expliqué, ajoutant que les contes universels très répandus «ne sont pas adaptés à l’enfant algérien, car ne respectant pas ni son milieu, ni ses valeurs sociales et religieuses».
L’auteure a appelé, à cet effet, à la «mise en place d’une commission mixte entre les ministères de la Culture et de l’Education nationale dans l’objectif de promouvoir ce domaine, d’autant que l’Algérie «regorge de nombreux écrivains brillants et doués qui sont toujours à la quête d’éditeurs». Pour sa part, Abdelhamid salhi, éditeur et directeur de la maison d’édition «Al Maktaba El Khadraa» (Bibliothèque verte), fondée dans les années 80 et éditant en langues arabe et française, considère que le marché du livre pour enfants «manque d’organisation et de qualité», étant plutôt commercial que professionnel, appelant les autorités concernées (Ministères de la Culture et de l’Education) à soutenir les «éditeurs professionnels spécialisés», afin de protéger le marché contre le rush des importateurs et des éditeurs étrangers avec leurs contenus intrus».
«Un bon livre pour enfant s’appuie sur trois critères essentiels : la langue utilisée, les dessins et le choix de la qualité du papier (…) d’où son prix élevé», voila pourquoi l’Etat est appelé à intervenir dans la subvention du livre, a-t-il affirmé. Ainsi, ce secteur «contribuera à l’encouragement de la créativité et à l’exploitation optimale des ressources humaines notamment des écrivains et des dessinateurs», a-t-il poursuivi. Pour d’autres éditeurs, la situation de la littérature pour enfants n’est toutefois pas aussi catastrophique, à l’instar de la maison d’édition «Atfalna»(nos enfants) dont le directeur, Firas Johmani estime que le domaine de l’édition demeure «satisfaisant», en dépit de certaines difficultés rencontrées, soulignant que leur marge de bénéfice est «très faible», en raison du coût élevé du livre et de son prix bas par rapport à d’autres publications. Le même intervenant a fait savoir que sa maison d’édition traitait avec des auteurs et des dessinateurs «professionnels» d’Algérie et d’autres pays arabes, dont les écrits portent sur différents thèmes, notamment le patrimoine arabo-musulman, outre l’adaptation du patrimoine universel et mondial, et ce loin de toute référence à la violence ou à autre pratique susceptible de nuire aux enfants, a-t-il fait savoir.
De son côté, le critique universitaire, Mohamed Sari a estimé que «la littérature pour enfants en Algérie n’est pas marginalisée mais plutôt inapparente à l’opinion publique, en raison du manque d’intérêt par les critiques et les médias pour ce créneau, déplorant dans ce sens l’absence d’une littérature pour la jeunesse». M. Sari revient également sur ce qu’il qualifie de «médiocrité» dont souffre cette littérature, estimant que les écrivains et les éditeurs qui sont nombreux «prennent avec légèreté» ce type d’écriture, en dépit de ses «exigences créatives, linguistiques et psychologiques…», soulignant par ailleurs que l’enfant a besoin davantage de contes remplis d’histoires fantastiques, d’étrangeté et de découverte, et non pas uniquement de conseils et de morale.
Approchés par l’APS, nombre de libraires ont relevé un «intérêt particulier des parents» pour le livre pour enfants. A cet égard, Lamsioui Redouane, gérant de la librairie «Nadji Mega Bookstore» à Alger, librairie disposant de plusieurs annexes dans de nombreuses villes, a fait état d’une «forte demande sur le livre pour enfants et une plus grande prise de conscience de son importance», se réjouissant du fait qu’Internet et les supports audiovisuels n’ont pas impacté les ventes de ces livres. «Notre librairie à Alger propose 4.500 titres de livres pour enfants en arabe, français et anglais» et leur prix sont «accessibles à tous »» (à partir de 15 DA), a-t-il indiqué, soulignant que les ventes dans les grandes villes sont «bien meilleures que dans les villes intérieures». Pour les parents, le livre reste «le meilleur moyen d’apprentissage» pour l’enfant, mais son prix «élevé» les oblige à recourir aux CD et à internet qui offrent un contenu audiovisuel alternatif, large, varié et attrayant.
R.R/Agence




