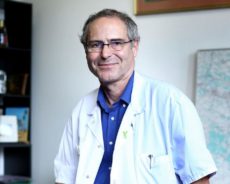![]() Le président de la Bolivie de 2006 à 2019 invite Declassified dans sa maison au cœur de la forêt amazonienne pour une interview exclusive – sur le rôle du Royaume-Uni dans le coup d’État qui l’a renversé, sur la façon dont il a inversé 500 ans d’histoire et industrialisé la Bolivie, et sur les efforts des États-Unis et de leur allié britannique pour le faire tomber.
Le président de la Bolivie de 2006 à 2019 invite Declassified dans sa maison au cœur de la forêt amazonienne pour une interview exclusive – sur le rôle du Royaume-Uni dans le coup d’État qui l’a renversé, sur la façon dont il a inversé 500 ans d’histoire et industrialisé la Bolivie, et sur les efforts des États-Unis et de leur allié britannique pour le faire tomber.
–
- LE COUP D’ÉTAT : « Le Royaume-Uni y a participé – tout ça pour du lithium. »
- LES BRITANNIQUES : « La supériorité est si importante pour eux, la capacité à dominer. »
- LES ÉTATS-UNIS : « Toute relation avec eux est toujours soumise à des conditions. »
- NOUVEAU MODÈLE : « Nous ne nous soumettons plus aux sociétés transnationales. »
- JULIAN ASSANGE : « La détention de notre ami est une intimidation. »
- OTAN : « Nous avons besoin d’une campagne mondiale pour l’éliminer. »
- BOLIVIE : « Nous mettons l’anti-impérialisme en pratique. »
–
Lorsque Evo Morales, le premier président indigène de Bolivie, a été renversé par un coup d’État soutenu par les Britanniques en novembre 2019, beaucoup ont cru que sa vie était en danger. L’histoire de l’Amérique latine est jonchée de leaders de la libération fauchés par des puissances impériales vengeresses.
Le légendaire leader de la résistance Túpac Katari, comme Morales, issu du groupe autochtone aymara, a vu ses membres attachés à quatre chevaux par les Espagnols avant qu’ils ne s’enfuient et qu’il soit déchiqueté en 1781.
Quelque 238 ans plus tard, la « présidente intérimaire » autoproclamée de Bolivie, Jeanine Áñez, est apparue au Congrès quelques jours après le coup d’État contre Morales, brandissant une énorme Bible reliée en cuir. « La Bible est revenue au palais du gouvernement », a-t-elle annoncé.
Son nouveau régime a immédiatement fait adopter le décret 4078 qui accordait l’immunité aux militaires pour toute action entreprise dans le cadre de la « défense de la société et du maintien de l’ordre public ». C’était un feu vert. Le jour suivant, 10 manifestants non armés ont été massacrés par les forces de sécurité.
Lorsque le coup d’État semblait inévitable, Morales est entré dans la clandestinité.
Sa destination, avec son vice-président Álvaro García Linera, était El Trópico de Cochabamba, une région tropicale au cœur de la forêt amazonienne, dans le centre de la Bolivie, et le cœur de son parti, le Movimiento al Socialismo (MAS), et sa base indigène.
Avant de démissionner officiellement, il s’est rendu à l’aéroport isolé de Chimoré, où les cultivateurs de coca locaux avaient fermé les routes d’accès.
La feuille de coca constitue la base de la cocaïne et l’aéroport, avant que Morales ne devienne dirigeant, avait été une base stratégique pour la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine dans la région. Morales avait chassé la DEA de Bolivie en 2008 et transformé la base en aéroport civil. La production de coca a rapidement diminué.
Quelques jours après l’arrivée de Morales et Linera à El Trópico, le président de gauche mexicain Andrés Manuel López Obrador a envoyé un avion pour les secourir, les faisant décoller à nouveau de l’aéroport de Chimoré.
Obrador a déclaré par la suite que les forces armées boliviennes avaient visé l’avion avec un missile RPG quelques instants après son décollage. Il semble que le régime putschiste soutenu par le Royaume-Uni souhaitait la mort du président déchu, qui avait servi pendant 13 ans. Morales attribue à Obrador le mérite de lui avoir sauvé la vie.
Des proches pleurent à côté de cercueils lors des funérailles de personnes tuées par les forces de sécurité du régime du coup d’État, le 20 novembre 2019 à El Alto, en Bolivie. (Photo : Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)
Villa Tunari
Morales est maintenant de retour à El Trópico, mais dans des circonstances très différentes.
Après une année de « gouvernement intérimaire », la démocratie a finalement été rétablie en octobre 2020 et le MAS de Morales a de nouveau remporté les élections. Le nouveau président Luis Arce, ancien ministre de l’Economie de Morales, a pris le pouvoir et Morales a fait un retour triomphal de son exil en Argentine.
Après avoir visité une grande partie du pays à pied, Morales s’est réinstallé à El Trópico.
Il a récemment emménagé dans une maison à Villa Tunari, une petite ville située à seulement 30 km de l’aéroport de Chimoré. Elle compte un peu plus de 3 000 habitants.
Pour s’y rendre depuis Cochabamba, la ville la plus proche, il faut quatre heures à l’arrière d’un des minibus qui partent toutes les dix minutes. En chemin, vous traversez Sacaba, la ville où le régime a massacré 10 manifestants le lendemain du jour où a été accordée l’impunité aux militaires.
Plus le minibus s’enfonce dans El Trópico, plus l’importance de Morales et de son parti MAS devient évidente.
Les maisons en parpaings avec des toits en tôle ondulée, le logement des pauvres du monde, commencent à avoir des peintures murales avec le visage de Morales sur le côté. Son nom en majuscules – EVO – est bientôt partout. Tout comme le mot MAS.
Tunari est une ville indigène traditionnelle et une destination touristique, entourée de parcs nationaux. Depuis le rétablissement de la démocratie, l’industrie du tourisme a repris du poil de la bête. El Trópico, qui constitue l’épine dorsale du soutien à Morales et au MAS, a fait l’objet d’une répression pendant la période où le régime du coup d’État était au pouvoir. Pendant une période, le régime Áñez a désactivé les guichets automatiques bancaires dans la région, dans le but de l’isoler complètement.
Mais Tunari grouille à nouveau de vie aujourd’hui. Le long de la rue principale, s’alignent des restaurants de poulet frit et de poisson. Des bus au repos enfument la gare rout!ère de la ville, tandis que des hôtels et des auberges s’étirent le long des routes secondaires. Une rivière tumultueuse de couleur sépia coule le long de la ville. Celle-ci ressemble à l’escale stéréotypée du routard latino-américain.
L’entrée de la ville de Villa Tunari, dans le centre de la Bolivie, où vit actuellement Evo Morales. (Photo : Matt Kennard/DCUK)
Un partenaire stratégique
J’arrive à Tunari en fin d’après-midi le samedi, après un long vol vers Cochabamba et un trajet de quatre heures en minibus.
L’entretien avec Morales est prévu pour lundi, mais lorsque j’arrive et que j’allume le WiFi sur mon téléphone, je reçois une série de messages de son assistant. Morales a presque fini sa journée et veut faire l’interview plus tard dans la soirée, dans quelques heures. Il veut également la faire chez lui. Morales est connu pour son éthique de travail.
Peu de temps après, mon collègue, qui va filmer l’entretien, vient me chercher. Au milieu d’une tempête de pluie tropicale, avec des trombes d’eau tombant comme des briques, nous prenons un tuk-tuk dans la ville et nous nous asseyons sous une bâche en sirotant un café, attendant l’appel de son assistant.
Il finit par arriver, et nous nous entassons dans un autre tuk-tuk et traversons les ruelles de la ville avant d’atteindre les murs d’une maison anodine. Une femme vient à notre rencontre et nous fait entrer. Nous entrons dans le salon, qui est vide à l’exception de deux canapés. J’apprendrai plus tard qu’il s’agit de la première interview d’un journaliste réalisée chez lui par Morales.
J’ai obtenu l’entretien à cause d’une enquête que j’ai écrite en mars 2021 et qui révélait le soutien du Royaume-Uni au coup d’État qui a destitué Morales.
Le ministère britannique des Affaires étrangères a publié 30 pages de documents sur les programmes menés par son ambassade en Bolivie. Ces documents montrent que l’ambassade semble avoir payé une société basée à Oxford pour optimiser « l’exploitation » des gisements de lithium boliviens, le mois suivant la fuite de Morales.
Elles montrent également que l’ambassade du Royaume-Uni à La Paz a agi en tant que « partenaire stratégique » du régime putschiste et a organisé un événement minier international en Bolivie quatre mois après le renversement de la démocratie.
L’histoire est devenue virale en Bolivie. Le ministre des Affaires étrangères, Rogelio Mayta, a fait appel à l’ambassadeur britannique Jeff Glekin pour expliquer le contenu de l’article et a demandé un rapport sur les conclusions. L’ambassade britannique à La Paz, la capitale de la Bolivie, a publié une déclaration affirmant que Declassified était engagé dans une « campagne de désinformation », mais n’a fourni aucune preuve.
Jeff Glekin, ambassadeur du Royaume-Uni, avec la « présidente par intérim » de Bolivie, Jeanine Áñez, le 9 janvier 2020. (Photo : Jeff Glekin/Twitter)
Industrialiser la Bolivie
Les journalistes locaux m’ont dit que Morales mentionne souvent l’article dans ses discours, je commence donc par là.
« Pas plus tard que l’année dernière, par le biais des médias, nous avons été informés que l’Angleterre avait également participé au coup d’État », me dit-il. Cela, poursuit-il, a été un « coup contre notre modèle économique, parce que notre modèle économique a produit des résultats. »
Il ajoute : « C’est un modèle économique qui appartient au peuple, pas à l’empire. Un modèle économique qui ne vient pas du Fonds monétaire international. Un modèle économique qui vient des mouvements sociaux. »
Morales poursuit : « Lorsque nous sommes arrivés au gouvernement en 2006, la Bolivie était le dernier pays d’Amérique du Sud en termes d’indicateurs économiques et de développement, l’avant-dernier pays de toute l’Amérique. »
Au cours des 13 années suivantes de son gouvernement, la Bolivie a connu sa période la plus stable depuis sa déclaration d’indépendance en 1825, et a connu un succès économique sans précédent, même salué par le FMI et la Banque mondiale. Ce succès s’est surtout traduit par des améliorations sans précédent pour les pauvres de Bolivie.
« C’est un modèle économique qui appartient au peuple, pas à l’empire. »
« Pendant les six premières années, nous avons eu les niveaux de croissance économique les plus élevés de toute l’Amérique du Sud et c’est grâce à ces politiques issues des mouvements sociaux et basées sur la nationalisation », me dit Morales.
Il faisait partie de la « marée rose » des gouvernements de gauche en Amérique latine dans les années 2000, mais son modèle était économiquement plus radical que la plupart.
Le centième jour de son mandat, Morales a pris l’initiative de nationaliser les réserves de pétrole et de gaz de la Bolivie, ordonnant à l’armée d’occuper les champs de gaz du pays et donnant aux investisseurs étrangers un délai de six mois pour se conformer aux exigences ou partir.
Morales estime que c’est ce programme de nationalisation qui a conduit au coup d’État soutenu par l’Occident contre lui.
« Je reste convaincu que l’empire, le capitalisme, l’impérialisme, n’acceptent pas qu’il existe un modèle économique meilleur que le néolibéralisme », me dit-il. « Le coup d’État était contre notre modèle économique ; nous avons montré qu’une autre Bolivie est possible. »
Valeur ajoutée
Selon Morales, la deuxième phase de la révolution – après la nationalisation – a été l’industrialisation. « La partie la plus importante était le lithium », ajoute-t-il.
La Bolivie possède les deuxièmes plus grandes réserves de lithium au monde, un métal utilisé pour fabriquer des batteries et qui est devenu de plus en plus convoité en raison de l’industrie florissante des voitures électriques.
Morales se souvient d’un voyage formateur qu’il a effectué en Corée du Sud en 2010.
« Nous discutions d’accords bilatéraux, d’investissements, de coopération et ils m’ont emmené visiter une usine qui produisait des batteries au lithium », raconte Morales. « Fait intéressant, la Corée du Sud nous demandait du lithium, comme matière première. »
Morales dit avoir demandé à l’usine combien coûtait la construction de l’installation. On lui a répondu 300 millions de dollars.
« Nos réserves internationales augmentaient », ajoute-t-il. « J’ai dit à ce moment-là : « Je peux garantir 300 millions de dollars ». J’ai dit aux Coréens : « Reproduisons cette usine en Bolivie. Je peux garantir votre investissement ». Les Coréens ont refusé.
« C’est là que j’ai compris que les pays industrialisés ne veulent de nous, Latino-Américains, que pour que nous puissions leur garantir leurs matières premières. Ils ne veulent pas de nous pour leur apporter la valeur ajoutée. »
« Je me suis rendu compte que les pays industrialisés ne veulent de nous, Latino-Américains, que pour que nous puissions leur garantir leurs matières premières. »
À ce moment-là, Morales s’est résolu à commencer à industrialiser la Bolivie, renversant ainsi un demi-millénaire d’histoire coloniale.
La dynamique impériale traditionnelle qui avait maintenu la Bolivie dans la pauvreté était la suivante : les pays riches extrayaient les matières premières, les envoyaient en Europe pour les transformer en produits, industrialisant l’Europe par la même occasion, puis les revendaient à la Bolivie sous forme de produits finis, avec une majoration.
Avec les gisements de lithium du pays, Morales était catégorique : ce système était terminé. La Bolivie ne se contenterait pas d’extraire le lithium. Elle construirait également les batteries. Morales appelle cela la « valeur ajoutée. »
« Nous avons commencé par un laboratoire, évidemment avec des experts internationaux que nous avons engagés », dit-il. « Puis nous sommes passés à une usine pilote. Nous avons investi environ 20 millions de dollars, et maintenant ça marche. Chaque année, elle produit environ 200 tonnes de carbonate de lithium, et de batteries au lithium, à Potosí. »
Potosí est une ville du sud de la Bolivie qui est devenue le centre de l’empire espagnol en Amérique latine après que des gisements d’argent gargantuesques y ont été découverts au XVIe siècle. Surnommée « la première ville du capitalisme », on estime que jusqu’à huit millions d’indigènes sont morts en extrayant l’argent du Cerro Rico (colline riche) de Potosí, qui était destiné à l’Europe.
Morales poursuit : « Nous avions un plan pour installer 42 nouvelles usines [de lithium] d’ici 2029. On estimait que les profits seraient de cinq milliards de dollars. Des profits ! »
« C’est à ce moment-là que le coup d’État est arrivé », dit-il. « Les États-Unis disent que la présence de la Chine n’est pas autorisée mais… avoir un marché en Chine est très important. En Allemagne aussi. L’étape suivante était avec la Russie, et puis il y a eu le coup d’État. »
Il poursuit : « Pas plus tard que l’année dernière, nous avons découvert que l’Angleterre avait également participé au coup d’État – tout ça pour du lithium. »
Mais Morales affirme que la longue lutte de son peuple pour le contrôle de ses propres richesses n’est pas unique.
« C’est une lutte qui ne se déroule pas seulement en Bolivie, ou en Amérique latine, mais dans le monde entier », affirme Morales. « À qui appartiennent les ressources naturelles ? Au peuple, sous le contrôle de son État ? Ou sont-elles privatisées sous le contrôle des transnationales pour qu’elles puissent piller nos ressources naturelles ? »
Jeff Glekin (au milieu), ambassadeur du Royaume-Uni en Bolivie, rencontre des responsables de l’entreprise publique de lithium du régime du coup d’État, mars 2020. (Photo : YLB)
Partenaires ou patrons ?
Le programme de nationalisation de Morales l’a mis sur une trajectoire de collision avec de puissantes sociétés transnationales qui étaient habituées à la dynamique impériale traditionnelle.
« Pendant la campagne de 2005, nous avons dit : si les entreprises veulent être ici, elles le font en tant que partenaires, ou pour fournir leurs services, mais pas en tant que patrons ou propriétaires de nos ressources naturelles, explique Morales. Nous avons établi une position politique à l’égard des sociétés transnationales : nous parlons, nous négocions, mais nous ne nous soumettons pas aux sociétés transnationales. »
Morales donne l’exemple des contrats d’hydrocarbures signés par les gouvernements précédents.
« Dans les contrats précédents – des contrats établis par les néolibéraux – il était littéralement dit : « Le détenteur du titre acquiert les droits sur le produit à l’embouchure du puits. Qui est le détenteur du titre ? La compagnie pétrolière transnationale. Elle le veut à l’embouchure du puits. »
Il ajoute : « Les compagnies nous disent que lorsqu’il est sous terre, il appartient aux Boliviens, mais lorsqu’il sort du sol, il n’appartient plus aux Boliviens. À partir du moment où il sort, les sociétés transnationales ont un droit acquis sur lui. Donc nous avons dit, à l’intérieur ou à l’extérieur, tout appartient aux Boliviens. »
Morales poursuit : « Le plus important maintenant, c’est que sur 100% des revenus, 82% sont pour les Boliviens et 18% pour les sociétés. Avant, c’était 82% pour les entreprises, 18% pour les Boliviens, et l’État n’avait aucun contrôle sur la production – combien ils produisaient, comment ils produisaient – rien. »
Ce fut une bataille difficile, ajoute Morales, et certaines entreprises sont parties.
« Nous respectons leur choix de partir », déclare Morales. « Mais nous avons dit qu’au lieu d’aller au CIADI, toute réclamation légale serait faite en Bolivie. C’était une autre bataille à laquelle nous avons dû faire face, afin que les réclamations soient traitées au niveau national, car c’est une question de souveraineté et de dignité. »
« Le plus important maintenant, c’est que sur 100 % des revenus, 82 % reviennent aux Boliviens et 18 % aux entreprises. »
Le CIADI est l’acronyme espagnol du CIRDI, qui est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Branche peu connue de la Banque mondiale, c’est la principale instance supranationale permettant aux sociétés transnationales de poursuivre les États pour avoir adopté des politiques qui, selon elles, violent leurs « droits d’investisseurs ». En réalité, il s’agit d’un système qui permet souvent aux entreprises d’annuler ou de freiner l’élaboration de politiques par des États souverains – ou de gagner des sommes considérables en compensation.
Dans le cadre de ce système « d’arbitrage », une entreprise britannique a intenté un procès à la Bolivie. En 2010, le président Morales a nationalisé le plus grand fournisseur d’énergie du pays, Empresa Eléctrica Guaracachi.
L’investisseur britannique dans le secteur de l’énergie, Rurelec, qui détenait indirectement 50,001 % des parts de l’entreprise, a assigné la Bolivie devant un autre tribunal investisseur-État, cette fois à La Haye, pour réclamer 100 millions de dollars de compensation.
La Bolivie a finalement été condamnée à verser 35 millions de dollars à Rurelec ; après de nouvelles négociations, les deux parties ont convenu d’un paiement d’un peu plus de 31 millions de dollars en mai 2014.
Rurelec a célébré l’obtention de cette récompense par une série de communiqués de presse sur son site web. « Ma seule tristesse est qu’il ait fallu autant de temps pour parvenir à un règlement », a déclaré le PDG du fonds dans un communiqué. « Tout ce que nous voulions, c’était une négociation amicale et une poignée de main du président Morales. »
Poser des conditions
Depuis la formation de la Doctrine Monroe en 1823 – qui revendiquait l’hémisphère occidental comme sphère d’influence des États-Unis – la Bolivie a été largement sous leur contrôle. Cela a changé pour la première fois avec l’avènement du gouvernement Morales.
« En tant qu’État, nous voulons avoir des relations diplomatiques avec le monde entier, mais basées sur le respect mutuel », me dit Morales. « Le problème que nous avons avec les États-Unis est que toute relation avec eux est toujours soumise à des conditions. »
Morales poursuit : « Il est important d’avoir un commerce et des relations fondés sur le bénéfice mutuel, et non sur la concurrence. Et nous avons trouvé certains pays européens qui le font. Mais nous avons surtout trouvé la Chine. Les relations diplomatiques avec eux ne sont pas fondées sur des conditions. »
Il ajoute : « Avec les États-Unis, par exemple, leur plan économique, la Millennium Challenge Corporation (MCC), si vous vouliez y avoir accès, vous deviez, en échange, privatiser vos ressources naturelles. »
« La Chine ne nous impose aucune condition, tout comme la Russie, et comme certains pays d’Europe. »
La MCC est un projet de l’administration de George W. Bush qui a cherché à gérer l’aide davantage comme une entreprise. Dirigée par un PDG, elle est financée par l’argent public mais agit de manière autonome et dispose d’un conseil d’administration de type société qui comprend des hommes d’affaires experts dans l’art de faire de l’argent. Les « contrats » d’aide qu’elle signe avec les pays sont assortis de « conditionnalités » politiques.
« La Chine ne nous impose aucune condition, tout comme la Russie, et comme certains pays d’Europe », ajoute Morales. « C’est donc la différence. »
Une fenêtre sur la façon dont le gouvernement américain a traditionnellement considéré la Bolivie provient d’une conversation privée de juin 1971 entre le président Nixon et son conseiller à la Sécurité nationale, Henry Kissinger.
Kissinger : Nous avons un problème majeur en Bolivie aussi. Et…
Nixon : J’ai compris. [Le secrétaire américain au Trésor John] Connally l’a mentionné. Que voulez-vous faire à ce sujet ?
Kissinger : J’ai dit à [Thomas] Karamessines, directeur adjoint de la CIA pour les plans, de mettre en place une opération, et ce, le plus rapidement possible. Même l’ambassadeur là-bas, qui a été un tendre, dit maintenant que nous devons commencer à jouer avec les militaires sur place ou ça va tomber à l’eau.
Nixon : Ouais.
Kissinger : C’est prévu pour lundi.
Nixon : De quoi Karamessines pense-t-il que nous avons besoin ? D’un coup d’Etat ?
Kissinger : Nous verrons ce que nous pouvons, dans quel contexte. Ils vont nous évincer dans deux mois. Ils se sont déjà débarrassés du Corps de la Paix, qui est un atout, mais maintenant ils veulent se débarrasser de [l’Agence d’information américaine] et des militaires. Et je ne sais pas si nous pouvons même envisager un coup d’État, mais nous devons découvrir ce qu’il en est là-bas. Je veux dire, avant qu’ils fassent un coup d’Etat, nous…
Nixon : Rappelez-vous, nous avons donné à ces putains de Boliviens cet étain.
Kissinger : Eh bien, nous pouvons toujours inverser cela. Alors nous…
Nixon : Inversez cela.
Le « problème majeur » en Bolivie dont parlait Kissinger était Juan José Torres, un dirigeant socialiste qui avait pris le pouvoir l’année précédente et essayait de rendre le pays indépendant.
Le coup d’État américain survient deux mois après la conversation entre Nixon et Kissinger et le général Hugo Banzer, un militaire, est mis en place. Torres s’est exilé et cinq ans plus tard, en 1976, il a été assassiné à Buenos Aires par l’opération Condor, un réseau terroriste d’extrême droite soutenu par la CIA qui opérait à l’époque dans toute l’Amérique latine.
Avant Morales, Torres était le dernier dirigeant de gauche en Bolivie.
Des mineurs boliviens se rassemblent pour soutenir l’ancien président Juan José Torres, renversé par un coup d’État militaire soutenu par les États-Unis et dirigé par le général Hugo Banzer Suárez, le 31 août 1971 à La Paz. (Photo : AFP via Getty Images)
La fête
Le gouvernement britannique a soutenu avec effusion le coup d’État de 2019 en Bolivie, accueillant chaleureusement le nouveau régime et louant le potentiel qu’il ouvrait aux entreprises britanniques pour gagner de l’argent grâce aux ressources naturelles du pays, en particulier le lithium.
Le 14 décembre 2019 – trois semaines après que le régime soutenu par le Royaume-Uni a procédé à un nouveau massacre de manifestants – l’ambassadeur britannique Jeff Glekin a même organisé un thé anglais déguisé sur le thème de Downton Abbey à l’ambassade britannique. Un gâteau Victoria sponge a été servi.
« Nous nous lamentons beaucoup sur le fait que les Anglais célébraient la vue de personnes décédées », me dit Morales. « Bien sûr, c’est notre histoire depuis l’invasion européenne de 1492. »
Il ajoute : « J’ai respecté certains pays européens pour leur libération des monarchies, mais il y a une continuation de l’oligarchie, de la monarchie, et de la hiérarchie, que nous ne partageons pas ». Morales affirme que le nouveau millénaire « est un millénaire du peuple, pas des monarchies, ni des hiérarchies, ni des oligarchies. C’est notre combat. »
Il ajoute à propos des Britanniques : « La supériorité est si importante pour eux, la capacité de dominer. Nous sommes des gens humbles, des gens pauvres, c’est notre différence. C’est répréhensible qu’ils n’aient pas de principe d’humanité, de fraternité. Ils sont, au contraire, esclaves des politiques de la manière de dominer. »
« Il est impossible de comprendre comment un pays européen au XXIe siècle a la mentalité de dire que ce n’était pas un coup d’État, cela n’a pas de sens. »
Concernant la relation avec le Royaume-Uni, Morales a déclaré : « Il existe de profondes différences idéologiques, programmatiques, culturelles, de classe, mais surtout de principes et de doctrine. »
Il ajoute : « Il y a des pays dans lesquels, avec leur politique d’État, ils ont toujours une mentalité de répression, d’isolement ou de condamnation, de répudiation des sœurs et des frères qui parlent de la vérité et défendent la vie et l’humanité. Je n’accepte pas cela. »
Je mentionne que lorsque j’ai contacté le ministère britannique des Affaires étrangères pour mon enquête initiale, ils m’ont dit simplement « Il n’y a pas eu de coup d’État » en novembre 2019. Que pense Morales de cela ?
« Il est impossible de comprendre comment un pays européen […] au XXIe siècle puisse penser que ce n’était pas un coup d’État, cela n’a pas de sens. »
Il ajoute : « C’est un état d’esprit totalement colonial. Ils pensent que certains pays sont la propriété d’autres nations. Ils pensent que Dieu les a mis là, donc que le monde appartient aux États-Unis et au Royaume-Uni. C’est pourquoi les rébellions et les soulèvements vont se poursuivre. »
Morales a grandi en voyant les résultats de son pays comme étant la propriété d’autres pays. Élevé dans une extrême pauvreté, quatre de ses six frères et sœurs sont morts dans l’enfance. Il s’est fait les dents comme « cocalero » (cueilleur de coca) et a été politisé par la « guerre contre la drogue » menée par les États-Unis en Bolivie. Il est devenu une figure nationale après avoir été élu à la tête du syndicat des cultivateurs de coca en 1996.
Jeff Glekin, ambassadeur du Royaume-Uni en Bolivie, anime un goûter anglais déguisé sur le thème de Downton Abbey à l’ambassade britannique, le 14 décembre 2019, trois semaines après que les forces du régime ont abattu 10 manifestants non armés. Anonymisation par Declassified. (Photo : Jeff Glekin/Twitter)
« Une intimidation »
Lorsque WikiLeaks a commencé à publier des câbles diplomatiques américains en 2010, elle a révélé une vaste campagne menée par l’ambassade des États-Unis à La Paz pour destituer le gouvernement de Morales. Il y avait depuis longtemps des soupçons, mais les câbles ont montré des liens clairs entre les États-Unis et l’opposition.
Je demande à Morales ce qu’il pense de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, qui en est à sa quatrième année dans la prison de haute sécurité de Belmarsh pour avoir dénoncé ces opérations impériales américaines et d’autres.
« Parfois, l’empire parle de liberté d’expression, mais au fond, ils sont des ennemis de la liberté d’expression », dit Morales. « L’empire, quand quelqu’un dit la vérité… c’est là que les représailles commencent, comme avec Assange. »
Il ajoute : « Certaines personnes… se lèvent contre ces politiques parce qu’elles estiment qu’il est important de défendre la vie, l’égalité, la liberté, la dignité. C’est alors que les représailles arrivent. »
« Je salue et admire ceux qui, mus par des principes de libération du peuple, disent la vérité », déclare Morales. « Cette détention de notre ami [Assange] est une escalade, une intimidation pour que tous les crimes contre l’humanité commis par les différents gouvernements des États-Unis ne soient jamais révélés. Tant d’interventions, tant d’invasions, tant de pillages. »
Morales ajoute : « Cette rébellion comprend aussi des ex-agents de la CIA, des ex-agents de la DEA qui disent la vérité sur les États-Unis. Les représailles arrivent toujours. »
« La réalité est que cela ne va pas se terminer, cela va continuer », poursuit Morales. « Donc à notre frère [Assange], j’envoie notre respect et notre admiration. J’espère qu’il y aura d’autres révélations à venir pour que le monde puisse s’informer […] de toute la criminalité qui existe dans le monde. »
« Cette détention de notre ami Assange est une intimidation pour que tous les crimes contre l’humanité commis par les États-Unis ne soient jamais révélés. »
Morales pense que l’information et la communication pour les « personnes qui n’ont pas de voix » est la question la plus importante aujourd’hui. Il travaille actuellement à la construction de médias indépendants en Bolivie.
« Les personnes qui ne disposent pas de nombreux moyens de communication sont confrontées à une lutte difficile pour communiquer », explique Morales. « Nous avons une certaine expérience, par exemple à El Trópico. Nous avons une radio, nous n’avons pas une audience nationale, mais elle est écoutée et beaucoup suivie par les médias de droite. » Ils suivent surtout pour trouver des lignes d’attaque contre Morales.
« Comme ce serait bien si le peuple avait ses propres canaux médiatiques », poursuit Morales. « C’est le défi que le peuple doit relever. Ce média que nous avons, qui appartient à l’empire ou à la droite en Bolivie, c’est comme ça dans toute l’Amérique latine. Ils défendent leurs intérêts… et ils ne sont jamais avec le peuple. »
Il ajoute : « Quand, par exemple, la droite fait une erreur, elle n’est jamais révélée, elle est couverte et ils se protègent. Les [entreprises de] médias sont là pour défendre leurs grandes industries, leurs terres, leurs banques, et ils veulent humilier les peuples boliviens, les humbles du monde. »
« J’ai beaucoup d’espoir »
L’Amérique latine a longtemps été le foyer du socialisme démocratique dans le monde. Je demande à Morales s’il a de l’espoir pour l’avenir. « En Amérique du Sud, nous ne sommes pas à l’époque d’Hugo Chávez, de Lula, de [Néstor] Kirchner, de [Rafael] Correa », répond-il.
Ensemble, ces dirigeants progressistes ont poussé à l’intégration de l’Amérique latine et des Caraïbes, à travers des organisations telles que l’Union des nations sud-américaines (UNASUR) en 2008 et la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) en 2011.
« Nous sommes tombés, mais maintenant nous nous remettons », ajoute Morales.
Les événements récents indiquent une autre résurgence de la gauche sur le continent. Morales souligne les récentes victoires au Pérou, au Chili et en Colombie, ainsi que le retour attendu de Lula à la présidence au Brésil prochainement.
« Ces temps sont en train de revenir », dit-il. « Nous devons à nouveau consolider ces révolutions démocratiques pour le bien de l’humanité. J’ai beaucoup d’espoir. »
Il poursuit : « En politique, nous devons nous demander : sommes-nous avec le peuple ou avec l’empire ? Si nous sommes avec le peuple, nous faisons un pays ; si nous sommes avec l’empire, nous faisons de l’argent. »
« Si nous sommes avec le peuple, nous nous battons pour la vie, pour l’humanité ; si nous sommes avec l’empire, nous sommes avec la politique de la mort, la culture de la mort, les interventions et le pillage du peuple. C’est ce que nous nous demandons en tant qu’humains, en tant que dirigeants : Sommes-nous au service de notre peuple ? »
« En politique, nous devons nous demander : sommes-nous avec le peuple ou avec l’empire ? »
Morales évoque ensuite l’invasion russe en Ukraine. « Je pense qu’il est temps maintenant, en voyant les problèmes entre la Russie et l’Ukraine… de faire une campagne internationale, au niveau mondial, en commençant par expliquer que l’Otan est – en définitive – les États-Unis. »
Il ajoute : « Mieux encore, une campagne orientée sur la manière d’éliminer l’OTAN. L’OTAN n’est pas une garantie pour l’humanité ou pour la vie. Je n’accepte pas – en fait, je condamne – la façon dont ils peuvent exclure la Russie du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU. Lorsque les États-Unis sont intervenus en Irak, en Libye, dans tant de pays ces dernières années, pourquoi n’ont-ils pas été expulsés du Conseil des Droits de l’Homme ? Pourquoi cela n’a-t-il jamais été remis en question ? »
Il ajoute : « Nous avons de profondes différences idéologiques avec la politique mise en œuvre par les États-Unis à l’aide de l’OTAN, qui est fondée sur l’interventionnisme et le militarisme. »
Il termine : « Entre la Russie et l’Ukraine, ils veulent trouver un accord et [les États-Unis] continuent à provoquer la guerre, l’industrie militaire américaine, qui arrive à vivre grâce à la guerre, et ils provoquent des guerres pour vendre leurs armes. C’est l’autre réalité dans laquelle nous vivons. »
Les guerres de l’eau
Morales est le président le plus reconnu de l’histoire de la Bolivie – et l’un des plus réputés de l’histoire de l’Amérique latine. Sa période de présidence est aussi sans doute l’expérience de socialisme démocratique la plus réussie de l’histoire de l’humanité. C’est dangereux pour les puissances impériales, qui ont longtemps mis en garde contre la menace d’un bon exemple.
Il a également mis fin à 500 ans de domination blanche en Bolivie, faisant entrer le pays dans le monde moderne pour la première fois. La nouvelle constitution de 2009 a « refondé » la Bolivie en un État « plurinational », autorisant l’autonomie des peuples indigènes du pays. Elle a créé un nouveau Congrès dont les sièges sont réservés aux petits groupes autochtones de Bolivie et a reconnu la divinité andine de la terre, Pachamama, à la place de l’Église catholique romaine.
« Les Indiens – ou les mouvements sociaux – comment est-il possible qu’ils puissent mener une révolution ? », demande Morales, se faisant passer pour l’élite bolivienne blanche traditionnelle et ses patrons impériaux. « Une révolution démocratique, basée sur les votes du peuple, qui a élevé la conscience du peuple, et a même atteint le gouvernement. »
Il ajoute : « Encore aujourd’hui, il y a des gens qui pensent « Nous devons dominer les Indiens, commander les Indiens ». Dans l’intérieur de la Bolivie, c’est la mentalité – « Ce sont des esclaves, ce sont des animaux, nous devons les éradiquer ». C’est notre combat pour vaincre cette mentalité. »
Sur le chemin du retour à Cochambamba, une ville indigène animée qui est la quatrième plus grande ville de Bolivie, je me rappelle que c’est ici que cette lutte épique a commencé.
Au début de l’année 2000, les « guerres de l’eau » de Cochabamba ont fait rage après la privatisation de la compagnie des eaux locale et l’augmentation drastique des prix par la société américaine Bechtel, qui a même interdit la collecte de l’eau de pluie. Des dizaines de milliers de manifestants ont affronté la police dans les rues de la ville pendant des mois.
« Arriver avec le pouvoir politique nous a permis de fermer la base militaire américaine, nous avons expulsé la CIA. »
Les producteurs de coca de Bolivie, menés par un député peu connu appelé Evo Morales, se sont joints aux manifestants et ont exigé la fin du programme d’éradication de leurs cultures parrainé par les États-Unis.
Après des mois de protestation et d’activisme, en avril 2000, le gouvernement bolivien a accepté d’annuler la privatisation. Une révolution avait commencé. Le peuple a pris le pouvoir cinq ans plus tard, renversant 500 ans de domination coloniale en Bolivie.
Cependant, en 2022, le danger guette toujours. Les États-Unis et la Grande-Bretagne continuent de travailler pour mettre la Bolivie au pas, aux côtés de leurs compradores locaux. Mais, dans ce pays à majorité indigène, ils semblent avoir trouvé leur maître.
Morales me dit que la construction du pouvoir syndical était la base de la révolution démocratique, mais que le plus important était d’entrer au gouvernement.
« Arriver avec le pouvoir politique nous a permis de fermer la base militaire américaine, nous avons expulsé la DEA, nous avons expulsé la CIA. D’ailleurs, l’ambassadeur américain qui conspirait, qui finançait la [tentative] de coup d’État de 2008, nous l’avons expulsé aussi. »
Il fait une pause. « Nous ne faisons pas que parler d’anti-impérialisme, nous mettons l’anti-impérialisme en pratique. »
Au sujet de l’auteur :
Matt Kennard est enquêteur en chef à Declassified UK. Il a été membre puis directeur du Centre for Investigative Journalism à Londres. Suivez-le sur Twitter @kennardmatt
Source : Declassified UK, Matt Kennard, 14-07-2022 Traduit par les lecteurs du site Les-Crises