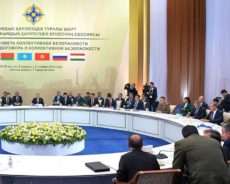![]() Le rapport du groupe d’experts intergouvernemental des Nations unies sur l’évolution du climat démontre en quoi le capitalisme est responsable de la crise climatique.
Le rapport du groupe d’experts intergouvernemental des Nations unies sur l’évolution du climat démontre en quoi le capitalisme est responsable de la crise climatique.
Le groupe d’experts intergouvernemental des Nations unies sur l’évolution du climat (GIEC) a publié un nouveau rapport sur le climat, ce dernier met à jour et synthétise les conclusions de tous les rapports antérieurs et de la sixième évaluation du GIEC. Il appelle à une action immédiate pour freiner le réchauffement climatique et garantir un avenir vivable pour tous. Dans cet entretien exclusif pour Truthout, Noam Chomsky et Robert Pollin apportent un éclairage remarquable sur les implications du nouveau rapport du GIEC et sur les mesures à prendre, tant sur le plan politique que financier, qui découlent de ses conclusions.
Noam Chomsky est professeur émérite dans le département de linguistique et de philosophie du MIT, professeur lauréat de linguistique [Le titre de professeur lauréat est décerné aux universitaires les plus éminents en reconnaissance de leurs réalisations et de leur contribution exceptionnelle à leur domaine d’études et à leur université, NdT] et titulaire de la chaire Agnese Nelms Haury du programme sur l’environnement et la justice sociale de l’université d’Arizona. Il est l’un des chercheurs les plus fréquemment cités dans le monde et un intellectuel reconnu considéré par des millions de personnes comme un trésor national et international, Chomsky a publié plus de 150 ouvrages sur la linguistique, la pensée politique et sociale, l’économie politique, l’étude des médias, la politique étrangère des États-Unis et les affaires mondiales. Robert Pollin est professeur d’économie et codirecteur de l’Institut de recherche en économie politique (PERI) à l’université du Massachusetts-Amherst. Il est l’un des plus grands économistes progressistes au monde et a publié de nombreux ouvrages et articles universitaires sur l’emploi et la macroéconomie, les marchés du travail, les salaires et la pauvreté, ainsi que sur l’économie de l’environnement et de l’énergie. Il a été sélectionné par le magazine Foreign Policy comme l’un des « 100 principaux intellectuels mondiaux de 2013 ». Chomsky et Pollin sont co-auteurs de Climate Crisis and the Global Green New Deal : The Political Economy of Saving the Planet (2020).
C.J. Polychroniou : Le GIEC vient de publier un rapport de synthèse qui s’appuie sur le contenu de son sixième rapport d’évaluation, c’est-à-dire les contributions des trois groupes de travail et des trois rapports spéciaux. En somme, nous avons un rapport de synthèse des évaluations scientifiques sur le changement climatique publiées depuis 2018, sauf que le nouveau rapport dresse un tableau encore plus inquiétant : nous sommes plus proches que jamais d’atteindre ou de dépasser une hausse de température de 1,5 degré Celsius et « l’augmentation continue des émissions affectera davantage toutes les principales composantes du système climatique ». S’appuyant sur les conclusions de centaines de scientifiques qui ont contribué au sixième rapport d’évaluation du GIEC, le rapport de synthèse indique « qu’à court terme, toutes les régions du monde devraient être confrontées à une nouvelle augmentation des risques climatiques (prévision avec un niveau de confiance allant de moyen à élevé, selon la région et le risque), ce qui multipliera les risques pour les écosystèmes et les êtres humains (avec un niveau de confiance très élevé) ». Aussi, les auteurs du rapport de synthèse affirment-ils que la limitation du réchauffement climatique exige des émissions de dioxyde de carbone « zéro émissions nettes » et que la fenêtre d’opportunité « pour assurer un avenir vivable et durable pour tous » se « referme rapidement », et ils appellent à prendre d’urgence des mesures climatiques sur tous les fronts. Les auteurs du rapport de synthèse affirment en effet qu’il existe des perspectives exceptionnelles pour « intensifier l’action climatique » et que seul le manque de volonté politique nous empêche d’avancer.
Noam, que pensez-vous du nouveau rapport du GIEC ? Je suppose que ses conclusions et ses recommandations en matière de mesures politiques ne vous ont pas surpris.
Noam Chomsky : Les rapports du GIEC sont des documents de consensus. Et donc, ils ont tendance à plutôt sous-estimer les faits. Celui-ci me semble différent. Il semble que le désespoir de la communauté scientifique ait atteint un tel niveau qu’ils ne prennent plus de gants et qu’ils estiment que le moment est venu de faire preuve de franchise. Le temps presse. Il est urgent de prendre des mesures énergiques. Il existe des solutions. Si elles ne sont pas mises en œuvre, avec détermination, nous pourrions tout aussi bien dire : « C’est vraiment dommage pour vous, mais nous avons été ravis de vous connaître. »
Le rapport souligne l’absence de « volonté politique ». Ce qui est tout à fait exact. Si notre survie nous importe au point de nous décider à agir de manière résolue, nous devrions nous intéresser de près à ce concept et à ce qu’il signifie pour les sociétés existantes ou, mieux, pour les sociétés que nous avons quelque espoir de voir naître dans le délai imparti pour prendre les mesures qui s’imposent. En bref, nous devons avoir une compréhension claire des structures institutionnelles au sein desquelles la volonté politique peut avoir des effets concrets.
Où la volonté politique s’exerce-t-elle ? Dans la rue, pour reprendre la métaphore familière, c’est-à-dire au sein d’une population informée, militante et organisée. Dans la mesure où cette forme de volonté politique s’exerce, elle peut – dans le cas présent, elle doit – parvenir jusqu’aux centres de pouvoir, privés et étatiques, qui sont étroitement liés, pour ensuite les influencer.
Disons-le tout net. Le Congrès vient d’adopter une « législation historique » sur le climat, l’Inflation Reduction Act (IRA) de 2022. Elle est présentée comme la législation la plus importante en matière d’énergie propre et de climat dans l’histoire de la nation, « une nouvelle aube pour l’action climatique aux États-Unis. »
C’est exact. Mais cela révèle aussi le triste bilan de l’histoire et des promesses en matière « d’action climatique. »
Bien qu’elle ne soit pas dépourvue de mesures positives, cette loi n’est que le pâle reflet de la législation proposée par l’administration Biden sous l’impulsion d’un militantisme populaire soutenu, principalement relayé par les équipes de Bernie Sanders. Dans le même ordre d’idées, des initiatives de même nature sont parvenues jusqu’au Congrès sous la forme de la résolution Green New Deal, réintroduite en 2021 par Alexandria Ocasio-Cortez et Ed Markey.
Si elle avait été adoptée telle quelle, la proposition Biden aurait en effet constitué une « loi historique ». Pour insuffisante qu’elle soit au regard de l’urgence à laquelle nous sommes confrontés, elle aurait constitué un grand pas en avant. Elle a été progressivement affaiblie par l’opposition de 100 % des Républicains à tout ce qui pourrait s’attaquer à la crise la plus grave de l’histoire de l’humanité – et empiéter sur leur passion dévorante pour les fortunes extrêmes et le pouvoir des entreprises. Rejoint par quelques Démocrates de l’aile droite du parti, le radicalisme du GOP [Grand Old Party, soit les Républicains, NdT] a réussi à vider la proposition initiale de la majeure partie de sa substance.
Pour bien comprendre nos institutions politiques, il est important de rappeler que le profond attachement du Parti républicain à la destruction de l’environnement n’est pas un simple sadisme sociopathe. En 2008, le candidat républicain à la présidence, John McCain a, dans son programme, proposé une modeste initiative climatique limitée, et les Républicains du Congrès envisageaient également quelques mesures.
Pendant des années, l’énorme conglomérat énergétique des frères Koch a travaillé avec acharnement pour s’assurer que le GOP ne s’écarte pas de son négationnisme climatique. Lorsqu’ils ont réalisé qu’une telle déviance était en cours, ils ont lancé une offensive pour rétablir l’orthodoxie : corruption, intimidation, lobbying, astroturfing [L’astroturfing est une technique consistant en la simulation d’un mouvement spontané ou populaire à des fins d’ordre politique ou économique pour influencer l’opinion publique, NdT]. Ils ont utilisé tous les moyens à la disposition d’un pouvoir économique concentré dans les mains de gens qui n’ont pas de comptes à rendre. Cela a très bien marché, avec célérité et efficacité. Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, il est difficile de repérer un quelconque manquement de la part du GOP à l’obligation de répondre aux exigences du pouvoir central, à savoir que nous sommes tenus de foncer vers la destruction (et l’enrichissement, pendant les quelques années à venir où cela aura de l’importance).
Il s’agit peut-être là d’un cas extrême, mais il n’est pas si loin de la norme dans le cadre du capitalisme d’État dominant. C’est particulièrement vrai à l’ère du capitalisme sauvage appelé néolibéralisme, qui est fondamentalement une forme de guerre de classe féroce camouflée sous la terminologie grossièrement trompeuse de « marchés libres », comme le montre très clairement la réalité.
Pour en revenir à l’IRA, l’une de ses principales dispositions est un ensemble de mécanismes visant à inciter l’industrie des combustibles fossiles et les institutions financières qui la soutiennent à agir plus gentiment. Ces dispositifs sont principalement des pots-de-vin et des subventions, y compris la mise à disposition de terres fédérales pour l’exploitation pétrolière pendant des décennies, bien après que nous ayons franchi les points de basculement vers une destruction irréversible du climat.
Le choix de la stratégie est logique compte tenu des structures institutionnelles existantes. Dans la culture de l’élite, il est parfaitement acquis que toutes les exigences doivent être subordonnées au bien-être des maîtres de l’économie privée. C’est Moïse et les prophètes, pour paraphraser Marx. Si les maîtres ne sont pas satisfaits, nous sommes perdus.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’ensemble de la société s’est mobilisée dans le cadre de l’effort de guerre. Mais comme l’a fait remarquer le secrétaire d’État à la Guerre Henry L. Stimson : « Dans un pays capitaliste, pour essayer de faire la guerre ou de s’y préparer, il faut laisser les entreprises gagner de l’argent dans cette opération, sinon elles ne joueront pas le jeu. » Les chefs d’entreprise étaient appelés à « diriger les agences qui coordonnaient la production, [mais] ils restaient salariés de leur entreprise, toujours très au fait des intérêts des sociétés qu’ils dirigeaient. » Pour inciter les entreprises à adhérer à ce système, on a souvent eu recours au schéma « frais généraux plus honoraires fixes » par lequel le gouvernement garantissait tous les coûts de développement et de production, et versait de surcroît un pourcentage des bénéfices sur les biens produits.
Commençons par le début. Oui, il est important de gagner la guerre mais il est plus important encore de « faire en sorte que les entreprises gagnent de l’argent au passage. » Telle est la véritable règle d’or à respecter, non seulement pendant la guerre la plus destructrice de l’histoire, mais aussi dans le cadre de la guerre bien plus vaste dans laquelle la société humaine est aujourd’hui plongée : la guerre pour la préservation de toute vie humaine organisée sur la Terre.
Nos structures institutionnelles, dans leur principe le plus élevé, révèlent aussi leur folie intrinsèque. C’est comme si le gouvernement mexicain appelait les cartels de la drogue à réduire leurs massacres en leur offrant des pots-de-vin et en les rétribuant.
Il n’est guère surprenant que les compagnies pétrolières nous aient poliment informés de la hausse des prix du pétrole après l’invasion de l’Ukraine par Poutine : Désolé les gars, pas de chance. Leurs profits colossaux pouvaient être encore augmentés en réduisant leur très modeste effort en faveur des énergies durables et en se lançant à la course aux gros sous, quelles qu’en soient les conséquences pour la vie sur Terre.
Tout ceci n’est que trop familier. Il suffit de citer la conférence des Nations unies sur le climat COP26 de Glasgow, en octobre 2021. Le délégué américain John Kerry était aux anges : le marché était désormais dans notre camp. Comment pourrions-nous perdre ? BlackRock et d’autres gestionnaires d’actifs se sont engagés à verser des dizaines de milliers de milliards de dollars en faveur du développement durable – à deux petites conditions : leurs généreux investissements devaient être rentables et ils devaient s’accompagner de garanties fermes quant à l’absence de risques. Tout cela grâce à l’aimable contribuable, qui est régulièrement appelé à voler au secours de notre économie néolibérale de renflouement, pour reprendre l’expression des économistes Robert Pollin et Gerald Epstein.
J’ai parfois cité l’observation d’Adam Smith selon laquelle, à toutes les époques, les « maîtres de l’humanité » – ceux qui détiennent le pouvoir économique – adhèrent à leur « vile maxime » : « Tout pour nous, rien pour les autres. »
Dans le contexte actuel, l’expression est un peu trompeuse. Les dirigeants dotés du pouvoir suprême peuvent se permettre un certain degré de bienveillance à l’égard de leurs sujets, même au prix de leur immense richesse. Les systèmes capitalistes ne permettent pas qu’on s’éloigne de cette façon de la vile maxime. Les règles de base sont : recherche du profit et des parts de marché, ou mise hors jeu. Ce n’est que dans la mesure où une population mobilisée et organisée oblige à contourner les règles que l’on peut s’attendre à s’écarter de l’ignoble maxime.
Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur perplexité quant au fait que les PDG des entreprises de combustibles fossiles et les banques qui leur prêtent de l’argent puissent sciemment sacrifier leurs petits-enfants pour amasser encore plus de richesses que celles qui dépassent déjà les rêves les plus fous de la cupidité. Ils peuvent se montrer très convaincants : Oui, c’est bien ce que je fais, mais si je m’écarte de ce chemin, un autre, qui s’y tiendra viendra me remplacer, et celui-là n’aura pas nécessairement ma bonne volonté, alors que celle-ci pourrait être à même d’atténuer quelque peu la tragédie.
Une fois de plus, c’est la folie des institutions qui prévaut.
Nous pouvons y ajouter les paroles de sagesse d’Adam Smith, qui y sont étroitement liées : grâce à leur contrôle de l’économie, les maîtres de l’humanité deviennent les « principaux architectes » de la politique de l’État et ils veillent bien à ce que leurs propres intérêts soient « tout particulièrement pris en compte », quelles qu’en soient les conséquences « désastreuses » pour tous les autres. Le constat n’est pas vraiment nouveau.
Ce même pouvoir, qui n’a pas à rendre de comptes, a un impact considérable sur les doctrines dominantes, ce que Gramsci appelait le « sens commun hégémonique ». Les sondages montrent que les électeurs qui s’identifient comme Républicains se soucient peu du « changement climatique » – pour reprendre l’euphémisme conventionnel utilisé pour dire que la planète brûle. Il n’y a rien là de très surprenant. Ce qu’ils entendent de la part de leurs dirigeants et des chambres d’écho comme Fox News, c’est que si toutefois le changement climatique existe, cela n’a guère d’importance. Ce n’est qu’une autre invention des « élites libérales » pour leurs campagnes insidieuses, tout comme le « tripotage » des enfants par les « pédophiles sadiques » qui dirigent le Parti démocrate (ce dont près de la moitié des électeurs du GOP sont convaincus), la promotion du « Grand Remplacement » pour éliminer la race blanche opprimée, et tout ce qui peut être imaginé dans un second temps pour garder la populace dans le droit chemin pendant que les programmes législatifs les poignardent dans le dos.
Je ne veux pas ici laisser penser que le GOP est le seul à être infâme. Loin de là. Ils ont simplement poussé la lutte des classes jusqu’à des extrêmes qui seraient comiques si l’impact n’en était pas aussi sinistre.
J’ai fait mention d’une des dimensions de l’IRA : les cadeaux et les subventions accordés aux responsables des destructions climatiques pour les inciter à agir plus gentiment. Il y a une deuxième dimension : la politique industrielle, une mesure qui s’écarte radicalement de la doctrine néolibérale déclarée. Dans le cas dont nous parlons, il s’agit de subventions conséquentes accordées au secteur privé dans le but de relancer l’industrie nationale des semi-conducteurs. Cela soulève d’autres questions : faut-il que les bénéfices issus des largesses publiques aillent dans les poches des riches actionnaires et dans celles des stock-options de la classe dirigeante super-riche ? Ou bien le produit social doit-il être redistribué différemment, en y associant les oubliés de la société ? Autant de questions qu’il ne faut pas négliger.
Il ne faut pas non plus perdre de vue le contexte plus large dans lequel s’inscrit l’effort de reconstruction d’une partie de l’économie industrielle qui a été délocalisée à l’étranger par les maîtres de l’économie pour assurer leur propre prospérité. Cet effort s’inscrit dans le cadre plus large de la guerre commerciale contre la Chine, dont le but est d’empêcher le développement économique de ce pays. L’une des priorités de cette guerre est de contraindre les industries de pointe européenne, coréenne et japonaise à renoncer à leur principal marché et à leur source de matières premières, à savoir la Chine, afin de contribuer à la campagne de Washington pour le maintien de son hégémonie mondiale. Nous ne savons pas comment tout cela va finir. Mais la question mérite qu’on s’y attarde et qu’on y réfléchisse.
Il s’agit là d’une vue d’ensemble qui ne tient pas compte d’un grand nombre d’éléments importants. Néanmoins, je pense que le tableau général constitue un cadre utile pour réfléchir aux tâches qui nous attendent. On peut en conclure sans risque de se tromper qu’on ne peut pas espérer grand chose de la structure institutionnelle du capitalisme sauvage. Est-il possible de la modifier suffisamment dans un délai réaliste, en réduisant ou en éliminant la dimension brutale de l’amalgame ? Penser que la nature brutale du capitalisme peut être inversée en revenant à quelque chose comme le capitalisme des années Eisenhower, qui, avec tous ses graves défauts, est considéré à juste titre comme « l’âge d’or » du capitalisme d’État, n’est en rien utopique. Il est certainement possible de dompter les pires excès de la guerre des classes de ces dernières décennies.
La « volonté politique » de la rue suffira-t-elle à empêcher le pire, à ouvrir la voie vers un avenir meilleur qu’il est réaliste d’envisager ? Il n’y a qu’une seule façon de le savoir : s’atteler à la tâche.
Bob, que pensez-vous du nouveau rapport du GIEC ? Est-il possible de parvenir à un taux de dioxyde de carbone « zéro émission nette » dans tous les secteurs avant le milieu du siècle ? Si oui, par où commencer et comment ? Mais avant de répondre à cette partie de la question, le « zéro net » signifie-t-il zéro émission ? Pour en être sûr, pouvez-vous me préciser si il existe une chose telle que le « zéro net » ou le « zéro carbone» ?
Robert Pollin : En 2022, les émissions mondiales totales de dioxyde de carbone (CO2) ont atteint 40,5 milliards de tonnes. Sur ce total, 36,6 milliards de tonnes, soit 90 % de l’ensemble des émissions de CO2 en 2022, ont été produites par la combustion de pétrole, de charbon et de gaz naturel pour produire de l’énergie. Les 3,9 milliards de tonnes restantes, soit 10 % du total, ont été générées par des changements dans l’utilisation des terres, principalement la déforestation pour défricher des terres destinées à l’agriculture industrielle et à l’exploitation minière. Le total des émissions mondiales en 2022 était légèrement inférieur au pic de 2019, c’est-à-dire l’année qui a précédé les confinements de la Covid. Les émissions mondiales ont certes baissé en 2020 en raison de ces confinements, mais seulement d’environ 6 %, et ont ensuite recommencé à augmenter en 2021, lorsque l’économie mondiale a repris. Depuis son rapport historique de 2018, le GIEC insiste de plus en plus sur le fait que, pour avoir ne serait-ce qu’une chance raisonnable de stabiliser l’augmentation de la température moyenne de la planète à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, les émissions mondiales de CO2 doivent être réduites de moitié environ, pour arriver à 20 milliards de tonnes, à partir de 2030, puis atteindre le « zéro émission nette » d’ici à 2050.
Vous avez tout à fait raison de demander ce que signifie exactement le terme « net zéro ». En fait, à lui seul, le petit mot « nette » dans l’expression « zéro émission nette » ouvre la porte à d’énormes possibilités de tromperie et de dissimulation pure et simple concernant les solutions en matière de climat. Les producteurs de combustibles fossiles et tous ceux qui tirent aujourd’hui des bénéfices de la vente de combustibles fossiles sont déterminés à exploiter au maximum ces possibilités en matière de brouillage du message.
Ce petit mot « nette » dans l’expression « zéro émission nette » ouvre la porte à d’énormes possibilités de tromperie et de dissimulation pure et simple concernant les solutions en matière de climat.
Le fait est que le terme « zéro net » permet d’envisager des scénarios dans lesquels les émissions de CO2 restent à un niveau positif significatif d’ici 2050, c’est-à-dire que nous continuons à brûler du pétrole, du charbon et du gaz naturel pour produire de l’énergie et à raser des zones forestières, à commencer par la forêt tropicale amazonienne. La manière dont nous serions censés atteindre un niveau d’émissions nettes nulles dans le cadre de ces scénarios consisterait à récupérer les émissions actuelles dans l’atmosphère par le biais de diverses mesures relevant des technologies de « captage du carbone. »
Parlons un peu de ces technologie de piégeage de carbone. À ce jour, il n’existe qu’une seule et unique technique de ce type dont l’efficacité et la sécurité ont été prouvées. Il s’agit de planter des arbres. Plus précisément, je fais référence à un boisement réel, c’est-à-dire à l’augmentation de la couverture ou de la densité forestière dans des zones auparavant non boisées ou déboisées. Le reboisement, terme plus couramment utilisé, est une composante du boisement. C’est une technique qui fonctionne pour la simple raison que les arbres vivants absorbent le CO2. C’est également la raison pour laquelle la déforestation libère du CO2 dans l’atmosphère, contribuant ainsi au réchauffement de la planète.
La grande question qui se pose à propos du boisement est de savoir, de manière réaliste, quelle peut être l’ampleur de son impact en tant que moyen de contrecarrer les émissions de CO2 dues à la combustion de combustibles fossiles. Une étude très rigoureuse menée par Mark Lawrence et ses collègues de l’Institut de recherche sur le développement durable de Potsdam, en Allemagne, est arrivée à la conclusion que le boisement pourrait, de manière réaliste, réduire les niveaux de CO2 de 0,5 à 3,5 milliards de tonnes par an jusqu’en 2050. Comme indiqué plus haut, les niveaux actuels de CO2 dans le monde s’élèvent à environ 40 milliards de tonnes. Si l’estimation de Lawrence et de ses co-auteurs se révèle, ne serait-ce que partiellement exacte, il s’ensuit que le boisement peut certainement servir de stratégie d’intervention complémentaire dans le cadre d’un programme climatique plus large. Mais le boisement ne peut pas porter à lui seul le poids de l’élimination du CO2 dans l’atmosphère si nous continuons de brûler des combustibles fossiles de façon aussi importante.
Au-delà du boisement, il existe une série de mesures de haute technologie qui, selon les partisans de l’industrie des combustibles fossiles, seront à même de capturer le CO2 et de le stocker dans des réservoirs souterrains pour toujours ou de le recycler et de le réutiliser comme source de combustible. Cependant, aucune de ces technologies n’est à la veille de pouvoir fonctionner à l’échelle commerciale, en dépit du fait que, depuis des décennies, les entreprises de combustibles fossiles ont bénéficié d’incitations colossales pour les faire fonctionner.
En fait, lors de la rédaction finale du dernier rapport du GIEC, les pays producteurs de combustibles fossiles ont exercé de fortes pressions pour que les technologies de capture du carbone soient considérées comme une solution majeure au problème du climat. Par ailleurs, la prochaine conférence mondiale sur le climat, la COP28, se tiendra en novembre et décembre 2023 aux Émirats arabes unis (EAU). Le président désigné de la COP28, Sultan al-Jaber, qui est également à la tête de la compagnie pétrolière publique des Émirats arabes unis Adnoc, a, selon le Financial Times, « depuis toujours insisté sur la nécessité de réduire les émissions plutôt que de réduire la production de combustibles fossiles ». En d’autres termes, selon al-Jaber, Adnoc et les autres compagnies pétrolières devraient être autorisées à continuer à nager dans les profits pétroliers pendant que nous jouons le sort de la planète sur des technologies qui ne fonctionnent pas aujourd’hui et qui ne fonctionneront peut-être jamais. Le dernier rapport du GIEC en date indique que les taux mondiaux de captage du carbone sont « bien en deçà » de ce qui est nécessaire à tout projet viable de stabilisation du climat. Le GIEC a souligné que la mise en œuvre du piégeage et du stockage du carbone « se heurte à des obstacles technologiques, économiques, institutionnels, écologiques, environnementaux et socioculturels. »
Revenons maintenant à la première partie de votre question : est-il possible de parvenir à des émissions nettes nulles d’ici 2050 si l’on admet que le boisement peut, au maximum, extraire 5 à 10 % du niveau actuel des émissions dues à la combustion de combustibles fossiles ? En d’autres termes, peut-on réellement supprimer toute consommation de combustibles fossiles dans l’ensemble de l’économie mondiale d’ici à 2050 ? La réponse courte est Oui. Je dis cela tout en reconnaissant qu’à l’heure actuelle, environ 85 % de l’approvisionnement énergétique mondial vient de la combustion de pétrole, de charbon et de gaz naturel. Nous devons également admettre que les gens auront toujours besoin d’énergie pour éclairer, chauffer et refroidir les bâtiments, pour alimenter les voitures, les bus, les trains et les avions, et pour faire fonctionner les ordinateurs et les équipements industriels, entre autres.
Néanmoins, en tant que défi strictement statistique, économique et politique – c’est-à-dire indépendamment de tous les efforts déployés pour défendre les profits des combustibles fossiles à tout prix – il est tout à fait réaliste de penser que les émissions mondiales de CO2 peuvent être ramenées à zéro net d’ici à 2050. Selon mon estimation la plus élevée, il faudra un niveau moyen de dépenses d’investissement dans l’ensemble de l’économie mondiale d’environ 2,5 % du PIB mondial par an pour construire une infrastructure mondiale d’énergie propre afin de supplanter notre infrastructure actuelle dominée par les combustibles fossiles. Cela représente à l’heure actuelle, à l’échelle de l’économie mondiale, environ 2 000 milliards de dollars, et une moyenne d’environ 4 500 milliards de dollars par an d’ici à 2050. C’est évidemment beaucoup d’argent. Mais, en pourcentage du PIB annuel, cela représente environ un dixième de ce que les États-Unis et d’autres pays à revenu élevé ont dépensé pour éviter un effondrement économique pendant les périodes de confinement de la Covid. Ces investissements devraient se concentrer sur deux domaines : 1) le renforcement radical des exigences en matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments, les automobiles, les systèmes de transport public et les processus de production industrielle et 2) le développement tout aussi radical des sources d’énergie renouvelable propre – principalement l’énergie solaire et éolienne – disponibles dans tous les secteurs et dans toutes les régions du globe, à des prix compétitifs par rapport aux combustibles fossiles.
Ces investissements sont les pierres angulaires du New Deal vert mondial. En tant que tels, ils constitueront également une nouvelle source majeure de création d’emplois dans toutes les régions du monde. En effet, la construction d’une nouvelle infrastructure énergétique mondiale exige que les gens se mettent au travail – quel que soit le type d’emploi, y compris les couvreurs, les plombiers, les chauffeurs de camion, les machinistes, les comptables, les chefs de bureau, les ingénieurs ferroviaires, les chercheurs et les juristes. En fait, la mise en place d’une infrastructure mondiale d’énergie propre nécessite deux à trois fois plus de personnes pour effectuer ces travaux que pour maintenir notre infrastructure énergétique actuelle, qui est essentiellement constituée de combustibles fossiles.
La transition vers une énergie propre à l’échelle mondiale permettra également de fournir une énergie meilleur marché. L’administration américaine de l’information sur l’énergie estime en effet que, d’ici à 2027, la production d’un kilowattheure d’électricité à partir de l’énergie solaire ou éolienne ne coûtera que la moitié de ce qu’elle coûte par rapport à l’électricité produite à partir du charbon ou du nucléaire. Le relèvement des normes d’efficacité parallèlement aux investissements dans les énergies propres signifie également que pour faire fonctionner nos divers types de machines, il nous faudra acheter moins d’énergie, quelle qu’elle soit – par exemple, moins de kilowattheures pour chauffer, refroidir et éclairer les bâtiments, ou pour nous transporter d’un endroit à l’autre. Des infrastructures à faible coût et à petite échelle en matière d’énergie propre peuvent également être mises en place dans les quelque 30 % de zones rurales des pays en développement qui, à ce jour, n’ont toujours pas accès à l’électricité.
Comme nous l’avons évoqué récemment, on a pu observer des évolutions positives majeures au cours de l’année écoulée, les investissements dans les énergies propres ayant connu une croissance rapide tant aux États-Unis qu’en Europe occidentale. Pourtant, dans le même temps, les bénéfices des grandes compagnies pétrolières ont atteint un niveau record de 200 milliards de dollars en 2022. De plus, les responsables politiques continuent de faire des courbettes devant les compagnies pétrolières. La décision du président Biden d’approuver l’énorme projet de forage pétrolier Willow sur des terres fédérales en Alaska en est l’exemple le plus récent. Et ce, alors même que Biden avait fait campagne en 2020 en promettant de « ne plus effectuer de forages sur les terres fédérales, un point c’est tout. »
En bref, une véritable zéro émission nette – le terme « nette » faisant uniquement référence à l’absorption du CO2 par le boisement à un niveau de 5 à 10 % des émissions actuelles – est tout à fait réalisable sur le plan technique et économique. Cependant, le combat politique pour y parvenir sera toujours aussi acharné. Nonobstant les discours, les entreprises de combustibles fossiles – les entreprises publiques comme Adnoc aux Émirats arabes unis et les entreprises privées comme ExxonMobil – n’ont aucunement l’intention de renoncer à leurs profits au nom de la sauvegarde de la planète.
Noam, ce que Bob vient de dire sur la transition vers une économie verte me semble très logique, mais comme le dit clairement le nouveau rapport du GIEC, une telle action implique non seulement l’accès à des sources majeures de financement et de technologie, mais aussi une coordination à tous les niveaux de gouvernance, un consensus entre des intérêts divers et, bien sûr, une coopération internationale. De toute évidence, l’humanité se retrouve face à une tâche herculéenne. Et je suppose que nombreux sont ceux qui diront qu’il n’est pas réaliste d’attendre autant de la nature humaine et des institutions politiques actuelles. Que répondriez-vous à ces considérations certes pessimistes, mais pas forcément dénuées de bon sens, compte tenu de l’histoire politique du monde ?
Noam Chomsky : La phrase clef est « la nature humaine et les institutions politiques actuelles ». En ce qui concerne ce dernier point, il est difficile de nourrir beaucoup d’espoir au regard des institutions politiques actuelles : le capitalisme débridé issu de l’âpre guerre de classe appelée à tort « néolibéralisme ». Il ne sert à rien de revenir sur ses effets délétères. Comme d’habitude, ce sont les plus vulnérables des sociétés riches, et en particulier des pays du Sud, qui ont subi la punition la plus brutale. Une grande partie de ces pays a été soumise à de sévères programmes d’ajustement structurel dont les conséquences sont multiples, allant des « décennies perdues » en Amérique latine jusqu’aux profonds bouleversements de l’ordre social en Yougoslavie et au Rwanda, en grande partie à l’origine des horreurs qui s’en sont suivies.
Nombreux sont ceux qui défendent et même font l’éloge de l’ère « néolibérale ». Bien sûr, nous nous attendons à ce qu’ils fassent partie des bénéficiaires du braquage de haute volée qui a vu environ 50 000 milliards de dollars être volés à la classe ouvrière et à la classe moyenne aux États-Unis pour être transférés au 1 % le plus riche, selon l’étude de la Rand Corporation dont nous avons parlé. Mais ces défenseurs sont aussi des analystes sérieux, qui saluent à juste titre le fait que des centaines de milliards de personnes sont sorties de la pauvreté – essentiellement en Chine, qui n’est pas exactement ce modèle de « capitalisme de libre marché » salué par les fervents adeptes du néolibéralisme.
On néglige également le fait que les méthodes adoptées pour parvenir à ce résultat positif, tout comme les dommages considérables qu’il a engendrés, n’ont pas été dictés par des « règles économiques saines. » Ce qui a joué un rôle moteur, c’est encore une fois l’infâme maxime. Le meilleur moyen pour y parvenir a été de mettre les travailleurs en concurrence les uns avec les autres tout en offrant d’énormes cadeaux au capital. Parmi ceux-ci, on compte les accords très protectionnistes sur les droits des investisseurs des années Clinton, absurdement appelés « accords de libre-échange. » Le mouvement ouvrier et le bureau de recherche du Congrès, l’Office of Technology Assessment (rapidement démantelé), ont proposé des solutions alternatives précises. Ces programmes visaient à créer une économie internationale à forte croissance et à salaires élevés, dont les travailleurs de tous les pays auraient tiré bénéfice. En ces temps d’âpre guerre des classes, on ne les a même pas envisagés.
Nous pouvons raisonnablement en conclure que le capitalisme sauvage n’offre que peu d’espoir de survie.
Le meilleur espoir, comme mentionné plus haut, est d’en désamorcer le côté sauvage et brutal tout en reconnaissant que la destruction de l’ordre capitaliste hostile à notre humanité est un projet de longue haleine et perpétuel. Ce projet n’entre pas en conflit avec la tâche urgente consistant à en atténuer la violence. Au contraire, les deux efforts doivent se renforcer mutuellement.
Que pouvons-nous donc dire sur le rôle que joue ici la nature humaine ? Dans certains domaines, relativement parlant, beaucoup. On a beaucoup appris sur la nature cognitive fondamentale de l’homme, mais ces découvertes fournissent tout au plus quelques pistes intéressantes dans les domaines auxquels il est ici fait référence, et pour lesquels il est difficile de se prononcer avec certitude.
Si nous nous penchons sur l’histoire, nous constatons de grandes différences quant à ce qui relève de la nature humaine. Des comportements considérés comme normaux dans le passé suscitent l’horreur aujourd’hui. Cela vaut également pour le passé récent. L’Allemagne illustre de manière spectaculaire l’éventail des possibles en accord avec la nature humaine fondamentale. Dans les années 1920, elle représentait l’apogée de la civilisation occidentale dans le domaine des arts et des sciences, et était également considérée comme un modèle de démocratie. Dix ans plus tard, elle a sombré dans les abîmes de la perversité. Une décennie plus tard, elle reprenait son cours antérieur. Le même peuple, les mêmes gènes, la même nature humaine fondamentale, qui se sont exprimés différemment en fonction des circonstances.
Les exemples sont innombrables. Dans le cadre de notre discussion actuelle, l’un d’entre eux a trait à l’attitude vis-à-vis de l’emploi. Après quatre décennies marquées par la vague des attaques néolibérales, les citoyens aspirent à trouver un emploi relativement sûr au lieu d’être livrés à la précarité créée par le capitalisme sauvage contemporain. Un siècle plus tôt, au lendemain de la Première Guerre mondiale, des efforts considérables ont été déployés dans les sociétés industrielles occidentales pour créer un ordre social très différent qui verrait les travailleurs être libérés des entraves de l’autocratie capitaliste : le socialisme des guildes en Angleterre, les entreprises gérées par les travailleurs en Italie, et bien d’autres initiatives. Elles constituaient une menace sérieuse pour l’ordre capitaliste. Ces initiatives ont été écrasées de diverses manières. Aux États-Unis, la violence extrême exercée par la « peur rouge » instaurée par Wilson a écrasé un mouvement ouvrier très vivace en même temps que les politiques sociales-démocrates, qui ont certes connu une certaine résurgence lors des années du New Deal, mais qui ont été constamment la cible de violentes attaques.
Auparavant, les travailleurs considéraient le fait d’avoir un emploi – c’est-à-dire d’être subordonné à un maître pendant la majeure partie de leur vie active – comme une atteinte intolérable aux droits humains et à la dignité, une forme de quasi-esclavage. On parlait alors « d’esclavage salarié ». Le slogan de la première grande organisation syndicale américaine, les Chevaliers du Travail, était que « ceux qui travaillent dans les usines devraient en être les propriétaires ». Les travailleurs n’avaient pas à être soumis aux ordres des maîtres de l’humanité. À la même époque, des agriculteurs radicaux s’organisaient pour se libérer de l’emprise des banques et des opérateurs de marché du nord-est, cherchant à créer un « commonwealth coopératif ». Tels étaient les authentiques populistes.
Dans le monde, les subventions attribuées aux combustibles fossiles ont doublé en 2022 pour atteindre 1 100 milliards de dollars. La réaffectation de ces fonds au soutien des énergies propres pourrait fournir près de la moitié des fonds nécessaires, et ce, dans le cadre de l’économie mondiale actuelle.
Des mesures encourageantes ont été prises pour rapprocher les classes populaires agricoles des classes ouvrières. Comme tout au long de l’histoire américaine, ces efforts ont été écrasés par le pouvoir de l’État et le pouvoir privé. Au sein des sociétés industrielles, la société américaine sort du lot par le pouvoir des maîtres de l’économie et leur fort sentiment d’appartenance de classe, ce qui en fait un modèle d’exception au sein des démocraties industrialisées et entraîne de nombreuses conséquences.
Passer du fait de considérer la subordination à un maître comme une atteinte intolérable à la dignité et aux droits fondamentaux humains, au fait de la considérer comme la plus haute des aspirations dans la vie, n’a pas nécessité de changement dans la nature humaine. Même nature humaine. Circonstances différentes.
L’évolution vers une société où il est possible de vivre devrait renforcer de nombreux aspects de notre nature fondamentale : l’entraide, la compassion, la libre participation à la mise en oeuvre d’une politique sociale, et bien d’autres choses encore. Dans le même temps, elle limitera inévitablement d’autres options qui, pour beaucoup, sont des éléments importants pour une existence ayant vraiment du sens.
La transition vers une économie durable est un impératif absolu. On peut y parvenir tout en améliorant considérablement les conditions de vie. Mais elle ne sera ni simple, ni sans contraintes importantes.
Bob, la finance est la clé pour contenir le réchauffement climatique. Pourtant, l’économie mondiale est toujours au cœur d’une crise ou d’une autre, et aujourd’hui, une nouvelle crise bancaire est peut-être même déjà en cours. Dispose-t-on de suffisamment de capitaux et de liquidités au niveau mondial pour surmonter l’inaction politique afin de réduire les émissions mondiales de plus de 40 % d’ici 2030, ce qui semble être une nécessité absolue si l’on veut éviter un effondrement du climat ?
Robert Pollin : La réponse est Oui, il existe sans aucun doute des ressources financières plus que suffisantes qui pourraient être mobilisées pour financer une transition énergétique écologique à grande échelle. Comme je l’ai indiqué plus haut, nous devons consacrer environ 2,5 % du PIB mondial par an à des investissements dans les énergies propres. À titre de comparaison, les économies des pays à revenus élevés ont injecté environ 25 % de leur PIB dans des opérations de sauvetage pendant les périodes de confinement de la Covid. À l’heure actuelle, les subventions mondiales aux combustibles fossiles ont doublé en 2022 pour atteindre 1100 milliards de dollars. Au lieu de continuer à soutenir les prix exorbitants et les profits des compagnies pétrolières, il suffirait de réaffecter ces fonds au soutien à la consommation et à des investissements dans les énergies propres, cela pourrait alors, dans le cadre de l’économie mondiale actuelle, fournir près de la moitié du financement nécessaire.
La transition vers une économie durable est un impératif absolu. Mais cela ne sera pas aisé, et ne se fera pas sans contraintes importantes.
Dans le cadre de politiques efficaces, les dernières turbulences du secteur bancaire aux États-Unis et en Europe ne devraient pas constituer un obstacle à la mobilisation de fonds à grande échelle pour les investissements dans les énergies propres. Au contraire, des politiques efficaces peuvent conduire les investisseurs à considérer les investissements dans les énergies propres comme des valeurs refuge à faible risque, ce qui est tout à fait justifié. Cela peut même alors contribuer à stabiliser le système financier en général.
Le gouvernement américain pourrait, par exemple, émettre des obligations vertes, qui ne comporteraient alors aucun risque de défaillance pour les détenteurs privés de celles-ci, comme il en est pour tous les autres titres du Trésor américain (en supposant que les Républicains de la Chambre des représentants des États-Unis possèdent encore le minimum de bon sens nécessaire pour autoriser le relèvement du plafond de la dette du gouvernement fédéral). Le gouvernement pourrait alors utiliser ces fonds pour, par exemple, acheter de l’énergie solaire et éolienne à des entreprises privées afin de répondre aux besoins de consommation d’électricité des citoyens. Les fournisseurs privés d’énergie propre opéreraient alors dans le cadre de contrats avec le gouvernement qui soient fixes et garantis. Cela constituerait une autre source de stabilité du système financier. Étant donné que le gouvernement garantirait ces marchés, les bénéfices des fournisseurs d’énergie propre seraient également réglementés et limités, comme c’est le cas actuellement pour les entreprises de services publics.
Le gouvernement fédéral pourrait également affecter une part importante de ses fonds d’obligations vertes aux pays en voie de développement. Cela permettrait à ceux d’entre nous qui vivent dans les pays riches de remplir leur devoir de contribuer au financement de la transition de ces pays vers les énergies propres, étant donné que les États-Unis et d’autres pays riches sont presque entièrement responsables de la crise climatique. Dans le même temps, les obligations vertes utilisées à cette fin resteraient des titres du Trésor américain et ne présenteraient donc aucun risque de défaillance.
Des initiatives similaires en matière d’obligations vertes pourraient également être lancées dans toutes les économies à haut revenu. L’impact global permettrait de stabiliser le système financier mondial grâce à des investissements sûrs garantis par l’État, dont la fonction essentielle serait de faire progresser la stabilisation du climat mondial, au lieu d’alimenter de nouvelles frénésies spéculatives stériles à Wall Street.
Copyright © Truthout. Ne peut être reproduit sans autorisation.
C. J. Polychroniou
C. J. Polychroniou est politologue/économiste politique, auteur et journaliste. Il a enseigné et travaillé dans de nombreuses universités et centres de recherche en Europe et aux États-Unis. Actuellement, ses principaux intérêts de recherche portent sur l’intégration économique européenne, la mondialisation, le changement climatique, l’économie politique ainsi que la politique des États-Unis et la déconstruction du projet politico-économique du néolibéralisme. Il contribue régulièrement à Truthout et est membre du Public Intellectual Project de Truthout. Il a publié de nombreux livres et plus de 1 000 articles qui sont parus dans une variété de revues, de magazines, de journaux et de sites d’information populaires. Nombre de ses publications ont été traduites en plusieurs langues étrangères, notamment en arabe, chinois, croate, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, portugais, russe et turc. Ses derniers livres sont Optimism Over Despair : Noam Chomsky On Capitalism, Empire, and Social Change (2017); Climate Crisis and the Global Green New Deal : The Political Economy of Saving the Planet (avec Noam Chomsky et Robert Pollin comme principaux auteurs) ; The Precipice: Neoliberalism, the Pandemic, and the Urgent Need for Radical Change, une anthologie d’entretiens avec Chomsky publiée à l’origine sur Truthout et rassemblée par Haymarket Books ( 2021) ; et Economics and the Left: Interviews with Progressive Economist (2021).
Source : Truthout, C.J. Polychroniou, Robert Pollin, Noam Chomsky, 03-04-2023 Traduit par les lecteurs du site Les-Crises