
–
La Tribune Diplomatique Internationale publie ce roman
quotidiennement en chapitres
depuis le 21 décembre 2021
–
–
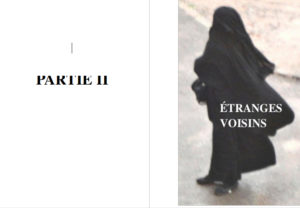
- La perfection n’est pas de ce monde
Le lendemain matin, Karim éprouve le besoin de « s’éclaircir les idées ». Après le petit-déjeuner, il téléphone à son « Ange » pour le rencontrer. Par chance, il est chez lui et disponible.
Un instant après, Karim est au « Paradis ».
– Alors, demande Si Lhafidh, comment ça va en Enfer ?
Karim sait à quoi ce dernier terme fait allusion : la société en général. Il a également observé qu’avec son vieil ami, il partage la même philosophie dans certains cas. Face à tout désagrément, la meilleure défense est sourire ou rire. Pleurer serait se laisser abattre ; se mettre en colère impliquerait de s’abaisser à singer l’adversaire. Dans les deux cas, on est perdant. Mais sourire ou rire, c’est considérer l’inconvénient ce qu’il est : un simple contretemps à surmonter, semblable à un sombre nuage cachant l’éclat du soleil. Voilà pourquoi, à la demande du vieux sage, son jeune ami répond :
– L’enfer ne me fait pas perdre le sourire.
Il ajoute :
– Le sourire ou le rire n’auraient-ils pas sauvé notre vieux moudjahid du suicide ?
Si Lhafidh a un léger haussement d’épaules, suivi d’un autre des sourcils, puis réplique d’un ton amical :
– Cher jeune homme, toi qui es au printemps de ta vie !… Avec l’âge que vient-il ?
– Beaucoup de choses, réplique l’interrogé.
– Mais d’abord et surtout ?
Karim réfléchit durant quelques secondes. Puis il avoue :
– À toi de me le dire.
– Madame la fatigue ! déclare le vieillard. Oui, la fatigue ! Surtout après une permanente et longue résistance contre l’imposture, l’infamie et la calomnie. Plus grave encore, quand cette résistance est menée, à la fin, presque en solitaire. Ajoute à cela la perte de l’épouse bien-aimée, avec laquelle on a partagé toute sa vie, où, alors, trouver la force de sourire ou de rire ?
– Cependant, toi !… objecte Karim, avec un regard admiratif.
– Oh ! Ne pense surtout pas que je suis un « héros ». La perfection n’est pas de ce monde. Contrairement à mon souhait, j’ai contribué au renforcement du capitalisme par l’enfant que j’ai mis au monde, avec mon ex-épouse italienne.
– Comment cela ?
– Il « s’active », comme il dit, dans une ONG allemande, en fumant des cigares et en arborant une barbe, à la manière de Che Guevarra, qu’il dit admirer. L’ONG opère au Soudan sud, pour soit disant aider les paysans à mieux gérer leur agriculture. Bien entendu, leur conseiller envoyé d’Allemagne, mon fils, reçoit un très confortable salaire, pour leur faire croire à l’efficacité de l’« aide humanitaire » occidentale. En réalité, son action sert à implanter une multinationale spécialisée dans la fabrication de produits OGM. Cela entraîne la faillite de l’agriculture paysanne traditionnelle, donc la famine pour ces gens. D’une part, ils ne disposent pas d’argent pour acheter les produits de la multinationale, et, d’autre part, ces produits épuisent rapidement la terre. Cependant, cette criminelle exploitation fournira des profits aux actionnaires de la multinationale. Et mon fils se considère un « bienfaiteur des pauvres » !… J’ai tenté à plusieurs reprises de lui faire prendre conscience de sa situation d’opportuniste privilégié. Il m’a traité d’« idéaliste dépourvu de réalisme ». Depuis lors, plus de nouvelles de lui. Et ma dignité m’empêche d’en demander, car ma raison m’a persuadé de l’impossibilité d’un dialogue avec une personne aveuglée par ses privilèges et confortée par sa fausse « bonne » conscience.
Si Lhafidh s’interrompt, l’air peiné.
– Quant à moi, poursuit-il, qu’ai-je fait pour améliorer tant soit peu ce monde ?… Oui, je n’ai jamais été dans le camp des exploiteurs ; tout au plus je m’étais résigné, parfois, à être exploité comme les autres. Mais je suis parvenu individuellement à m’affranchir de l’exploitation, sans toutefois pouvoir aider d’autres victimes à s’en libérer. Et tant qu’un être humain vit au détriment de la sueur d’un autre, puis-je me sentir heureux ?
– Tu ne crois pas que tu noircis trop le tableau ? objecte Karim.
– À peine. Certes, j’ai aidé quelques personnes, par-ci, par-là, à prendre conscience pour améliorer leur dignité. Ainsi, j’ai simplement agi comme d’autres, auparavant, l’avaient fait envers moi : transmettre des connaissances utiles… Cependant, j’aurais souhaité participer à un mouvement social capable d’éliminer toute forme d’injustice sur cette planète, ou tout au moins dans un pays… J’ai cru y réussir, à la fin des années 1968, quand j’habitais en Italie. Alors, on disait : « le fond de l’air est rouge ». Effectivement, le monde était en ébullition, animé par le plus bel idéal : la révolution populaire, à l’époque on disait « prolétarienne ». Hélas ! L’apparent bœuf se révéla n’être qu’une grenouille : les démons ont été plus forts que les anges.
Il se lève d’un bond :
– Ah, quel étourdi !… J’ai oublié de te demander si tu veux boire du thé à la menthe.
– Oh, ne te dérange pas ! s’empresse de dire Karim, en levant un bras pour le dissuader.
– Cela ne me dérange pas du tout. Le corps a besoin de matière afin que le cerveau carbure mieux… Une minute, et je reviens.
Il va dans la cuisine. Karim en profite pour observer de nouveau l’appartement. « J’aimerai bien avoir un logis comme celui-ci, se dit-il. Malheureusement, avec mon salaire, il faudrait un miracle comme ceux des Mille et Une Nuits ! »
L’heureux habitant du « Paradis » revient avec un plateau de cuivre, surmonté de la théière et de deux verres. Il pose le tout sur la table basse. Les deux amis prennent chacun son verre, et en boivent des gorgées.
Quand le vieil homme regarde de nouveau son jeune invité, il plisse légèrement les yeux, avec son familier léger et chaleureux sourire.
– J’ai l’impression, dit-il, de voir dans ton regard une question. Allez, vas-y !
Karim sourit à son tour, un peu gêné.
– Je ne sais pas si je peux.
– Avec moi pas de secret. Je me suis arrangé dans la vie à suivre une règle : afin de ne pas avoir honte de mes secrets, je m’arrange pour ne pas en avoir. Donc, je suis enchanté de satisfaire ta curiosité, qualité que j’aime, tant qu’elle sert la vérité. Allez, je t’en prie, pose ta question !
– Je voudrais savoir comment se fait-il que tu vis seul.
Le vieillard part d’un franc rire, se frotte un peu le bout du nez, et s’explique, avec une touchante sincérité :
– Je n’ai jamais su trouver la compagne juste, et si je l’ai rencontrée, je fus incapable de la reconnaître ou de la conserver. Là, échec et mat ! Kaputt !
Encouragé par ce début de confession, Karim veut savoir encore :
– Et avec ton enfant, quelle relation as-tu ?
– Ah, là, tu touches un point douloureux, mais pas de problème pour t’en parler. Je t’ai déjà dit auparavant le travail qu’il fait. En réalité, j’ai mis au monde également une fille. Mais, elle ne fut pas désirée par moi. J’avais à peine vingt cinq ans. J’étais lié par une simple amitié sentimentale à une Algérienne, avec laquelle je travaillais. Elle se laissa mettre enceinte. Pourtant, avant de commencer ma relation avec elle, je l’avais avertie de prendre ses précautions ; je lui avais déclaré que je ne voulais pas d’enfant, ni de mariage, parce que j’étais déjà décidé à quitter le pays, et tout seul, n’ayant ni les moyens économiques ni le désir d’emmener avec moi une autre personne. La dictature militaire m’étouffait trop. Ainsi, j’ai tenté de convaincre ma compagne d’avorter, avec l’aide d’une amie médecin accoucheuse. Refus catégorique de ma compagne. Le bébé, une fille, vint au monde. Je m’en suis occupée pendant un an, puis je suis parti en exil. La femme changea d’adresse ; je n’avais plus de contact avec elle. Puis, en Italie, j’ai eu le garçon dont je t’ai parlé.
– Pourquoi l’Italie, s’empresse de savoir Karim, et pas la France, comme la majorité des Algériens ?
– Pour une question de principe : chasser les colonialistes pour aller ensuite habiter parmi eux, je ne trouvais pas cela logique, pour ne pas dire digne. J’ai préféré aller dans un pays où je devais apprendre la langue, mais qui n’avait pas de relation colonisatrice avec moi et le peuple dont je provenais. En plus, j’étais très curieux de comprendre comment le peuple italien combattit l’occupation nazie, et pourquoi y existait un parti communiste très fort et très implanté dans le peuple. Auparavant, je fus tenté par l’Allemagne ; je voulais savoir comment un peuple très cultivé avait sombré dans la folie nazie. Mais le climat froid du pays me dissuada ; je préférais le soleil et la mer que l’Algérie et l’Italie ont en commun.
– Ah, je comprends… Donc, tu parlais de ton fils quand je t’ai interrompu.
– J’ai tenté plusieurs fois de l’aider à prendre conscience de son rôle doublement infâme : jouir d’un très confortable salaire, en participant à l’aggravation de l’exploitation des paysans soudanais. Résultat ?… Il arriva à me déclarer, avec arrogance : « Tu tires trop sur la corde !… Ce n’est pas parce que tu n’as pas réussi économiquement dans ta vie que je dois t’imiter. »… J’ai donc fini par mettre un terme à la relation avec lui, en précisant ceci : « Je te souhaite de consulter un psychologue compétent. Peut-être qu’ainsi, comme personne neutre, il t’aiderait à mieux évaluer le rôle que tu joues sur cette planète. Alors, je renouerai avec joie notre relation sur une base saine ». Depuis lors, comme je te l’ai déjà dit, pas de nouvelles. Bien entendu, j’assume la responsabilité de cette faillite comme père.
Un profond soupir commente cette confession.
– Et… la fille ? hasarde Karim.
– Oh ! Nous eûmes une ou deux occasions de nous voir. Je l’ai invitée à rester en contact ; elle le promit, mais, depuis lors, rien.
Prévenant une demande ultérieure de Karim, le vieillard précise :
– Oh ! Elle se porte bien, je le sais par des voix secondaires. Mais son père n’est pas un sujet de préoccupation pour elle.
Il conclut, la voix peinée :
– Ainsi, tu constates : je n’ai rien d’un homme qui a réussi sa vie, comme on dit, ni comme époux, ni comme père. Et je ne possède ni villa, ni grosse voiture. Mon seul titre de dignité est de n’avoir jamais vendu ma cervelle à personne. Je fus uniquement contraint, en arrivant en Allemagne, à vendre durant de très courts laps de temps ma force de travail manuel, d’abord à un patron de restaurant italien, puis à celui d’une usine de bière, pour subvenir à mes nécessités de vie matérielle.
Après ces propos, Karim s’efforce de ne pas montrer sa tristesse. Il n’exprime pas sa conclusion : « Très dur de parvenir à cet âge, et de se trouver seul, dans une condition financière limitée. »
Comme si le vieil homme eut deviné la pensée de son interlocuteur, il précise :
– Oh ! Ma situation actuelle n’est pas mon plus gros problème, mais cette planète : elle est soumise à la rapacité la plus vile d’une minorité de requins affamés d’argent… Toutefois, j’espère que toi, tu auras une meilleure chance, comme père et comme époux.
Il ajoute :
– Et aussi comme citoyen… Pour ce qui est de la dignité, je ne crains rien pour toi ; tu es composé de la bonne graine humaine.
– Ah ! s’exclame Karim, surpris et tout heureux. Tu viens d’employer la même expression que mon grand-père, paysan. Il me disait dans mon enfance : « Karim, Karim ! Je ferais tout pour que tu sois composé de la bonne graine humaine ! »
– Eh bien, conclut Si Lhafidh, j’estime qu’il a accompli sa mission, ce brave grand-père !
– Cependant, objecte Karim avec une pointe d’amertume, dans la société actuelle, il est difficile de réaliser les désirs les plus dignes.
– Pourquoi ?
– Tu viens de le dire : l’argent ! Le Dieu Argent !… Comme tu le sais, derrière le Dieu qu’on proclame adorer, en réalité, le vrai Dieu est l’argent. Il a pollué tout ! Même les sentiments entre enfants et parents, entre frères et sœurs. Alors, l’amour ?!… Voici une discussion que j’eus, à l’hôpital, avec une collègue médecin, nommé Zoubida :
« Moi : J’ai entendu dire que tu aurais finalement trouvé l’homme à épouser. Est-ce vrai ?
Zoubida : Hélas !
Docteur : Comment ça, hélas ?
Zoubida : La valeur de l’homme est dans sa poche ! Et celui qui me désirait, sa poche contenait trop peu !
– Ah, je comprends. »
À ce récit, Si Lhafidh hausse plusieurs fois la tête, en signe de compréhension, mais avec tristesse. Karim reprend :
– À cette collègue, je n’ai pas répondu, pour ne pas risquer de la choquer, ce qui m’est venu à l’esprit : « En ce qui me concerne, moi, ce qui contient peu, c’est ma tête ».
– Comment ça ? s’enquiert Si Lhafidh.
– Tout ce que je sais est tellement peu par rapport à ce que je devrais savoir. La preuve est dans les deux livres que tu m’as prêtés… Dans l’obscurité de l’ignorance, comment vivre correctement ?
– Explique-moi davantage.
– Bien que la situation leur était très défavorable, les combattants de la guerre de libération nationale ont su nous offrir ce cadeau inestimable : l’indépendance. Mais nous, qu’offrons-nous à notre peuple et à nous-mêmes ?… Ils me font pitié, pour ne pas dire enrager, ceux qui prennent prétexte des difficultés actuelles pour déclarer qu’il n’y a rien à faire ou, pis encore, qu’ils se sont trompé de peuple ou veulent en changer. Pourtant, ils sont bardés de diplômes universitaires. À quoi leur servent-ils, sinon à jouir de privilèges, tout en s’offrant l’odieux luxe de mépriser le peuple, en oubliant que ce dernier est exclu de l’accès à la connaissance ?
Il se tait, attendant un éclaircissement de son vieil ami. Celui-ci se contente de réfléchir. Karim ajoute :
– Je lis un journal en ligne, où un auteur algérien parle souvent d’autogestion. Cela me paraît un but irréalisable. Qu’en penses-tu ?
– L’autogestion !… murmure le vieux Si Lhadidh, avec une infinie tendresse, comme au souvenir d’un être très chéri.
Il raconte :
– Quand j’avais ton âge, je travaillais dans une petite cimenterie, comme comptable. Elle se trouvait sur la corniche longeant la mer. À l’indépendance, le patron et le technicien, tous les deux « pieds-noirs » ont quitté précipitamment l’Algérie. Que faire, alors ?… Comment survivre ?… On forma un comité d’autogestion de travailleurs, et nous avons réussi le miracle : non seulement continuer la production ; mieux encore, la réaliser avec de meilleurs résultats !… Normal : désormais, nous travaillions pour nous-mêmes ; les bénéfices, on les utilisait à rendre meilleures nos conditions de travail, à nous rétribuer de manière plus juste, sans oublier d’épargner une partie de l’argent pour des investissements futurs afin d’améliorer la productivité de l’entreprise.
Si Lhafidh s’interrompt un moment, pour jouir du souvenir de ce merveilleux temps passé. Il prend une gorgée de thé, ensuite pose le verre.
Il continue :
– Malheureusement, un an après, les détenteurs du nouvel État prirent le contrôle de cette autogestion par des décrets, dit de mars 1963. Dès lors, le gouvernement, soit disant socialiste, nous imposa un directeur, nommé par lui. Son comportement envers nous était pire que celui du patron privé colonial. Dans tous les autres comités d’autogestion, les travailleurs se virent imposer ce même genre de directeur étatique. Son comportement dictatorial et les privilèges dont il jouissait révoltèrent les travailleurs. L’État répondit par la répression. Les travailleurs, qui tenaient à l’autogestion libre, protestèrent. Certains furent licenciés, d’autres emprisonnés et torturés. Je fus l’un d’eux, car j’étais parmi les membres dirigeants du comité d’autogestion de notre cimenterie. D’autres camarades disparurent, c’est-à-dire furent à notre avis assassinés. Ainsi fut éliminée l’autogestion.
Si Lhafidh se rend compte de l’expression d’étonnement fort et désagréable de son jeune ami :
– Eh, oui ! confirme l’ex-autogestionnaire. Ce que je dis est, hélas !, l’amère vérité.
Il ajoute :
– Libéré de prison quelques mois après, j’ai rencontré par hasard un camarade de ma cimenterie. Il était le secrétaire de notre comité d’autogestion. Il marchait en boitant. Son handicap fut causé par les tortures à l’électricité qu’il avait subies : la gégène aux testicules, celle que pratiquait les colonialistes sur les combattants de la guerre de libération. Ses tortionnaires riaient en lui lançant : « Tu veux l’autogestion ?… Alors, essaie d’auto-gérer l’électricité !… Ha ! Ha ! Ha ! »
Si Lhafidh s’interrompt pendant quelques secondes, fort gêné de devoir relater ce genre de méfait. Il reprend :
– Quant à moi, je ne trouvais plus d’emploi dans le secteur étatique. Dans le privé, non plus, les portes m’étaient fermées. Le hasard fit que j’avais un ami d’enfance qui travaillait dans la police politique. Il me signifia le motif de mes déboires : j’étais fiché par la police politique comme « élément gauchiste, subversif et dangereux ». Et celle-ci veillait à le faire savoir partout où j’allais chercher du travail.
Il s’interrompt et passe la paume de la main droite sur son front, comme pour effacer ce très amer souvenir.
Il poursuit :
– Oh, ce n’est pas parce que l’expérience autogestionnaire fut éliminée qu’elle était utopique. Il faut simplement trouver les moyens de la pratiquer en lui évitant d’être vaincue par ses adversaires.
Lentement, il se lève et se dirige vers sa bibliothèque. Il prend un livre, revient vers Karim et le lui présente.
– Je te le prête, dit-il. Je pense que sa lecture t’aidera à savoir ce que fut l’autogestion algérienne. C’est une manière de poursuivre notre discussion, toi et moi.




