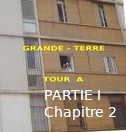Alors que l’Algérie se prépare à élire son prochain président en 2024, la question de la démocratie se trouve au cœur des préoccupations de la société civile et des acteurs politiques. Dans le cadre d’une réflexion plus vaste sur l’ouverture de l’Algérie à la scène internationale, il est crucial de souligner l’importance de la laïcité en tant que fondement de la tolérance.
Depuis de nombreuses années, la démocratie est un sujet de préoccupation majeur pour la société civile et les acteurs politiques en Algérie. De nombreux ouvrages et thèses ont été consacrés à cette question, dont l’ouvrage « L’Algérie aléatoire – ses maux-clés endogènes – une matrice transversale de sous-développement », achevé en mai 2018 et paru en juin 2023 aux Editions Universitaires Européennes en quatre tomes. Cet ouvrage souligne l’importance de la démocratie pour le développement et la stabilité du pays. Bien que des progrès aient été réalisés dans la mise en place de l’État de droit ces dernières années, il est important de prendre en compte les autres dimensions de la démocratie pour avoir une vision plus complète de la situation en Algérie.
Dans cet article, nous allons explorer les différentes facettes de la démocratie en Algérie, en nous appuyant sur des chiffres et des références, afin de mieux comprendre les enjeux de cette élection présidentielle cruciale pour l’avenir du pays.
L’État de droit en Algérie : des avancées à consolider
L’État de droit est un pilier essentiel de la démocratie. Il garantit la séparation des pouvoirs, la protection des droits de l’homme et l’égalité devant la loi. En Algérie, des progrès ont été réalisés dans la mise en place de l’État de droit ces dernières années. Selon l’indice de l’État de droit de la World Justice Project, l’Algérie a amélioré son score de 0,39 en 2015 à 0,44 en 2020. Cependant, des défis importants persistent.
La corruption est un fléau récurrent en Algérie, qui affecte tous les niveaux de la société et de l’État. Selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International, l’Algérie se classe 104e sur 180 pays en 2020, avec un score de 36 sur 100. La corruption a des conséquences néfastes sur l’économie, la justice et la confiance des citoyens dans les institutions publiques.
Le manque d’indépendance de la justice est également un défi majeur pour l’État de droit en Algérie. Le pouvoir judiciaire est souvent perçu comme étant soumis au pouvoir exécutif, ce qui affecte la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Selon un sondage d’opinion réalisé par l’Institut arabe de sondage en 2019, seulement 37% des Algériens ont confiance dans le système judiciaire de leur pays.
La participation citoyenne : un élément clé de la démocratie
Cette participation permet aux citoyens de s’impliquer dans la vie politique et de faire entendre leur voix. En Algérie, la société civile est très active et a joué un rôle important dans les mouvements de contestation récents, tels que le Hirak.
Cependant, la participation électorale en Algérie est faible. Selon l’Institut national des statistiques algérien, le taux de participation aux élections législatives de 2017 était de 35,3%. Cette faible participation peut être interprétée comme un signe de méfiance envers les institutions politiques et le processus électoral.
Pour renforcer la participation citoyenne en Algérie, il est important de promouvoir la transparence et l’équité du processus électoral. Des réformes électorales sont nécessaires pour garantir l’indépendance de l’autorité électorale, la transparence du financement des campagnes électorales et l’équité de l’accès des médias pour tous les candidats.
La liberté de la presse et d’expression : des droits fondamentaux à préserver
Ils permettent aux citoyens de s’informer, de débattre et de critiquer les actions des pouvoirs publics. En Algérie, la liberté de la presse et d’expression est garantie par la Constitution, mais elle est souvent limitée dans la pratique.
Les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme sont souvent harcelés, arrêtés et poursuivis en justice pour avoir exprimé leurs opinions ou pour avoir couvert des événements sensibles.
Pour renforcer la liberté de la presse et d’expression en Algérie, des réformes sont nécessaires pour garantir l’indépendance des médias publics, la diversité des sources d’information et la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme.
Conclusion :
Les élections présidentielles de 2024 seront un moment décisif pour l’avenir de la démocratie en Algérie, et il est important que tous les acteurs politiques et de la société civile travaillent ensemble pour garantir un processus électoral transparent, équitable et inclusif.
En cultivant la tolérance et la diversité, l’Algérie pourra s’ouvrir davantage à la scène internationale et rayonner à travers le monde.
Farid DAOUDI
Références :
-World Justice Project (2020). Rule of Law Index 2020.
-Transparency International (2020). Corruption Perceptions Index 2020.
-Institut national des statistiques (2017). Résultats définitifs des élections législatives du 4 mai 2017.
-Institut arabe de sondage (2019). Arab Opinion Index 2018-2019.
-« L’Algérie aléatoire – ses maux-clés endogènes – une matrice transversale de sous-développement », achevé en mai 2018, paru en juin 2023 aux Editions Universitaires Européennes, en 4 tomes.
-« Miser sur les diasporas et combattre l’oligarchie », El Watan du 08 Avril 2024, p.20
*******
>>> Le Parti pour la Laîcité et la Démocratie exprime sa position sur la « future mascarade électorale » de la présidentielle du 7 septembre 2024 !
Une transition démocratique ou la régression !
Les élections présidentielles en Algérie auront lieu officiellement le 7 septembre prochain mais une question centrale se pose : Se tiendront-elles telles que prévues dans les délais arrêtés ? Rien n’est moins sûr puisque le signal à l’ouverture de la campagne électorale n’a pas été donné et d’aucuns s’interrogent sur l’empressement dont a fait preuve le pouvoir d’avancer le scrutin ? A ce jour, la liste des candidatures n’est pas connue et de surcroit, à trois mois du rendez-vous électoral, il n’y a aucune agitation politique.
Quel caillou bloque les rouages d’une machine électorale particulièrement rôdée à assurer la réussite d’événements aussi importants ? S’agit-il d’un dysfonctionnement technique ou bien politique ?
Obsédé par le pouvoir et la volonté de se l’accaparer indéfiniment, le système ne s’est jamais engagé dans une élection avant qu’il n’en règle soigneusement le moindre détail afin d’éviter les « accidents » de parcours et préserver son pré carré. C’est pourquoi, il avait conçu mille et un stratagèmes pour tripatouiller le système électoral pendant des décennies et plier les résultats des urnes à ses objectifs politiques. Toute élection pour lui devait signer sa propre victoire
Les pouvoirs en place planifiaient ainsi tout à l’avance. En maîtres du jeu, ils se préoccupaient de mener en amont et dans le secret absolu des négociations bilatérales avec « l’opposition » pour lui imposer leur agenda politique, procéder au dosage des rapports de force pour fixer le poids relatif de chaque parti, et le cas échéant, négocier avec chacun d’eux le nombre de strapontins auxquels ces derniers pouvaient prétendre.
En matière de gestion maîtrisée, les « élections » 2024 semblent être un échec puisqu’elles semblent au point mort. S’agit-il d’une mise en scène ou la traduction d’une crise politique dans les arcanes du pouvoir.
Ce qui est sûr est que le système a atteint ses limites et a creusé sa propre tombe en excellant dans la combine au lieu de s’attaquer aux problèmes stratégiques du pays. Le pays ne s’en sortira que s’il met un point final au statu quo. Il ne se remettra d’aplomb que s’il trouve dans les institutions de l’Etat au premier rang desquels l’ANP, des patriotes et des républicains déterminés, audacieux et capables de s’appuyer sur le gisement démocratique qu’a révélé le mouvement citoyen de 2019 pour mettre fin au système actuel, dissoudre une classe politique opportuniste et nuisible et mettre en chantier une transition pacifique, républicaine, moderne, démocratique et sociale.

*******
 Le président du Front El Moustakbal appelle à resserrer les rangs pour relever les défis
Le président du Front El Moustakbal appelle à resserrer les rangs pour relever les défis
Le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, a appelé, vendredi depuis Tamanrasset, à resserrer les rangs pour relever les défis. Lors d’un meeting populaire régional animé au Théâtre municipal de Tamanrasset, en présence de militants de sa formation des wilayas de Tamanrasset, In Salah et In Guezzam, M. Boutbig a dit qu’il incombait au peuple algérien de « resserrer les rangs pour relever les défis » et de « faire montre de vigilance pour contribuer au renforcement des institutions de l’Etat ». Il a en outre estimé que la prochaine élection présidentielle incarnera l’Algérie nouvelle, appelant les militants de son parti à « consacrer la transparence électorale » et à « montrer que le peuple est à l’affût des ennemis ». Après avoir souligné que l’Algérie se portait bien, le président du Front El Moustakbal a relevé la nécessité d’oeuvrer à la moralisation de la vie publique et à la consécration du dialogue civilisationnel loin de toutes les pratiques qui n’honorent pas les sacrifices des chouhada et des moudjahidine ». Il a également affirmé que le peuple algérien demeurait uni et capable de faire face aux menaces à ses frontières induites par les troubles sécuritaires dans des pays voisins, soulignant par là même que le peuple algérien prouvera son unité et son attachement à sa patrie. A cette occasion, M. Boutbig s’est réjoui de la décision de la création de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, dans le cadre de la relance du développement dans les zones frontalières, affirmant que l’Algérie est toujours fidèle à ses engagements. Il a, par ailleurs, tenu à saluer le rôle important de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la protection des frontières du pays.
 Soufiane Djilali : «Notre pays a besoin de réformes fondamentales»
Soufiane Djilali : «Notre pays a besoin de réformes fondamentales»

Algeriepatriotique : Vous avez été convié par le président de la République à une rencontre avec plusieurs partis politiques. Qu’en est-il sorti ?
Soufiane Djilali : Cette réunion a revêtu plus une dimension symbolique que pratique. Cela a été l’occasion de dire à la classe politique que le président de la République est attentif aux demandes des partis et qu’il restera à l’écoute à l’avenir. En promettant au moins deux rencontres annuelles de ce type, il fait une ouverture, en tout cas, c’est une manière pour lui de dire son intérêt pour les partis.
Bien entendu, avec la présence de 27 chefs de partis qui ont pris la parole, cela a nécessité beaucoup de temps mais, au final, il était difficile de transformer la réunion en une véritable séance de travail.
De manière plus concrète, le Président a promis qu’il consultera les partis politiques pour les amendements des lois organiques sur les partis et sur les élections. Mais il n’y avait ni le temps ni les conditions pour ouvrir un débat sur le contenu.
Enfin, le Président a donné quelques informations sur des questions d’ordre régional et international.
C’est donc une première expérience. Il faudra la prolonger en l’améliorant et en lui donnant une dimension plus concrète.
A l’approche de l’échéance électorale présidentielle, on commence à en entrevoir les contours, avec l’annonce des candidatures. Jil Jadid compte-t-il présenter le sien ou la sienne ?
L’élection présidentielle représente un enjeu capital surtout pour un pays comme l’Algérie dont le régime est encore à la recherche de son équilibre. Tant que les institutions sont encore fragiles, la présidence de la République reste un centre de pouvoir opérationnel névralgique.
Donc, au-delà des ambitions personnelles qui peuvent être légitimes et des jeux électoraux, l’équilibre interne à l’Etat est toujours prépondérant dans ces joutes. En un mot, le processus qui fait émerger le président de la République n’est pas livré au hasard. Mais, malgré toutes les critiques que nous pouvons faire, il est important que cette élection se déroule conformément aux conditions édictées par la Constitution. C’est avec l’expérience et le temps que se fera la construction de l’Etat de droit avec des institutions souveraines et complémentaires, et qui agissent en contrepoids.
Mon espoir est que l’élection du 7 septembre 2024 soit le prélude à des réformes fondamentales dont le pays a besoin à brève échéance.
Quant à Jil Jadid, il prendra sa décision finale sur la manière dont il participera à cette élection lors de son Conseil national du 7 juin.
Une alliance de plusieurs partis pour présenter un seul et même candidat est-elle envisageable ?
C’est une modalité qui aurait pu avoir un sens dans l’absolu. Mais au vu de notre réalité politique, il me semble qu’elle est encore difficilement applicable. Je crois que notre système devra commencer à se réformer au niveau du Parlement. Le jour où les partis politiques obtiendront une véritable représentation par rapport à toute la population, l’Algérie pourra entrer dans un cycle de construction de la démocratie. Pour le moment, l’électeur potentiel boude l’urne et le champ est libre pour les manipulateurs de tout acabit au niveau des circonscriptions électorales. Le président de la République a annoncé plusieurs mesures pour écarter l’argent sale des élections. Sincèrement, et ce n’est pas pour forcer le trait sur une position d’opposant, mais les dernières élections législatives et locales n’ont pu endiguer ces pratiques malgré la volonté des autorités. Les prochains rendez-vous électoraux pour les législatives et les locales seront un moment crucial.
La désaffection des Algériens pour la politique ne sera-t-elle pas, encore une fois, un inconvénient majeur lors des prochaines présidentielles ?
A ce sujet, le Président semblait confiant. Pour ma part, je pense que cette désaffection est très profonde. Pendant longtemps, le régime était heureux que les Algériens ne votent pas. Ceux qui sont sceptiques ou même mécontents se réfugient dans l’abstention et l’indifférence par rapport au fait politique. Ces dernières années, le nihilisme a battu tous les records et les activistes s’en sont donné à cœur joie. Pour quel résultat ? En 2021, il y avait une véritable opportunité de changement. Mais tant les législatives que les locales ont été largement boycottées, laissant le terrain vide pour les partis-comités de soutien. C’est lorsque l’élite du pays se décide à s’engager, qu’elle prenne en charge son destin, qu’elle lutte pour un projet de société que les choses pourront évoluer. Tant que les pseudo-opposants continuent à invectiver ceux qui agissent en étant eux-mêmes des vecteurs de nihilisme, on ne pourra pas construire le pays.
Comment inciter les Algériens sceptiques à se rendre nombreux aux urnes, selon vous ?
Il faut que la politique reprenne un sens. C’est bien que le président de la République ait affirmé, lors de la réunion avec les partis, que les associations de la société civile n’avaient pas le droit de faire de la politique. Il faut que les choses soient bien distinguées. Maintenant, pour les partis politiques, il faudrait accompagner leur encadrement. Nous sommes à une phase du développement de notre société qui ne permet pas que des partis poussent tout seuls dans la nature comme des champignons. Les partis sont une composante de l’édifice étatique mais ne doivent pas être non plus considérés comme des annexes du ministère de l’Intérieur. Les partis sont des rouages essentiels de la démocratie. Ils font l’interface entre le cœur de l’Etat et les citoyens. Ils structurent la société d’un point de vue idéologique en harmonisant des visions politiques qui devraient être complémentaires, tout en présentant des aspects concurrentiels.
Lorsque le citoyen saura qu’il peut librement accéder à l’action politique, qu’il pourra y être formé et pourra espérer contribuer activement au fonctionnement de son pays, selon des modalités transparentes, alors il s’impliquera et défendra son pays. Mais s’il estime qu’il est marginalisé, que seuls les opportunistes peuvent accéder aux avantages alors qu’ils sont d’une médiocrité évidente, alors il se détourne de la vie politique et se réfugie dans le ressentiment, voire la subversion.
Avez-vous palpé le pouls de la société ? Quelle est la tendance générale ?
Mon sentiment est qu’après le Hirak, il y a eu d’abord une profonde déception. Les citoyens avaient été euphoriques à la vue des millions de manifestants. Puis, chacun a construit dans sa tête des illusions. Voyant que le réel ne correspondait pas à leurs attentes, ils se sont détournés, en désespoir de cause, de la politique. Cette réaction était naturelle et prévisible. Je m’attendais même à ce que les citoyens accusent les politiques d’être la cause de l’échec. D’ailleurs, les politiques les plus excités et les plus radicaux durant le Hirak (les guévaristes) sont maintenant les plus critiqués ! Or, à travers cette expérience, il y a une prise de conscience de la réalité. Beaucoup de ceux qui avaient des positions radicales ont réévalué leurs positions. C’est une très bonne chose.
Le président et le chef d’état-major de l’ANP mettent en garde contre de nombreuses menaces extérieures. Le front intérieur est-il suffisamment soudé pour y faire face, selon vous ?
Vous le savez, la souveraineté du pays est sacrée pour les Algériens. Quelles que soient les circonstances, ils agiront toujours pour défendre leur pays. Maintenant, il y a beaucoup à faire pour harmoniser le front intérieur, à commencer par bien définir le sens de cette expression. Si c’est pour revenir à une forme d’unicité de la pensée et à une docilité face au pouvoir, je ne crois pas que cela soit réellement faisable. Les Algériens veulent la liberté d’expression et leur pluralité culturelle ne peut être contenue dans un unique discours. Le multipartisme, s’il est bien pratiqué, deviendra un élément de stabilisation et renforcera la cohésion interne. Mal pratiqué, il peut devenir un handicap par la multiplication désordonnée des idées et des égos.
Quel bilan faites-vous du premier mandat du président Tebboune ?
J’ai déjà eu l’occasion d’en parler longuement. Pour me résumer, je vous dirai qu’il y a eu des succès stratégiques importants, mais aussi des faiblesses qui deviennent rédhibitoires. Parmi les bons points, la stabilisation de l’Etat après les profondes fissures qui étaient apparues depuis une dizaine d’années. Il faut être conscient que depuis 2018, les principales institutions ont été secouées par de graves crises. Mon sentiment est que de ce point de vue, les choses sont rentrées dans l’ordre. Par ailleurs, le milieu des affaires commence à être assaini. Il ne faut pas oublier qu’on revient de loin. Le pays allait être mis en lambeaux et vendu pour une bouchée de pain. Le Hirak avait sauvé la mise. Pour les faiblesses, j’ai déjà émis à plusieurs reprises des critiques quant aux choix économiques. Il y a un évident retour aux pratiques de l’étatisme, une forme de centralisme administratif avec un pouvoir bureaucratique excessif. Or, l’Algérie a besoin de dynamiser son système économique, d’encourager les investisseurs à prendre des risques et à démarrer la production. Espérons que l’Etat engagera des réformes profondes pour redonner confiance aux opérateurs économiques. Enfin, dernier point où je suis critique : disons la vérité, l’infrastructure politique qui était totalement engagée avec l’ancien régime se retrouve une fois encore aux avant-postes. Il y a comme une fatalité à ce qu’une même classe politique soit sans arrêt recyclée. Elle a accès à tous les moyens alors que celles et ceux qui auraient pu être d’un apport significatif pour une «Algérie nouvelle» ont été marginalisés.
Le président sortant n’a pas encore fait savoir s’il comptait rempiler ou non. Y a-t-il des signes qui indiquent que Tebboune sera candidat à sa propre succession ?
Des signes ? Oui, à profusion. Mon sentiment est que le président de la République est décidé à finir son programme. A plusieurs reprises, il s’est projeté au-delà de son premier mandat. La Constitution lui donne ce droit.
Au cas où le président Tebboune se présenterait et serait réélu, seriez-vous prêts à faire partie du gouvernement si cela vous est proposé ?
La configuration actuelle fait qu’il sera forcément réélu, il n’y a aucun doute là-dessus. «Quel gouvernement constituera-t-il ?» reste une question posée. Nous sortirons probablement du modèle technocratique et les partis qui l’auraient soutenu en feront sûrement partie. Pour le reste, je pense que l’on peut faire partie d’un gouvernement si l’on est convaincu de son orientation politique. Il est beaucoup trop tôt pour pouvoir porter un jugement et se prononcer sur son opportunité.
Comment voyez-vous l’évolution de la situation dans le pays dans cet environnement international instable, voire hostile ?
Ce qui se passe dans le monde est tout à fait exceptionnel. Le système mondial a été essentiellement construit à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Malgré l’opposition entre l’Est communiste et l’Ouest libéral, il y avait une architecture mondiale consensuelle et un droit international reconnu. Aujourd’hui, nous assistons à un bouleversement général. Il n’y a certes plus d’opposition dogmatique sur le modèle économique, mais nous sommes passés à une confrontation ultime sur les modalités de gestion du monde. Depuis la chute de l’URSS, l’Occident avec à sa tête les Etats-Unis, a mis en œuvre une politique d’unipolarité centrée sur une idéologie néolibérale, où l’entreprise devient un centre de pouvoir décisif. La modernité a pris une forme matérialiste dans laquelle l’humanité a été réduite à une donnée désacralisée qu’il faut gérer. La numérisation appuyée par l’intelligence artificielle devient un outil de gestion du crédit social. Le contrôle de la démographie au nom de l’écologie et les nouvelles idéologies LGBT et transhumaniste est devenu la justification de tous les fantasmes.
Le conflit armé en Ukraine, en Palestine et potentiellement en mer de Chine n’est que le symptôme d’une fracture idéologique dans le monde. Nous allons assister soit à une prise de contrôle de la planète par un hégémon unique, soit au renforcement d’un monde multipolaire et multicentré. L’humanité trouvera un chemin de paix lorsqu’elle acceptera ses différences et apprendra à collaborer au lieu de s’entretuer.
Dans cette phase critique où l’affrontement des puissances peut se transformer en une troisième guerre mondiale dévastatrice, l’Algérie devra être très vigilante. Je pense que l’Etat algérien en charge de notre sécurité nationale est en mesure d’agir pour le mieux.
Propos recueillis par Nabil D.
 Un message de Zoubida Assoul, présidente de l’Union pour le Changement et le Progrès (UCP)
Un message de Zoubida Assoul, présidente de l’Union pour le Changement et le Progrès (UCP)
 Cher Farid Daoudi,
Cher Farid Daoudi,
Nous souhaitons vous féliciter chaleureusement pour la publication de votre remarquable ouvrage « L’Algérie Aléatoire ». Votre travail intense et votre approche multithématique offrent une perspective précieuse sur les défis complexes auxquels est confrontée notre nation.
Votre capacité à anticiper les mouvements sociaux, tels que le Hirak, démontre votre profonde compréhension des dynamiques de notre société. Nous croyons fermement en l’importance de votre contribution au débat public et à la recherche de solutions pour l’avenir de l’Algérie.
Nous vous invitons cordialement à contribuer plus activement à notre parti politique. Nous croyons que votre expertise et votre engagement peuvent jouer un rôle crucial dans la création d’un avenir meilleur pour notre pays. Nous serions honorés de vous offrir un espace où vous pourrez continuer à influencer positivement le changement.
Encore une fois, toutes nos félicitations pour votre travail exceptionnel, et nous espérons avoir le plaisir de collaborer avec vous dans un avenir proche.
Bien à vous,
Lourguioui Mohamed abdelaziz, Secrétaire général
 Portrait-robot d’un Président idéal
Portrait-robot d’un Président idéal
Comment dessine-t-on un portrait-robot d’un Président complet ou presque?
Nous ne sommes pas sous la République de Platon! Nul n’est parfait, tout est relatif. Même le Prophète que le salut soit sur lui a été contesté. Le Messie a été crucifié et Moïs exilé.
L’idéal est idéal!
Dans le jeu de la démocratie, personne n’est accepté ni rejeté à cent pour cent.
Et je poserai cette question aussi politique que culturelle: comment dessine-t-on un portrait-robot d’un Président complet ou presque?
Le portrait-robot du Président, quel que soit le Président, dans l’imaginaire collectif, est lié à une chaîne de valeurs dominante dans une société bien précise. Ce portrait-robot est le résultat d’un ensemble d’attributs relevant de la morphologie, de la politique, de la culture, de la psychologie, de la linguistique.
Le sens même de l’idéal ou du parfait d’un portrait-robot d’un Président change d’un regard élitiste à un autre populaire.
Sur le plan moral, le portrait-robot d’un Président complet est caractérisé par le sentiment de celui qui ne ment pas. Mais le mensonge est l’arrière-cour de la politique.
Le portrait-robot d’un Président complet, c’est celui distingué par un discours conforme à la réalité. Les citoyens n’aiment pas les Présidents qui parlent beaucoup. L’ère des discours fleuves est révolue!
Le portrait-robot d’un Président accompli est celui qui reconnaît ses insuffisances, ses limites et ne dépasse pas ses prérogatives. Celui qui sait écouter les autres. L’écoute est une force et un art. Celui qui est capable de faire la différence entre l’égoïsme et le charisme. Entre l’intelligence et la ruse!
Le Président qu’il faut c’est celui qui a l’aupdace de dire qu’avant lui il y avait quelqu’un,et qu’après lui il y aura un autre Président.Le jour d’avant et le jour d’après. Nul n’est éternel. Dans la politique chacun est remplaçable. L’alternance est l’âme de l’Histoire.
Le Président vouluc’est celui qui défend la différence, qui est une partie de la diversité. Qui ne tolère pas l’intolérance, le racisme, l’injustice et le féminicide. Celui qui protège la liberté d’expression. Celui qui garantit la liberté d’opinion. Le Président attendu c’est celui qui garantit la liberté de confession; protège, par la force de la loi,la mosquée et ses fidèles,l’église et ses adeptes, la synagogue et ses disciples.
Le Président espéré c’est celui qui, sur le plan personnel, possède ses propres convictions, mais qui, dans l’exercice de sa fonction, se teint résolument au-dessus de tout clivage religieux ou non religieux.La religiosité et la non-religiosité à ses yeux relevant de la sphère privée, de l’intime.
Le Président souhaité c’est celui qui refuse d’utiliser la religion et ses institutions à des fins politiques et interdit aux autres de le faire, au nom de la loi.
Le Président désiré c’est celui qui est capable de reconnaître ses insuffisances, qui connaît ses limites intellectuelles et professionnelles. Il n’est pas divin ni divinité.
Le président demandé c’est celui qui ne parle pas à la place d’un médecin, d’un ingénieur, d’une sage-femme, d’un fellah, d’un journaliste, d’un professeur, d’un aviateur, d’un jardinier, d’un artiste… il n’est pas Monsieur-Tout, parce que parler au nom de tout ce monde, à la place de tout ce monde, signifie que ce Président est frappé par le syndrome du totalitarisme et du populisme.
Le Président sollicité c’est celui qui défend une école républicaine, avec courage et sans concession. Celui qui fait de l’école un espace dédié au savoir et à l’émancipation des générations futures. Celui qui veille sur la neutralité et l’indépendance de la justice loin de toute phraséologie infructueuse ou téléphone fixe ou portable!
Le Président revendiqué c’est aussi celui qui aime la lecture, le livre, la musique et le théâtre parce que la culture et les arts, par leur définition,sont les meilleurs protecteurs de l’immunité intellectuelle et sentimentale. La bonne littérature est un remède contre la corruption!
Le Président auquel on aspire c’est celui qui agit pour la promotion de la culture de la citoyenneté participative, respectant et protégeant la volonté de celui qui prie et de celui qui prend un verre de vin ou une tasse de café, tout cela dans le respect total de la loi républicaine.
Le Président défendu c’est celui qui croit dans le combat de la liberté de la femme comme une priorité nationale économique et politique. Celui qui combat sans relâche la violence faite aux femmes, le harcèlement et le féminicide. Celui qui instaure l’égalité entre les femmes et les hommes en droits et devoirs.
Le Président espéré c’est celui qui veille sur le soutien indéfectible de l’enseignement des langues nationales, sur un pied d’égalité, et encourage les nouvelles générations des utilisateurs.
Le Président recommandé c’est celui qui est capable, avec courage politique, de libérer le citoyen de la culture de l’assistanat.Celui qui considère qu’un État social n’est pas un État d’assistanat.Qui valorise le travail loin de tout populisme. Donnez un poisson à un homme, vous lui assurez la nourriture d’un jour, Apprenez lui à pêcher vous lui assurez la nourriture toute une vie.
Le Président appuyé est celui qui a la volonté de changer notre système bancaire bureaucratique stérile en un autre concurrentiel et productif. Nos banques ne sont que des coffres-forts pour argent stagnant! Celui qui a le courage économique et politique de revoir la valeur de la monnaie nationale et de sauver le dinar en tant que symbole de la nation.
Le Président soutenu c’est celui qui représente, qui porte haut, la voix du pays sur la scène internationale, dont le but principal est de défendre la souveraineté nationale et les intérêts du pays et d’agrandir le cercle des alliés et des amis.
Le Président idéal est un citoyen idéal !
Amin Zaoui
Choisir en conséquence et en conscience
Le stade actuel d’évolution de l’Algérie est l’aboutissement d’une suite de réaménagements qui ont, à chaque fois, pris l’allure d’un projet voué à la faire rebondir. Il en fut ainsi à maintes reprises depuis le 19 juin 1965. De cette évolution interne sont nées tantôt de grandes avancées, tantôt de déplorables régressions. C’est dans cette perspective que vont s’ébaucher les idées, les dessins et les problématiques portés par les candidats à l’élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024. À partir d’un constat de ce qui fonctionne mal dans la société, ces derniers vont faire des déclarations, des propositions et prononcer des discours. Vont-ils dire et redire ce que les Algériens ont maintes fois entendu sur les maux qui minent leur pays ou bien innoveront-ils? Vont-ils persister à réduire l’action politique à une sorte de mystique dominée par des causeries qui s’accordent ou se heurtent au hasard des ententes et des mésententes ou bien se décideront-ils à en finir avec les récurrences et à apporter un souffle nouveau dans la sécurité et la stabilité retrouvées?
La réponse à ces questions ne fait aucun doute. Seule l’action fondée sur l’ordre, le débat constructif, des normes d’efficacité et l’adhésion populaire est propre à ériger la «Nouvelle Algérie». Car les problèmes sont nombreux, tandis que l’engourdissement ne permet pas de les résoudre. Il y faut aussi une vision d’ensemble de l’Algérie de 2062, tout en sachant comment s’y prendre pour l’édifier pas à pas. L’auteur de ces lignes ne prétend pas que les postulants au poste de chef de l’État méconnaissent les voies et les moyens de faire avancer le pays. Il croit tout simplement utile de pointer le regard sur des faits si évidents que candidats et électeurs ont trop tendance à les négliger, alors qu’ils sont essentiels pour un État qui veut émerger sur la scène du monde. De quoi s’agit-il? Il s’agit, de prime abord, de la participation électorale qui s’affaisse, bien qu’à diverses reprises, elle s’est maintenue à un niveau élevé. Les Algériens seraient-ils devenus apolitiques, tandis que les partis se comptent par dizaines? A vrai dire, l’implication massive des électeurs s’expliquait autrefois par l’impulsion très puissante de la Révolution nationale, ainsi que par les idéaux qui s’étaient emparés du peuple. Celui-ci avait nettement conscience de participer à une grande cause. Il n’est pas inutile de le rappeler aujourd’hui au nom de la vérité historique pour signaler que l’atonie n’est pas une constante de la mentalité algérienne parce que cette nation n’a raté aucun des rendez-vous cruciaux de son passé. Elle a traversé le temps avec persévérance, sans s’illusionner à tout faire en une seule fois, ni à brûler les étapes. Celle par laquelle elle passe actuellement n’est pas des plus faciles. Certes, les candidats à la prochaine élection ont à travailler sérieusement pour convaincre les électeurs à se rendre aux urnes. Mais le plus dur commencera après le 7 septembre pour prendre à bras-le-corps de grands sujets d’avenir à savoir: le climat moral de la nation; la problématique des liens sociaux; les priorités du développement économique; la dynamique motivationnelle face à la démobilisation des élites; la stimulation de l’intelligence collective; l’usure du discours politique traditionnel et de la légitimité historique relative à la gouvernance; l’anticipation. D’une manière ou d’une autre, ces sujets font référence au rôle de l’État et au concept de politique publique définie comme «une action collective qui participe à la création d’un ordre social et politique, à la direction de la société, à la régulation de ses tensions, à l’intégration des groupes et à la résolution des conflits» (Lascoumes et Le Galès, 2012). Une telle politique implique donc des choix et des normes législatives qui indiquent qui fait quoi. Elle implique aussi des normes d’application qui permettent d’interpréter, d’adapter, de créer et de décoincer des situations. Elle implique, enfin, une mobilisation des instruments budgétaires et autres qui permettent un cadrage et un pilotage de l’action. Mais d’entrée de jeu, ladite action publique pose une triple exigence: 1- une exigence de légitimité par la concertation; 2- une exigence de rationalisation pour l’efficacité; 3- une exigence de contrôle et d’évaluation pour ne pas déambuler. En bref, ce qui attend le leader d’après septembre 2024 est une vie de lutte à la surface d’un océan de besognes qui emportera l’Algérie vers son destin. Plongé dans le labeur au contact avec la réalité, mais sans se noyer dans le quotidien, il ne pourra s’imposer que par le savoir et le savoir-faire que lui aura enseignés une longue pratique du terrain. Car, à lui seul, le travail technique des conseillers, aussi compétents soient-ils, est insuffisant. Il faut à ce haut niveau de responsabilité une fonction indispensable de synthèse et d’anticipation que seul un professionnel rompu à la gestion publique peut assurer. Un professionnel qui soit également familier de l’économie, ses modes de régulation et les politiques y afférentes. Autant dire qu’un candidat «même bien doué (…) n’arrive à être un chef compétent qu’après des années d’expérience qui lui auront servi d’apprentissage». (J. D.Vignes Rouges, 1946.) L’électeur saura-t-il s’en rappeler le 7 septembre et choisir en conséquence et en conscience?
Hachemi Djiar